![[France QRD]](../../common/fglbOXS.gif)
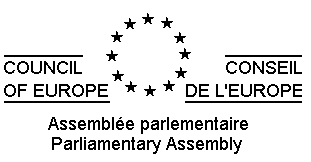
Situation des gays et des lesbiennes et de leurs partenaires en matière d'asile et d'immigration dans les Etats membres du Conseil de l'Europe
Doc. 8654
25 février 2000
Rapport
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie
Rapporteur: Mme Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Suisse, Groupe socialiste
Résumé
L'Assemblée est préoccupée par le fait que les politiques de l'immigration de la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe sont discriminatoires à l'égard des homosexuels.
La majorité de ces Etats, par exemple, ne reconnaissent pas la persécution pour raison d'orientation sexuelle comme motif valable d'octroi de l'asile, et les règles en matière de regroupement familial et des prestations sociales ne s'appliquent généralement pas aux couples homosexuels. L'Assemblée est aussi consciente que la plupart des Etats membres ne prévoient aucun type de droit de séjour pour les membres de nationalité étrangère de couples homosexuels binationaux.
L'Assemblée estime que les homosexuels qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur préférence sexuelle doivent être considérés comme des réfugiés au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et elle propose de définir des lignes directrices concernant le traitement des homosexuels réfugiés ou partenaires d'un couple binational.
Par ailleurs, l'Assemblée s'adresse au Comité des Ministres afin qu'il examine ces problèmes et mette en place un système européen de collecte d'informations sur les abus commis envers les homosexuels.
I. Projet de recommandation
1. L'Assemblée rappelle et réaffirme les principes de sa Recommandation 924 (1981) relative à la discrimination à l'égard des homosexuels, de sa Recommandation 1236 (1994) relative au droit d'asile et de sa Recommandation 1327 (1997) relative à la protection et au renforcement des droits de l'homme des réfugiés et des demandeurs d'asile en Europe. Elle se réfère également à sa Recommandation ... (2000) sur la situation des lesbiennes et des homosexuels dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.
2. L'Assemblée est préoccupée par le fait que les politiques de l'immigration de la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe sont discriminatoires à l'égard des homosexuels. La majorité de ces Etats, par exemple, ne reconnaissent pas la persécution pour raison d'orientation sexuelle comme un motif valable d'octroi de l'asile et ne prévoient aucun type de droit de séjour pour les membres de nationalité étrangère de couples homosexuels binationaux.
3. De même, les règles en matière de regroupement familial et des prestations sociales ne s'appliquent généralement pas aux couples homosexuels.
4. L'Assemblée est consciente de l'existence de cas avérés de persécution d'homosexuels dans les pays d'origine, dont certains sont membres du Conseil de l'Europe.
5. L'Assemblée estime que des homosexuels qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur préférence sexuelle doivent être considérés comme des réfugiés au sens de l'article 1 A (2) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en leur qualité de membres d'«un certain groupe social» et doivent, par conséquent, bénéficier du statut de réfugié. La pratique actuelle de certains Etats membres du Conseil de l'Europe consistant à leur accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires peut porter préjudice aux droits de l'homme de ces personnes et ne doit pas être considérée en soi comme une solution satisfaisante.
6. De plus, l'Assemblée est consciente que le refus de la plupart des Etats membres d'accorder un droit de séjour aux membres de nationalité étrangère de couples homosexuels binationaux est à l'origine de situations douloureuses pour de nombreux couples homosexuels, qui peuvent se trouver séparés de ce fait et contraints de vivre dans deux pays différents. Elle estime que les règles applicables aux couples en matière d'immigration ne doivent pas établir de distinction entre relations homosexuelles et relations hétérosexuelles. Par conséquent, un document établissant l'existence d'une relation suivie, autre que le certificat de mariage, devrait pouvoir être admis parmi les pièces demandées pour l'admission au bénéfice du droit de séjour dans le cas des couples homosexuels.
7. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
i. de charger ses comités compétents:
b. d'examiner la question de la reconnaissance des homosexuels en tant que membres d'«un certain groupe social» au sens de la Convention de Genève de 1951 dans le but de faire que la persécution pour homosexualité soit considérée comme un motif d'octroi de l'asile;
c. de définir des lignes directrices concernant le traitement des homosexuels réfugiés ou membres d'un couple binational;
d. d'entreprendre la mise en place d'un système européen de collecte de données sur le sujet et d'informations sur les abus commis envers les homosexuels;
e. d'apporter leur concours et leur soutien aux groupes et aux associations de défense des droits de l'homme des homosexuels en matière d'asile et d'immigration dans les Etats membres.
ii. de demander instamment aux Etats membres:
a. de réexaminer leurs politiques et procédures de détermination du statut de réfugié, afin que puissent être reconnus comme réfugiés les homosexuels ayant présenté une demande d'asile parce qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés pour l'un des motifs énumérés dans la Convention de Genève de 1951 ou dans le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967;
b. d'adopter des critères et des lignes directrices concernant les homosexuels demandeurs d'asile;
c. de veiller à ce que les autorités chargées de la procédure de détermination du statut de réfugié soient bien informées de la situation dans le pays d'origine des demandeurs, en particulier en ce qui concerne la condition des homosexuels et les persécutions dont ils pourraient faire l'objet de la part d'agents de l'Etat ou d'autres tiers;
d. de revoir leur politique en matière de droits sociaux et de protection des migrants de manière à ce que les couples et les familles homosexuels soient traités selon les mêmes règles que les couples et les familles hétérosexuels;
e. de prendre les mesures requises pour que les couples homosexuels binationaux bénéficient des même droits en matière de résidence que les couples binationaux hétérosexuels;
f. d'encourager la création d'organisations non gouvernementales de défense des droits des réfugiés, des migrants et des couples binationaux homosexuels;
g. de coopérer plus étroitement avec le HCR et les organisations non gouvernementales nationales, de les encourager à travailler en réseaux et de leur demander d'effectuer un suivi systématique du respect des droits des homosexuels des deux sexes en matière d'immigration et d'asile;
h. de veiller à ce que les agents des services de l'immigration en contact avec des demandeurs d'asile et des couples homosexuels binationaux soient formés à prendre en considération la situation spécifique des homosexuels et de leurs partenaires.
II. Exposé des motifs par Mme Vermot-Mangold
1. Introduction
1. Le présent rapport résulte des préoccupations suscitées par le fait que dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, les instruments juridiques relatifs à l'asile et à l'immigration opèrent une discrimination à l'égard des homosexuels et des couples homosexuels. De surcroît, les dispositions applicables aux couples homosexuels en matière d'immigration diffèrent d'un pays à l'autre. Le présent rapport examine les législations et les pratiques en ce domaine et présente des recommandations visant à renforcer le respect des droits de l'homme des homosexuels en matière d'asile et d'immigration.
2. Le rapport s'appuie notamment sur les réponses à un questionnaire qui a été adressé aux organisations internationales et non gouvernementales concernées dans la plupart des Etats membres. Il tient compte également des conclusions de l'audition sur la situation des lesbiennes et des homosexuels dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qui a été organisée le 14 octobre 1999 par la Sous-commission des droits de l'homme de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme et à laquelle le rapporteur a pris part.
3. Le sujet traité ici ne peut être examiné indépendamment de la situation juridique des homosexuels et des lesbiennes dans les Etats membres du Conseil de l'Europe en général. Cette question fait l'objet d'une analyse approfondie dans le rapport présenté au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Afin d'éviter les répétitions, l'élaboration du présent rapport a été coordonnée avec les travaux du rapporteur de cette commission.
4. Le rapporteur tient à exprimer toute sa gratitude à l'Association internationale des gays et des lesbiennes pour l'assistance qu'elle lui a apportée dans la préparation du présent rapport.
2. Aperçu général de la situation
5. Toute personne vivant dans un pays a un rôle à jouer dans la collectivité, et devrait pouvoir développer pleinement son potentiel dans l'intérêt de la société qu'elle a choisie, y compris en matière de droits sociaux et politiques. Tous ceux qui résident dans un Etat européen, qu'ils en soient ou non ressortissants, devraient jouir d'un droit garanti à l'égalité de traitement et du respect de leurs traditions, de leur mode de vie et de leurs relations. Ils devraient également bénéficier d'une protection juridique contre la discrimination pour des motifs de race, de couleur, de religion, d'origine ethnique ou d'orientation sexuelle.
6. Les réfugiés devraient pouvoir demander l'asile en Europe sur la base d'une évaluation objective de leur situation, conformément aux principes énoncés dans les conventions internationales. Les individus de pays différents engagés dans une relation affective stable devraient pouvoir vivre avec leur partenaire indépendamment de leur sexe ou de leur situation de famille.
7. L'Europe doit de toute urgence admettre que la persécution en raison de l'orientation sexuelle justifie l'octroi de l'asile. Plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe (l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni) reconnaissent déjà ouvertement dans leur législation ou dans leur pratique en matière d'asile que les homosexuels et les lesbiennes appartiennent à un «certain groupe social», selon les termes de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, ou ont accordé l'asile à des homosexuels et des lesbiennes pour des raisons «humanitaires». A cet égard, la notion de persécution devrait inclure celle que pratiquent l'Etat et les entités non-étatiques, ainsi que l'exclusion sociale acharnée et les atteintes à l'intégrité physique qui sont le fait de la famille ou de la société.
8. La persécution en raison de l'orientation sexuelle est un phénomène répandu et tout aussi révoltant et préjudiciable dans certains pays que la persécution pour des motifs de religion ou d'opinions politiques. Depuis 1991, et après dix ans d'intense pression de la part de lesbiennes et d'homosexuels au sein et en dehors de l'organisation, Amnesty International considère les prisonniers persécutés pour leur seule homosexualité comme des prisonniers d'opinion.
9. Les politiques d'immigration de la plupart des Etats membres sont nettement discriminatoires à l'égard des couples homosexuels, parfois confrontés à la douloureuse expérience de la séparation ou de l'expulsion, quand l'un des deux partenaires n'est pas citoyen du pays. Seuls la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni ont reconnu les relations homosexuelles dans le cadre de l'immigration.
10. Certaines de ces réglementations apportent des restrictions considérables à la reconnaissance des relations homosexuelles, restrictions qui ne s'appliquent habituellement pas, dans des situations similaires, aux couples mariés. Ainsi, elles peuvent exiger que la relation ou la cohabitation soit établie depuis plusieurs années.
3. L'asile: base juridique
11. Selon l'article 1.A.2 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par son protocole de 1967, le terme «réfugié» s'applique à toute personne «qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle (...), ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner».
12. Selon une récente étude des tendances en matière de persécution liée au sexe, publiée par le HCR, dans le cas de poursuites engagées contre des individus en raison de leur homosexualité, les peines infligées aux personnes s'écartant des normes ou des lois sociales sont considérées comme des mesures de persécution par certains tribunaux. Dans plusieurs pays, les homosexuels se voient infliger des sanctions pénales sévères et/ou subissent une discrimination et une hostilité publique extrêmes à cause de leur orientation sexuelle. Les tribunaux ont statué que lorsque ces peines sont excessives ou infligées à une personne pour l'un des motifs spécifiés par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, elles peuvent être assimilées à de la persécution, en vertu de cette convention. Depuis 1988, voire avant, plusieurs Etats ont accordé une sorte de «statut humanitaire» à ces femmes et à ces hommes en raison de leur homosexualité. Le statut de réfugié leur est aussi accordé par certains Etats conformément à la Convention de 1951. Cette protection émane du droit à la non-discrimination, énoncé dans la plupart des textes internationaux sur les droits de l'homme.
13. Toujours selon l'étude du HCR, l'une des questions principales que pose la revendication homosexuelle du statut de réfugié est de savoir si les préjudices et les peurs dont souffrent les intéressés doivent être considérées comme de la persécution. Aux Etats-Unis, l'instance d'appel en matière d'immigration a déclaré que l'on devait accorder le statut de réfugié à un homme qui avait été détenu, interrogé périodiquement et soumis à une série d'examens physiques par les autorités parce qu'il était homosexuel. Dans cette affaire, elle a estimé que la détention répétée à des intervalles réguliers (pendant plusieurs jours parfois), associée à des mauvais traitements physiques et verbaux, constituaient un cas de persécution. En outre, l'ultimatum posé au requérant, qui devait soit quitter le pays soit passer quatre années en prison en raison de son homosexualité, a amené l'instance d'appel à la conclusion que sa liberté était menacée et que sa peur, induite par la persécution, était légitime.
14. Le HCR explique également que depuis ces précédents, le Service de l'immigration et de la naturalisation des Etats-Unis a accordé l'asile à plusieurs homosexuels. Tel a été le cas notamment, le 18 octobre 1995, pour une Iranienne qui aurait été persécutée en raison de son militantisme homosexuel et féministe si elle avait été renvoyée dans son pays, où le gouvernement adhère à une interprétation stricte de l'islam d'après laquelle les homosexuels sont passibles de la peine de mort. D'autres pays ont pris des décisions semblables, et notamment la Nouvelle-Zélande: la décision du 30 août 1995 de l'instance d'appel en matière de statut des réfugiés a accordé ce statut à un homosexuel à partir d'informations sur son pays d'origine selon lesquelles les peines infligées à des homosexuels ou à des personnes suspectées ou accusées de l'être étaient extrêmement lourdes. L'instance d'appel concluait qu'il fallait reconnaître que la peur du requérant était effectivement liée à la persécution.
15. De telles affaires impliquant des homosexuels, selon l'étude du HCR, ont montré que le droit en soi pouvait être un facteur de persécution. Certains tribunaux ont établi que l'obligation de se conformer aux normes pour éviter des poursuites était assimilable à de la persécution. En 1983, dans une affaire concernant un Iranien, le Tribunal administratif allemand de Wiesbaden a annulé la décision du Bureau fédéral sur les réfugiés, selon laquelle le requérant pouvait éviter la persécution en cachant son homosexualité au Gouvernement iranien, et vivre en paix dans son pays. Le tribunal a jugé qu'il était aussi inacceptable de dire à un demandeur d'asile homosexuel qu'il pouvait éviter la persécution en menant une vie discrète (voire secrète) et prudente, que de suggérer à une personne de renier ses croyances religieuses ou de changer la couleur de sa peau.
A. L'orientation sexuelle comme motif d'«appartenance à un certain groupe social»
16. Dans le processus de détermination du statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et de son protocole de 1967, le motif de l'«appartenance à un certain groupe social» n'a pas été facile à définir. Selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, qu'a édité le HCR, «par "un certain groupe social", on entend normalement des personnes ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La crainte d'être persécuté du fait de cette appartenance se confondra souvent en partie avec une crainte d'être persécuté pour d'autres motifs, tels que la race, la religion ou la nationalité».
17. Comme l'explique l'étude du HCR citée précédemment, cette notion a été ajoutée aux motifs de persécution énumérés dans la Convention de 1951 par la délégation suédoise à la Conférence de plénipotentiaires. Selon cette délégation, l'expérience montrait que certains réfugiés avaient été persécutés en raison de leur appartenance à un groupe social. Le projet de convention ne prévoyait pas ce cas, et il fallait y remédier par une nouvelle disposition. Contrairement à d'autres éléments de la définition du terme «réfugié», ce point a suscité des discussions permanentes et donné lieu à une jurisprudence variée, qui continue à se développer.
18. Une récente étude menée par le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE) explique que le débat académique en la matière tourne autour de trois approches, à savoir:
«a. l'approche inclusive, selon laquelle les rédacteurs de la Convention de 1951 voulaient inclure toutes les personnes qui ne correspondaient à aucune des quatre autres catégories de la définition dans la catégorie «groupe social», qui servirait alors de «filet de sécurité»; cette approche nécessite une interprétation globale et libérale de la catégorie «groupe social»;
b. l'approche exclusive, selon laquelle le groupe social ne peut, en soi, constituer une catégorie mais devrait être envisagé par rapport aux autres catégories données dans la définition; cette approche tend à la mise en place de tests d'éligibilité.
c. l'approche médiane, selon laquelle la catégorie «groupe social» était censée avoir une signification, sans toutefois être un «fourre-tout».
19. La jurisprudence montre que les homosexuels sont considérés comme constituant un groupe social. L'analyse du HCR, déjà citée, fait référence à l'affaire Toboso-Alfonso, dans laquelle l'instance américaine d'appel en matière d'immigration a annulé une décision selon laquelle un comportement socialement perverti (telle était sa définition de l'homosexualité) ne suffisait pas pour conclure à l'existence d'un groupe social. Elle a souligné que le requérant n'était pas persécuté pour une activité particulière mais plutôt en raison de sa situation d'homosexuel. Cependant, elle a insisté sur le fait que la reconnaissance de l'homosexualité comme une caractéristique immuable n'était pas contestée.
20. Le HCR fait aussi remarquer que les autorités allemandes ont admis que les homosexuels peuvent constituer un groupe social, en raison de leur statut minoritaire et dénigré par la société. Le tribunal administratif de Wiesbaden a déclaré que l'existence d'un groupe social était établie dès lors que cet ensemble d'individus constituait un groupe jugé inacceptable par la population globale. Considérant les étiquettes péjoratives attachées aux homosexuels, les préjugés dont ils sont les victimes et le traitement destructeur qui leur est infligé en Iran et dans de nombreuses autres sociétés, le tribunal a conclu que les homosexuels constituaient un groupe social en vertu de la Convention de Genève.
21. En 1993, la Cour suprême canadienne, dans l'affaire ministère public contre Ward, a déclaré que les individus redoutant la persécution motivée par le sexe, les origines linguistiques et l'orientation sexuelle pouvaient constituer un «certain groupe social», défini par une caractéristique innée ou immuable, aux fins de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
22. En 1999, au Royaume-Uni, dans Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department, Regina v. Immigration Appeal Tribunal and Another Ex Parte Shah (A.P.), la Chambre des Lords a déclaré que les homosexuels persécutés en raison de leur orientation sexuelle pouvait constituer un certain groupe social au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
23. Enfin, il y a lieu de rappeler, qu'en 1998, en France, un transsexuel algérien a acquis le statut de réfugié. La Commission des recours des réfugiés a conclu que les transsexuels étaient exposés à la persécution en Algérie, en raison de leurs caractéristiques générales et de leurs différences, et qu'ils constituaient donc un groupe social selon les termes de la définition des «réfugiés».
24. D'après l'étude déjà citée de l'ECRE, en 1996, on estimait à 700 le nombre de cas de demandes d'asile, résolus ou en suspens, à travers le monde, dans lesquels les candidats au statut de réfugié défini par la convention justifiaient leur requête basée sur l'orientation sexuelle par l'«appartenance à un groupe particulier» et/ou par des opinions politiques dissidentes. Certaines demandes ayant pour motif l'orientation sexuelle sont classées dans la catégorie «opinions politiques», bien que beaucoup d'homosexuels ne considèrent pas leur orientation sexuelle comme un élément politique. Certains universitaires pensent que des demandes pourraient être examinées sous le chapitre «religion», étant donné que le statut d'homosexuel se heurte à la doctrine religieuse conventionnelle imposée par l'Etat et les acteurs privés. Aucun cas examiné du point de vue de la religion n'a encore été recensé.
25. Toujours selon l'ECRE, les premières demandes concernant le statut de réfugié défini par la convention et présentant l'orientation sexuelle comme le facteur d'appartenance à un groupe social ont été faites au début des années 80. Elles représentent encore aujourd'hui une petite partie des demandes motivées par l'«appartenance à un certain groupe social».
26. Autre point souligné par l'ECRE, un nombre croissant d'homosexuels s'est vu accorder l'asile pour des raisons humanitaires, plutôt que le statut de réfugié défini par la convention.
27. De même, alors qu'il y a une écrasante majorité de femmes parmi les demandeurs d'asile à travers le monde, elles n'ont été que très peu à demander et à recevoir le statut de réfugié pour le motif de l'orientation sexuelle. La plupart de ces demandes ont été faites par des hommes.
28. Par ailleurs, les questions liées à l'orientation sexuelle comme facteur d'appartenance à un groupe social ont mis en lumière des problèmes tels que le droit d'asile pour des personnes séropositives et persécutées à ce titre.
29. Enfin, la non-reconnaissance par les Etats des mariages homosexuels s'est traduite par l'absence de demandes d'asile pour regroupement familial des couples d'homosexuels et de lesbiennes.
B. La légitimité de la peur de la persécution dans le cas des poursuites engagées contre les homosexuels
30. Dans une quarantaine de pays à travers le monde, les relations homosexuelles, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, demeurent illégales, tandis que dans une quarantaine d'autres pays, seules les relations homosexuelles entre hommes le sont encore. Dans 8 pays au moins la peine maximale est la mort.
31. Le rapport de l'ECRE mentionné précédemment, indique que les homosexuels sont souvent poursuivis dans leur pays d'origine. Les peines vont de l'emprisonnement (en Roumanie, de un à cinq ans pour un acte consenti et privé) à une intervention médicale forcée (en Russie par exemple) ou à l'exécution (mort par lapidation en Iran).
32. Pour certains observateurs, il est difficile d'admettre que des poursuites puissent être assimilées à de la persécution. Cependant, il a été déclaré que tel pouvait être le cas lorsque la loi, dont on dit qu'elle a été violée, est contraire aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Cette idée est parfaitement en accord avec les principes défendus par le Conseil de l'Europe.
33. A ce sujet, le Guide du HCR déclare également, aux paragraphes 59 et 60:
«Pour déterminer si les poursuites équivalent à une persécution, il faudra également se reporter aux lois du pays en question, car il se peut que la loi elle-même ne soit pas conforme aux normes admises en matière de droits de l'homme. Plus souvent, cependant, ce ne sera pas la loi mais l'application de la loi qui sera discriminatoire (...).»
«En pareil cas, compte tenu des difficultés que présente manifestement l'évaluation des lois d'un autre pays, les autorités nationales seront souvent amenées à prendre leur décision par référence à leurs propres lois nationales. En outre, il peut être utile de se référer aux principes énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui ont force obligatoire pour les Etats parties et qui sont des instruments auxquels ont adhéré nombre des Etats parties à la Convention de 1951.»
34. Dans ce contexte, par exemple, dans l'affaire Dudgeon contre Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que l'interdiction de relations homosexuelles privées entre hommes adultes capables d'un consentement valide n'était pas nécessaire dans une société démocratique à la protection de la morale, de l'ordre public et des droits d'autrui. Néanmoins, les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation quant à la réglementation du comportement sexuel, en fonction de la situation locale, par d'autres moyens que l'interdiction totale.
35. Il a en outre été établi que les lois interdisant les actes homosexuels privés violaient précisément le droit à la vie privée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme [Dudgeon contre Royaume-Uni; Norris contre Irlande; Modinos contre Chypre] et de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Toonen contre Australie].
36. Le rapport de l'ECRE estime aussi que des poursuites seraient considérées comme de la persécution si elles n'étaient qu'un simple prétexte à des peines excessives ou administrées par le biais de règles arbitraires ou inappropriées.
C. Le problème de la preuve
37. Comme le rapport de l'ECRE cité précédemment l'indique, les homosexuels rencontrent des obstacles supplémentaires quand ils doivent justifier leur demande, corroborer leur crainte de la persécution et soumettre des éléments de preuve. Il leur est souvent impossible de fournir des documents suffisants pour soutenir leurs allégations de persécution. Au Royaume-Uni, par exemple, un réfugié a dû subir un examen anal, effectué par un médecin, pour que le juge puisse déterminer si oui ou non il était homosexuel. En raison de l'insuffisance d'informations sur la persécution des homosexuels fournies par les principaux groupes de défense des droits de l'homme, ainsi que d'une méfiance générale des tribunaux à l'égard des informations communiquées par les organisations homosexuelles, il est assez difficile pour les homosexuels de donner des preuves fiables de persécution. La représentation en justice pour le bien public est insuffisante. Le fait que les systèmes décisionnels accordent souvent aux juges une marge d'appréciation signifie que les décisions peuvent être influencées par des préjugés à l'encontre de groupes politiquement ou socialement impopulaires.
4. Les pratiques des Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'asile
38. Les réponses au questionnaire du rapporteur, envoyé à des organisations internationales et non gouvernementales concernées de la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, révèlent que les pratiques d'octroi du droit d'asile aux homosexuels et aux lesbiennes varient beaucoup selon les pays.
39. Il semble en effet que certains Etats membres ont accordé l'asile à des homosexuels et à des lesbiennes d'autres Etats membres, comme la Roumanie et la Russie, pour cause de persécution. Si l'attitude des Etats d'accueil est louable, la situation générale laisse à désirer: les Etats membres du Conseil de l'Europe devraient harmoniser leurs politiques, conformément aux «bonnes pratiques», notamment dans le cas de questions relatives aux droits de l'homme comme le statut et le traitement des homosexuels.
5. L'immigration
40. Comme dans le cas de l'asile, les politiques et pratiques des Etats membres diffèrent beaucoup, quant au statut des homosexuels en matière d'immigration. Les droits des partenaires à cet égard ont habituellement pour fondement juridique l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Mais la définition de la famille intervient également. Dans de nombreux Etats membres, les relations homosexuelles sont ignorées ou font l'objet d'une discrimination.
41. Pour remédier à ces formes de discrimination, il importe que chaque Etat membre adopte des dispositions particulières sur la reconnaissance des relations homosexuelles dans le cadre des lois sur l'immigration, et que lesdites relations soient reconnues juridiquement dans toute l'Europe. Pour que la liberté de circulation soit la même pour tous, les partenaires de même sexe doivent être considérés comme des membres d'une famille tant en droit national qu'en droit international.
42. Dans la plupart des Etats membres, l'immigration au titre du regroupement familial n'est autorisée que pour les couples hétérosexuels légalement mariés. Certains Etats membres ont une interprétation de ce qui constitue une relation, plus étroite pour les migrants que pour leur propre population, ce qui est une pratique fortement discriminatoire.
43. Cependant, dans un certain nombre de pays, il y a eu ces dernières années des changements très positifs quant à la reconnaissance des droits de séjour de couples binationaux. Des lois sur les partenariats enregistrés au Danemark, en Islande, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède permettent toutes aux couples binationaux (dont l'un des partenaires est ressortissant du pays) de jouir des mêmes droits de séjour que les couples mariés. Nombre de ces pays ont aussi des réglementations distinctes qui permettent aux partenaires binationaux engagés dans une relation homosexuelle stable mais non enregistrée officiellement d'obtenir un droit de séjour pour le partenaire étranger.
44. Aux Pays-Bas, le partenaire étranger d'un citoyen de l'Union Européenne résidant dans ce pays, ou d'un ressortissant étranger ayant obtenu le statut de réfugié, peut s'établir aux Pays-Bas. En Suède, dans le cadre d'une proposition devant prendre effet le 1er mars 2000, les couples homosexuels non suédois qui vivent en Suède depuis plus de deux ans pourront se faire enregistrer en vertu de la loi sur le partenariat enregistré.
45. D'autres Etats membres prennent aussi des dispositions pour que les couples homosexuels binationaux soient autorisés à résider ensemble. En Finlande, les agents des services d'immigration ne font pas de distinction entre les couples hétérosexuels et homosexuels vivant maritalement. Ces couples doivent prouver qu'ils vivent ensemble depuis au moins un an pour pouvoir prétendre à un permis de séjour. Au Royaume-Uni les couples homosexuels doivent prouver qu'ils vivent ensemble depuis deux ans, alors qu'en Belgique, les permis de séjour pour une durée illimitée ne sont accordés qu'au terme de trois ans et six mois de cohabitation.
46. L'Allemagne a aussi un peu évolué dans le bon sens. En 1996, le Tribunal administratif de Berlin a décidé que les autorités chargées de l'immigration bénéficieraient d'une certaine marge d'appréciation pour l'octroi des cartes de séjour et, la même année, le Tribunal administratif supérieur de Münster a déclaré qu'en vertu de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le partenaire de nationalité étrangère d'un couple homosexuel, dont la relation était ancienne, pouvait se voir accorder une carte de séjour. Cependant, malgré cette évolution, les permis de séjour ne sont accordés aux couples binationaux qu'avec la plus grande parcimonie, peu de couples remplissant les conditions et le partenaire étranger, s'il est assez chanceux pour obtenir une carte de séjour, se trouvant dans l'incapacité d'exercer un emploi.
6. Conclusions
47. La situation actuelle, qui laisse à désirer, pourrait être améliorée si la persécution pour homosexualité était considérée comme un motif justifiant l'octroi de l'asile. Il faudrait en outre que l'on reconnaisse que les relations homosexuelles devraient être traitées selon les mêmes règles que les relations hétérosexuelles pour ce qui est des lois et des politiques sociales dans le domaine de l'immigration. Le Comité des Ministres devrait définir des principes directeurs précis et les agents des services de l'immigration recevoir une formation appropriée.
48. Il serait bon que les Etats membres du Conseil de l'Europe reconsidèrent le traitement réservé aux homosexuels en matière d'asile et d'immigration et que l'harmonisation des lois et politiques de ces Etats en ce domaine soit accélérée.
49. Les organisations non gouvernementales défendant les droits de l'homme des homosexuels doivent être soutenues et encouragées.
Commission chargée du rapport: commission des migrations, des réfugiés et de la démographie.
Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant.
Renvoi en commission: Doc. 7864 et Renvoi n° 2209 du 22.09.97
Projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 19 novembre 1999.
Membres de la commission: M. Díaz de Mera (Président) (remplaçant: Fernandez Aguilar), M. Iwinski, (Vice-Président), Mme Aguiar, MM. Akselsen, Amoruso (remplaçant: Olivo), Mme Arnold, MM. Atkinson (remplaçant: Hancock), Aushev, Mme Björnemalm, MM. Bogomolov, Bösch, Brancati (remplaçant: Brunetti), Branger, Mme Bušic, MM. Chiliman, Chitaia, Christodoulides, Chyzh, Cilevics, Connor, Debarge, Mme Dumont, M. Einarsson, Mme Err, Mme Fehr, MM. Filimonov, Frimannsdóttir, Ghiletchi, Hrebenciuc (remplaçant: Paslaru), Ivanov, Jakic, Lord Judd, Mme Karlsson, MM. Koulouris (remplaçant: Mme Katseli), Kozlowski, Laakso, Lauricella, Liapis, Luís, Mme Markovska, MM. Mateju, Melo, Minkov, Moreels, Mularoni, Mutman, Ouzky, Pullicino Orlando, Rakhansky, Mme Rastauskiené, Mme Roth, MM. von Schmude, Szinyei, Tabajdi, Tahir, Telek, Thönnes, Tkác, Vanoost, Verhagen, Mme Vermot-Mangold, M. Wray (remplaçant: Lord Ponsonby), Mme Zwerver, N….. (Remplaçant: Mme Guirado, Vice-Présidente).
N.B. Les noms des membres présents à la réunion sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission: M. Newman, Mme Nachilo, M. Adelsbach.
Copyright Gais et Lesbiennes Branchés © 1999
Last modified: Thu Mar 23 19:03:35 MET 2000