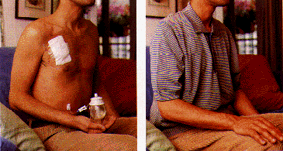
Les personnes qui le souhaitent peuvent apprendre à effectuer elles-mêmes leurs perfusions (ou celles d'une personne proche). Cet apprentissage doit s'effectuer sous le contrôle d'un(e) infirmier(e) maîtrisant parfaitement la technique, car il faut respecter des précautions d'asepsie rigoureuses (l'asepsie est l'absence de microbes, de bactéries), afin d'éviter l'infection du cathéter. Nous n'abordons pas ici le détail de la procédure de soins mais proposons quelques conseils pratiques :
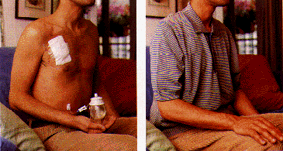
Perfusion avec un diffuseur portable. Photo de gauche : dans la main. Photo de droite : dans la poche. Léger et discret. On peut se déplacer, sortir de chez soi, travailler, aller au cinémaä pendant la perfusion.
- C'est au patient, et non à l'infirmière, de décider s'il souhaite ou non apprendre à manier lui-même son cathéter. Cependant, cela exige une certaine habileté manuelle et l'apprentissage peut être plus ou moins long. Certains patients n'y parviennent pas : dans ce cas, mieux vaut laisser faire l'infirmière. D'autres demandent à cette dernière de brancher la perfusion, et savent la débrancher seuls. D'autres enfin maîtrisent ces opérations mieux que les professionnels. Signalons que les laboratoires Braun (qui fabriquent les chambres implantables Celsite®) envoient gratuitement une cassette vidéo et un livret expliquant l'utilisation de ce type de cathéter. (La demande doit passer par l'infirmière ou le médecin) (1).
- Choisir chez soi un espace où l'on peut confortablement effectuer la manipulation du cathéter. L'endroit où l'on pose le matériel de soins doit être très propre.
- Prendre son temps. Pour une personne entraînée, la mise en place d'une perfusion prend une dizaine de minutes (et environ cinq minutes pour dépiquer, après la perfusion). Mais, pour un débutant, compter une demi-heure (et parfois plus). Faire en sorte de ne pas être dérangé pendant ce temps (débrancher le téléphone, éloigner le chatä). Personne ne doit fumer dans la pièce pendant les soins (les particules de fumée peuvent apporter des bactéries sur le matériel de soin).
- Si un jour on ne se sent pas capable de bien réaliser la mise en place de la perfusion, mieux vaut s'abstenir (et se reposer un moment). Au besoin, appeler l'infirmière pour qu'elle se charge de cet acte. Il est préférable de retarder la perfusion de quelques heures, plutôt que de risquer une infection du cathéter, à cause d'une erreur de manipulation.
- Avant de manipuler le cathéter, il faut toujours retirer bagues et bracelets et bien se laver les mains et les avant-bras, avec un savon antiseptique (Bétadine® rouge ou savon à la chlorexhidine : Hibitane®). Ce lavage des mains est indispensable, même si, ensuite, on enfile des gants stériles (il faut en mettre pour toutes les manipulations portant directement sur le cathéter). Mettre aussi une bavette (un masque en papier, qui couvre le nez et la bouche). En effet, par le souffle ou par la parole, des bactéries peuvent être projetées sur le matériel de soin. Si c'est un soignant ou un proche qui s'occupe du cathéter, il doit porter une bavette et le patient aussi. Enfin, pour la désinfection de la peau, l'alcool n'est pas assez efficace. Utiliser de la Bétadine® jaune (la laisser ensuite sécher 30 secondes environ).
- Si la peau, autour du cathéter, est rouge, gonflée ou douloureuse, ne pas faire la perfusion. Appeler l'infirmière ou le médecin. Il peut s'agir d'une infection ou d'une thrombose (la veine dans laquelle aboutit le cathéter est bouchée par un caillot de sang).
- L'infection du cathéter peut aussi être révélée par d'autres symptômes, comme une forte fièvre ou des frissons lors de la perfusion ou du rinçage du cathéter. En de tels cas, ne pas effectuer d'autre perfusion : on risque d'augmenter la quantité de bactéries qui passent dans le sang. Appeler rapidement son médecin (voir article sur les urgences dans ce numéro). Une infection du cathéter nécessite un traitement antibiotique. Mais elle peut parfois imposer le retrait du cathéter. Dans ce cas, après traitement de l'infection, il sera possible d'en mettre un nouveau en place.
- Bien respecter le protocole de soins élaboré avec l'infirmière. On peut se faire une liste de tout le matériel dont on a besoin, pour éviter les oublis. Si l'on pense avoir fait une « faute d'asepsie » (avoir apporté des microbes sur un matériel qui doit rester stérile (= sans microbes)), mieux vaut interrompre la manipulation. Il est souvent préférable de s'arrêter un moment, puis de recommencer au début, avec un nouveau set (emballage contenant le matériel nécessaire à un soin : gants, seringues, aiguilles, bavettes, compressesä).
- Si l'on a un cathéter à chambre implantable, pour que la peau puisse cicatriser, éviter de piquer toujours au même endroit (si nécessaire, on peut tirer un peu sur la peau). On peut laisser l'aiguille piquée dans la chambre pendant quelques heures, voire une journée, afin d'éviter d'avoir à repiquer. Mais il ne faut pas la laisser pendant plusieurs jours : cela comporte un risque d'infectionä et fait perdre tout intérêt au cathéter à chambre implantable (mieux vaut alors avoir un cathéter à émergence cutanée).
Certains soignants laissent l'aiguille en place, par crainte de se piquer en l'ôtant (avec les chambres implantables, il peut y avoir un « effet rebond » à ce moment-là). Signalons que le Geres (Groupe d'étude sur les risques d'exposition au sang) (2) informe (gratuitement) sur les techniques et les matériels destinés à éviter les accidents par piqûre. Un dispositif destiné à protéger la main a été mis au point par l'HAD de l'hôpital Pitié-Salpétrière (3). Par ailleurs, les laboratoires Vygon® commercialisent un dispositif de protection à usage unique, le Digiprotect® (8 à 11 F pièce, non remboursé) (4).
- Après la fin d'une perfusion, toujours rincer le cathéter avec 10 ou 20 ml de chlorure de sodium à 0,9 % stérile (« sérum physiologique » stérile), avant d'y injecter quelques ml d'héparine diluée. (L'héparine évite que du sang ne coagule dans le cathéter et le bouche). Certains modèles récents de cathéters n'ont pas besoin d'être héparinés, mais il faut néanmoins les rincer au « sérum physiologique » stérile.
- Il est possible d'effectuer les prises de sang sur le cathéter. Mais il faut respecter les précautions d'asepsie : lavage des mains, gants stériles, désinfection du site de piqûreä (sinon, mieux vaut être piqué dans une veine du bras). Il faut ensuite rincer et hépariner le cathéter. Sinon, le sang risque d'y coaguler et de le boucher. Pour la même raison, pendant une transfusion, il faut rincer le cathéter tous les deux concentrés globulaires, ainsi qu'à la fin de la transfusion.
- Certains médicaments ne doivent pas être mélangés : ils risquent de précipiter (de se solidifier brusquement) et de boucher définitivement le cathéter. Pour éviter ce problème, toujours injecter les médicaments séparément, après avoir rincé le cathéter au sérum physiologique stérile.
- Lorsqu'un cathéter est bouché, c'est, la plupart du temps, parce qu'un caillot de sang s'y est formé. Ne jamais « pousser » (avec une seringue contenant du sérum physiologique ou de l'héparine) : la pression risque de fissurer ou de rompre le tuyau du cathéter. Le fragment brisé part dans la circulation sanguineä La seule méthode efficace consiste à injecter (doucement) dans le cathéter un ou deux millilitres d'une solution d'Urokinase® (qui n'est disponible que dans certains services spécialisés). Ce médicament dissout le caillot. Il faut le laisser agir dans le cathéter entre 30 minutes et 24 heures, selon les cas. Si, après cela, le cathéter reste bouché, c'est probablement dû à une autre cause.
- Il arrive parfois qu'un cathéter à émergence cutanée glisse et se déplace. Ne jamais essayer de le remettre en place : cela entraînerait un important risque d'infection. Faire une radio : si le cathéter est resté dans la veine, on peut encore l'utiliser, de manière temporaire. S'il n'y est plus, il ne faut pas s'en servir. Dans les deux cas, il faut en parler à son médecin.
- En conclusion : Effectuer soi-même ses perfusions (ou celles de la personne avec qui l'on vit) permet une plus grande autonomie. Cependant, cela reste un acte délicat et il ne faut pas hésiter à appeler l'infirmière ou le médecin, lorsqu'on rencontre une difficulté.
1 - Braun-Celsa Tél. : 49 62 76 00, Demander Mme Cholet ou M. Gautier.
2 - Geres : Faculté de médecine Bichat. 16 rue Henri Huchard. BP 146. 75870 Paris Cedex 18, Tél. : (1) 44 85 61 83
3 - HAD Pitié-Salpétrière, Tél. : (1) 42 16 08 50.
4 - Laboratoires Vygon : 5-11 rue Adeline. BP 7. 95440 Écouen, Tél. : 39 92 63 63.
Les diffuseurs portables (Baxter®, Zambon®ä) sont des flacons de plastique qui remplacent le matériel de perfusion classique (pied métallique et flacons de verre). On remplit le diffuseur avec le médicament puis on le branche sur le cathéter. On peut alors le mettre dans sa poche, ce qui permet de se déplacer, et même de sortir de chez soi. On le débranche dans l'heure qui suit la fin de la perfusion (il faut rincer et hépariner, comme après la fin d'une perfusion classique).
Avec le Cymévan®, pas de problème. En revanche, le Foscavir® impose une hydratation, pour protéger le rein. Elle se fait habituellement par perfusion, avec 500 ml à 1 litre de sérum physiologique. Les flacons de verre restent donc nécessaires. Cependant, pour éviter cet inconvénient et permettre l'utilisation des diffuseurs portables, certains médecins proposent à leurs patients de boire beaucoup d'eau (avant, pendant et après la perfusion ; 2 à 3 litres par jour). Un essai est actuellement en cours (à La Pitié-Salpétrière, à Paris), pour s'assurer que cette méthode est fiable.
Pour remplir ces diffuseurs portables, il faut respecter les précautions d'asepsie. On peut préparer les diffuseurs de Cymévan® d'avance, pour quelques jours (ou demander à l'infirmière de le faire). Il est conseillé de les mettre au réfrigérateur (où le produit reste stable 15 jours). En revanche, le Foscavir®, une fois préparé, ne se garde que 24 heures, à température ambiante (ne pas le mettre au réfrigérateur).
Le matériel nécessaire à l'utilisation du cathéter (compresses, seringues, diffuseurs portablesä) est remboursé par la Sécurité sociale sur la base d'un forfait (le TIPS). Certaines pharmacies pratiquent des prix nettement supérieurs au TIPS. La différence reste alors à la charge du patient !
Les personnes en HAD (hospitalisation à domicile) ne sont pas confrontées à ce problème, puisque le matériel leur est fourni. Il faut parfois insister pour obtenir des diffuseurs portables (en raison de leur prix). Mais c'est tellement plus pratique !
Les personnes qui ne sont pas en HAD peuvent faire appel à des sociétés qui livrent le matériel à domicile. Le patient ne paye rien (l'entreprise se fait rembourser par la Sécurité sociale). On peut se renseigner auprès de ces sociétés, pour connaître la procédure à suivre et les services proposés (récupération gratuite des déchets, formation à l'utilisation du matériel, livraison des médicamentsä). Signalons que Caremark et West Home Care Medical livrent aussi les compléments alimentaires.
Voici une liste (non exhaustive) de ces sociétés :
* Caremark : Parc Burospace 14. 91572 Bièvres Cedex. Tél. : (1) 69 33 79 33 ou Tél. : (1) 69 33 79 00. France entière.
* Orkyn : 6-8 rue Robespierre. 93130 Noisy le Sec. Tél. : (1) 48 10 64 70. France entière.
* West Home Care Medical : 1 rond-point des Bruyères BP 101. 76300 Sotteville-lès-Rouen. Tél. : 32 81 97 81 (agence de Paris Tél. : (1) 44 95 14 26). Normandie et Paris. Développement national en cours.
* VitalAire Région Centre : Parc d'activité Adéis (ZI d'Ingré). 15 rue Pierre et Marie Curie 45140 St-Jean de la Ruelle. Tél. : 38 52 24 20. Sur les autres régions, l'activité de VitalAire concernant l'infection à VIH est en développement. VitalAire France Tél. : (1) 46 93 03 75.
* AMMA : 170 rue Henri Barbusse 95103 Argenteuil.Tél. : (1) 39 61 11 35. (Livre en région parisienne. Envoie en Colissimo sur toute la France)
* AMSD : 6 allée Pauline. 78150 Rocquencourt. Tél. : (1) 39 66 08 63. (Livre en région parisienne. Envoie en Colissimo sur toute la France).
Nous écrire