![[Documents]](../../../common/logo-docu-100x100f.gif)
conférence
sur la discrimination
liée à l'orientation sexuelle
7 avril 2001
-
parentalitéS, nouveaux droits
-
table-ronde n°2
Ce compte-rendu a été réalisé par Yannis Delmas, des Gais et Lesbiennes Branchés, pour la France Gaie et Lesbienne, à partir des notes en séance. Il se veut fidèle mais les propos ici rapportés n'engagent pas les intervenants signalés.
La table-ronde est animée par Christian Dubs, de la Coordination Interpride France.
Homoparentalité : le militantisme de l'APGL conjugue l'exigence de l'égalité des droits et l'ouverture au dialogue.
Eric Dubreuil
co-président de l'APGL
(Association des Parents et futurs parents Gais et Lesbiens)
L'APGL a été fondée en 1986. Elle compte environ 1300 membres sur 11 antennes régionales. Elle repose sur deux principes politiques : l'égalité de tous les citoyens, la protection identique de tous les enfants. Elle lutte contre 2 types de discriminations : à l'adoption et en cas de séparation. Ses propositions sont maintenant largement reprises par les associations homos et par les Verts.
Pour l'APGL, la forme est aussi importante que le fond : il s'agit plus d'argumenter que de défendre. Il s'agit de propositions et non de demandes. Cette forme s'est développée face à divers types de résistances : internes (homos opposés à la parentalité homo) ou externes ("hors-norme", "projet d'avenir impossible"). L'association privilégie au maximum le dialogue avec les personnes de points de vue opposés (mais pas viscéralement), ce qui se traduit par de larges invitations aux soirées de réflexion.
L'intervention se place aussi bien sur le plan de l'objectivité que de la subjectivité, notamment chez les médias : il faut faire céder les peurs pour laisser parler les coeurs. Ce type d'approche est qualifié de « radicalisme dialoguant ». Il nécessite une écoute respectueuse des parties en présence. Pour faire face aux préjugés, il réserve une large part à l'observation de la réalité.
- Bibliographie :
- Eric Dubreuil, Des parents du même sexe, Éditions Odile Jacob, 1998.
- Site web :
- Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
Homophobie et homoparentalité.
Flora Leroy-Forgeot
juriste, chargée de cours pour les Universités de Paris XIII
et Reims
Dans le domaine de l'homoparentalité on distingue trois grands types de freins : l'homophobie issue d'une culture juridique homophobe, la méconnaissance de la réalité de l'homoparentalité, la corrélation entre unions légales et droits parentaux.
Après une dépénalisation de l'homosexualité à la fin du 18e siècle, la discrimination apparaît sous le Régime de Vichy et perdure jusqu'en 1982. Le contexte idéologique se continue pourtant.
Malgré des études scientifiques, la méconnaissance reste. L'idée est celle de la menace issu de l'homosexualité d'un parent : longtemps l'homosexualité a été considérée comme une sorte de maladie. Les études ne montrent pourtant aucune spécificité quand il y a un parent homosexuel. Il s'agit plus d'un principe de précaution que d'une connaissance de réalité. L'homophobie est alors au terme de la procédure de décision plus qu'en son origine.
Le droit instaure une corrélation entre union légale et parentalité : il ne peut y avoir parentalité que s'il y a union légale ferme, par opposition à l'union sociale, sans effet juridique. L'union légale intervient même d'abord pour la transmission du patrimoine. Par réflexe anthropologique, l'extension de cette corrélation peut entraîner des décisions dépassant la lettre de la loi. On voit ainsi des appels excessifs aux références « paternelle » ou « maternelle » définies par la psychanalyse, hors de tout cadre juridique. On fait ainsi souvent référence à de l'homoparentalité sans tenir compte à la co-parentalité, alors que c'est le modèle le plus fréquent en France. Les discriminations sont justifiées par une « protection » des enfants de parents homosexuels.
Actuellement en France, il y a nécessité de faire réaliser une étude sérieuse par des chercheurs professionnels et dépassant l'intermission de l'APGL, laquelle présente un obstacle épistémologique (biais statistiques).
D'un point de vue juridique, actuellement, le PACS n'est pas conçu comme une union légale permettant transmission du patrimoine et renouvellement des générations. Il faudra aussi faire évoluer cette situation.
- Bibliographie :
- Flora Leroy-Forgeot, Les enfants du pacs réalité de l'homoparentalité, L'Archer, PUF, 1999.
- Flora Leroy-Forgeot, Les unions homosexuelles, Éditions Odile Jacob, à paraître.
Les Verts et l'homoparentalité.
Francine Bavay
porte-parole des Verts
vice-présidente du Conseil Régional d'Île-de-France
La semaine précédente, les Verts ont pris la décision d'exclure toutes les discriminations dans le droit de la famille, et ce en contexte positif (PaCS) et négatif (jugement de Nancy contre l'adoption par une institutrice homo).
Il faut améliorer les droits humains non seulement en le disant mais aussi en luttant effectivement contre toutes les discriminations. Un droit humain n'existe pas plein et entier si l'on passe à coté de certains. Il vaut vérifier que toutes les spécificités sont prises en compte non pour discriminer mais pour enrichir l'universel. Chez les Verts, impulsion de la commission nationale « Gais et Lesbiennes chez les Verts ».
Pour l'adoption, il s'agit d'agir à plusieurs niveaux. L'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme doit entendre « vie familiale » au sens large. Il faut modifier le décret sur l'adoption pour interdire l'orientation sexuelle comme condition. L'adoption pleinière par un couple, de même sexe ou non, doit être possible. L'adoption par le « second parent » est déjà possible dans une quinzaine d'états. Il faut également permettre l'adoption simple par le « parent social ».
L'objectif est celui de la protection de l'enfant en situation de famille élargie.
Au sein des Verts, débat a été large, sans unanimité, mais finalement ces positions ont été largement adoptées. Elles concernent toute la société et non seulement les droits des homos.
Homosexualités, l'adieu aux normes.
(titre provisoire)
Jacques Fortin
Commission nationale des homosexualités de la LCR
Jacques Fortin, excusé, est représenté par Pascale Berthaud, qui lit le texte préparé par celui-ci.
Les homos ne sont pas stériles, contrairement à leurs unions. Fait-on ce reproche aux couples hétéros stériles ?
Nous vivons la dictature d'une majorité sur notre parentalité après qu'elle l'a exercée sur nos enfances. Pourtant, aujourd'hui, les nouvelles parentalités, hétéros et homos, bousculent l'ordre symbolique ancien. On peut batir des loi ouvertes qui permettent aux relations de s'épanouir.
Le droit procède du peuple par décision majoritaire. Mais est-il toujours bien démocratique dans la réalité, légitime, identique pour tous ? Il faut regarder son effet formel sur chacun. Il faut penser aux exemples précurseurs : le droit de vote des femmes, l'avortement, pour ne pas confondre démocratie et imposition par une majorité de sa loi.
- Bibliographie :
- Jacques Fortin, Homosexualités. L'adieu aux normes, Textuel, 2000.
- Sites web :
- LCR
- Commission nationale des homosexualités

discussion avec la salle
Il y a 40 ans se posait la question de la transmission des valeurs par une fille-mère, il y a 25 ans par les parents divorcés, aujourd'hui par les parents homos.
La Convention de La Haye sert souvent à casser des décisions en affirmant que « tout enfant a droit à une famille », qui peut être entendu de façon restrictive. Pour l'APGL, il faut revisiter les mots « famille » et « parent » et plus se baser sur une notion d'engagement.
L'association David & Jonathan note que le débat sur l'homoparentalité est ouvert chez les cathos de gauche. Le fait que ce qu'on nomme « valeurs judéo-chrétiennes » est souvent une construction du 13e siècle est perçu.
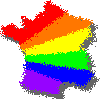 © 2001 Gais
et Lesbiennes Branchés, YD
© 2001 Gais
et Lesbiennes Branchés, YDdernière mise à jour : samedi 21 avril, 2001