![[Documents]](../../../common/logo-docu-100x100f.gif)
conférence
sur la discrimination
liée à l'orientation sexuelle
7 avril 2001
-
de la déportation des homosexuels
aux persécutions aujourd'hui
-
table-ronde n°1
Ce compte-rendu a été réalisé par Yannis Delmas, des Gais et Lesbiennes Branchés, pour la France Gaie et Lesbienne, à partir des notes en séance. Il se veut fidèle mais les propos ici rapportés n'engagent pas les intervenants signalés.
La table ronde est animée par Jean Le Bitoux, président du Mémorial de la Déportation Homosexuelle (MDH). Il rappelle, en introduction la demande du MDH de la constitution d'une commission pour valider officiellement les faits historiques. Il s'agit également de l'inscription dans les manuels scolaires. Il rappelle l'aide du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre pour le rapprochement avec la Fédération de la Mémoire sur la Déportation.
Le contexte à Berlin dans les années trente.
Les premières persécutions.
La martyrisation des lesbiennes.
Florence Tamagne
historienne, maître de conférence à l'Université
de Lille III
En Allemagne le §175 condamnait dès avant les nazi les actes contre nature entre hommes et entre Hommes et animaux. Il pouvait entraîner peines de prison et perte des droits civiques. Il s'agit d'une adoption du droit prussien par la République de Weimar. A cette époque, l'interprétation restrictive et concerne principalement les actes similaites au coït.
Le §175 est renforcé seulement en 1935 : tout acte (y compris caresses ou désir) entraîne alors la prison, jusqu'au travaux forcés. L'augmentation du nombre de condamnations est très nette entre Weimar (env. 700/an) et les Nazi (plusieurs milliers, en augmentation constante). La durée des peines augmente également sensiblement (3 mois contre plus de 3 ans).
Le contexte est aussi celui d'une augmentation de la violence, de mesures d'exception dès l'avénement des nazis en 1933. Le centre Hirschfeld est pillé en mai 1933. L'ensemble du dispositif est encore accrus après la "nuit des longs couteaux". En 1934, un bureau spécial est créé rassemblant les fichiers de police. En 1936, un second bureau s'ajoute, contre l'avortement et homosexualité. En tout près de 100 000 personnes seront fichées.
Pour autant, il ne s'agit pas tant d'éliminer les homos mais les « personnes à risques » (pédophiles, homos récidivistes, etc.). Certains sont morts en camps au titre d'une simple détention préventive. Idéologiquement, une rééducation/guérison est, en effet, considérée comme possible. Cette "rééducation" peut prendre la forme d'un camp de concentration ou du front de Russie. Le nombre de déportés pour homosexualité est peu sûr et se situe probablement entre 5 000 et 15 000.
Ces points concernes les homosexuels masculins. Concernant le lesbianisme, diverses propositions de criminalisation ont existé mais ont finalement été rejetées : le contrôle par la pression sociale est facile et on craignait alors que l'information n'entraîne le vice. En 1938, l'Anschluss crée un flou juridique dans la mesure où le lesbianisme est interdit en Autriche. Les archives manquent pour dire combien de femmes sont concernées. Dans tous les cas, comme pour les hommes, les bars et les mouvements sont fermés. On sait également qu'on existé des stratégies de survie : mariages blancs, etc. Dans les camps, les lesbiennes étaient enregistrée sous d'autres motifs : politique, asociale ou prostituées.
- Bibliographie :
- Florence Tamagne, Histoire de l'homosexualité en Europe, Éditions du Seuil, 2000.
Le statut des camps.
Les multiples martyrisations.
La fausse Libération.
L'évolution des codes pénaux.
Gerard Koskovich
historien, Centre d'archives gay de San Francisco
Les homosexuels masculins étaient présents dans les camps dès les débuts. Il sont attestés en tant que tels au moins dès 1934, 5 ans avant la « solution finale ». Par contre, la déportation homosexuelle est bien moins systématique et uniforme que pour les juifs.
A l'époque on distingue (médicalement) entre une homosexualité acquise (séduction fourvoyée) et innée (pratique coutumière, récidiviste). On considère que les premiers peuvent être réformés : par la discipline des camps, la castration, etc.
Le milieu homo hors-camps développe une stratégie de survie de la discrétion extrème. Dans les camps une marque disctinctive l'empèche : brassard jaune avec un A, numéro 175, point noir ou, finalement, triangle rose. Ceci s'insère dans le cadre d'un système plus large de signalisation systématique. C'est un système d'identification mais surtout de séparation des détenus. Les homos, sans contexte d'extermination systématique ont, néanmoins un très faible taux de survie : 60% de morts contre 41% pour les politiques et 35% pour les témoins de Jéhovah. Les principales raisons sont : fréquence de la torture, nombre trop peu important (et trop grande disparité sociale) pour tisser des réseaux de solidarité et de marché noir, expérimentations médicales fréquentes (notamment à Buchenwald), travaux pénibles et dangereux.
En 1945 la libération est tronquée. Certes, comme les autres, beaucoup ont succombé après mais certains n'ont simplement pas été libérés et ont été transférés en système pénitentiaire. En effet, le §175, version nazi, est resté en activité, considéré comme légal dans la mesure où il n'est pas spécifiquement nazi. Il ne sera aboli qu'en 1967 en RDA et 1969 en RFA. Pour cette raison, beaucoup ont choisi le silence à la sortie des camps. En 2000 seulement, l'Allemagne offre une reconnaissance symbolique par des regrets officiels et l'annulation des condamnations.
- Bibliographie :
- Gerard Koskovich, The
Nazi Persecution of Homosexuals, An Annotated Bibliography of Nonfiction
Sources in English
 ,
Internet, 1997-2000.
,
Internet, 1997-2000.
Les chemins de la reconnaissance.
Les incidents avec les fédérations de déportés.
Les derniers témoins.
Le devoir de mémoire.
Jean Le Bitoux
président du Mémorial de la Déportation Homosexuelle
Au retour des camps est créé un secrétariat d'état aux victimes de guerre. À l'époque on fait silence sur la déportation homosexuelle. En fait, de façon générale, on est peu à l'écoute des témoignages. Longtemps on ne distingue pas même entre déportation, concentration et extermination.
Les tziganes et homosexuels arriveront plus tard dans les commémoration. Au départ le contexte est celui de l'unanimisme puis la guerre froide induit une division entre associations pro- et anti-communistes, d'où de fréquentes frictions entre associations de déportés. Pour autant la condamnation est générale de la question homo.
Le mouvement homo français se réveille après mai 1968 (avant les émeutes du Stonewall). En 1972, le rapport (interdit) du FARH ouvre la question de la déportation à la suite d'un témoignage reçu en 1971. L'association des années précédentes, Arcadie, n'assurait pas de transmission de la mémoire. À l'époque les preuves sont insuffisantes par manque de travail d'historien. Les années 1970 voient les premiers dépôts de gerbes, jugés intempestif par les associations de déportés. En 1971, la gerbe déposée au mémorial de la déportation est détruite puis une grille est installée autour du jardin du mémorial. En 1972 est publié le témoignage de Heinz Heger (pseudonyme), triangle rose autrichien. Il inspirera la pièce Bent de Martin Sheerman (juif et homo). Le 8 avril 1982, les injures de l'évêque de Strasbourg qui déclare que les homos sont infirmes et doivent se considérer comme tels amènent Pierre Seel à témoigner publiquement. Les dépôts de gerbes sauvages ou semi-officiels se généralisent alors.
Au milieu des années 1990, les pouvoir publics résistent moins. L'opposition vient finalement plus de fédérations de déportés. Les gerbes sont régulièrement déposée dans une douzaine de villes. L'ambiance est souvent correcte et la presse relaye bien l'information.
- Bibliographie :
- Pierre Seel, Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel, Éditions Calmann-Lévy, 1994, écrit en collaboration avec Jean Le Bitoux, notes de J. Le Bitoux.
- Site web :
- Memorial de la Déportation Homosexuelle
Communautés juive et homosexuelle.
Négationnisme et triangles roses.
Les conditions inabouties pour une restitution historique.
Michel Celse
historien
Pour éclairer la question du déficit d'histoire de la déportation homosexuelle, on observera les différences entre le cas homo et le cas juif, mieux connu.
La déportation est d'ampleur différente : considérablement plus de juifs ont été exterminés, seule une minorité d'homos ont été condamnés. En comptant les camps, l'envoi sur le front, etc. quelques dizaines de milliers d'homosexuels, au plus, sont concernés. L'objectif est différent il s'agit plus d'éradiquer l'homosexualité que l'éliminer les homosexuels. Il n'y a donc pas eu d'internement (ni d'extermination) systématique. La logique n'est pas une logique de mort mais plus une logique de contrôle social (incluant l'extermination mais ne la visant pas. Cette logique s'applique, en théorie, aux seuls « aryens », sans réelle extension.
Le contexte est celui d'une continuité juridique de la répression de l'homosexualité. De fait, son acceptation est beaucoup plus facile par la population. Il n'y a pas eu nécessité d'un effort de propagande considérable. La doctrine intervient plus pour un transfert du plan moral au plan racial (présent encore dans la notion de « fléau social » en France). La continuité s'étend également après la guerre puisque la criminalisation perdurera, d'où l'empêchement de la remise en question.
Reste enfin l'image forte (encore aujourd'hui) d'une assimilation nazi-homos. Cette image est déjà présente avant-guerre, notamment parmi les exilés politiques. Son origine probable est une volonté de discrédit du régime nazi. Ceci est étayé par l'existence de nazis homos (Roem p.ex.) et peut-être une certaine forme de fascination sur certains homos. Concernant les camps, la question est envenimée par les violences (homo)sexuelles dans les camps : homosexualité de circonstance, viols (par les kapo en particulier), prostitution. La parole ne s'est guère libérée sur ces aspects.
Pour ces questions, les alliés extérieurs sont importants : historiens de métier, politiciens, etc. Ceci s'est fait tardivement pour les juifs et manque encore largement pour les homos.
Les discriminations actuelles
qui conduisent aux persécutions.
Jean Thébaud
Amnesty International
La discrimination est une négation au principe de dignité :
« tous les Hommes naissent égaux... »
Les personnes discriminées sont souvent considérées
comme inférieures, d'où impossibilité de revendiquer
leurs droits fondamentaux.
L'homosexualité est criminalisée dans au moins 80 pays
sur tous les continents, sous des vocables et concepts variés.
Même sans criminalisation en tant que telle, il existe souvent une
discrimination sur les âges de consentement pour relation sexuelle.
Quand il y a pénalisation de l'homosexualité, fait essentiellement
privé, la loi est aussi utilisée comme prétexte de
condamnation ad hominem sans qu'il y ait réalité
de l'acte.
Pour autant la pénalisation n'est pas forcément explicite
dans la loi. Elle peu simplement être le fait de la police.
Cette discrimination touche également la liberté d'association
ou d'expression.
La Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 est d'abord une réponse aux atrocités
du milieu du 20e siècle telles qu'on les percevaient alors. Il
n'y a pas de référence explicite à l'homosexualité
mais la forme générale de ces droits s'applique.
Autre outil important : les textes de protection et d'égalité
des femmes développent des thèmes d'égalité
de l'homme et de la femme qui peuvent également être appliqués
au domaine de la sexualité.
- Sites web :
- Amnesty International,
éditions francophones

discussion avec la salle
M. Bellini, chef du protocole au Ministère des Anciens Combattants, signale une circulaire aux préfets visant à faciliter le dépôt de gerbe après le dépôt officiel.
Michel Bujardet, LGP ÎdF, ancien président du CGL de Paris, présente une résolution du Parlement européen contre les actuelles discriminations en Namibie.
Sur la place de l'Église. Certaines associations protestantes, notamment, ont participé aux campagnes homophobes. Sous le nazisme l'homosexualité a été utilisé par le régime contre l'église, notamment couvents (souvent d'une façon extravagante, d'où l'échec des procès intentés). La position de l'Église est traditionnellement homophobe ; il n'y a donc pas eu d'émotion particulière au moment du renforcement du §175.
En Belgique existe une proposition de loi prévoyant l'invitation aux commémorations et l'inscription aux programmes scolaires.
Il existe des lois pénalisant à mort l'homosexualité. Heureusement, elles sont rarement appliquées. Dernières exécutions : 6 personnes emmurées vives en Afghanistan. Il y a également des cas en Arabie Saoudite.
Pierre Seel est mieux reçu en Allemage qu'en France. Il subit encore durement les pressions nazi et homophobe.
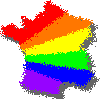 © 2001 Gais
et Lesbiennes Branchés, YD
© 2001 Gais
et Lesbiennes Branchés, YDdernière mise à jour : samedi 21 avril, 2001