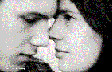En prison, pour avoir une alimentation
suffisante et ÈquilibrÈe, pour disposer des produits d’hygiËne ÈlÈmentaire, les
dÈtenus doivent souvent payer. Mais la plupart n’en ont pas les moyens. Plusieurs
associations se sont regroupÈes pour demander que les personnes emprisonnÈes puissent,
elles aussi, bÈnÈficier de droits sociaux comme le RMI. Nous publions de larges extraits
de leur dÈclaration.
Aujourd’hui, faute
de revenus, 60 % des dÈtenus vivent en France en dessous du seuil de pauvretÈ. Ceux qui
travaillent ne perÁoivent qu’un ´ salaire ª dÈrisoire. La plupart sont contraints
ý l’inactivitÈ. Beaucoup sont exclus des prestations sociales courantes et
tributaires d’aides extÈrieures extrÍmement inÈgales. Cette prÈcaritÈ propre aux
prisons achËve de rendre la vie carcÈrale dÈgradante, injuste et dangereuse : elle
menace la santÈ et l’intÈgritÈ physique des dÈtenus ; elle crÈe et renforce des
injustices judiciaires et sociales ; elle fragilise les familles et les proches.
Dommages
sanitaires
Sans revenus, les dÈtenus ne peuvent ni renouveler les produits d’hygiËne
ÈlÈmentaire que l’administration pÈnitentiaire est censÈe leur procurer, ni
complÈter l’alimentation de base qu’elle fournit. La prÈcaritÈ carcÈrale
empÍche les dÈtenus de prendre soin d’eux-mÍmes et aggrave les effets des
pathologies lourdes, particuliËrement frÈquentes en prison, comme le sida ou
l’hÈpatite C.
DÈlinquance
et insÈcuritÈ
L’absence de revenus en prison est par ailleurs un facteur d’insÈcuritÈ pour
les dÈtenus. Le manque de ressources entraÓne trafics, rackets et prostitution . Les
plus pauvres se trouvent par lý mÍme surexposÈs aux sanctions disciplinaires , aux
violences physiques et aux pratiques ý risques.
InÈgalitÈs
judiciaires
La prÈcaritÈ propre ý l’univers carcÈral crÈe par ailleurs des inÈgalitÈs
judiciaires : l’absence de revenus rend plus difficile l’amÈnagement des peines
qui exige des garanties d’emploi et de logement et un effort actif
d’indemnisation des victimes. Les dÈtenus sont en outre pÈnalisÈs pour assurer
leur dÈfense dans les meilleures conditions. DÈsinsertion sociale La prÈcaritÈ qui
prÈvaut en prison contribue largement ý l’exclusion des dÈtenus et contredit
l’objectif de rÈinsertion affichÈ par l’administration pÈnitentiaire :
incapables, pendant la dÈtention, de faire face ý leurs charges extÈrieures (emprunts,
loyers), ils ne peuvent plus dËs lors soutenir leurs proches, sanctionnÈs et pÈnalisÈs
ý leur tour, et risquent de se retrouver sans ressources ý leur libÈration.
ChertÈ
de la vie carcÈrale
Il faut se dÈfaire du mythe d’un
dÈtenu ´ nourri, logÈ et blanchi ª dont les besoins seraient couverts gracieusement
par l’administration pÈnitentiaire. Pour Ítre plus supportable, la vie carcÈral e
cote cher : le prix des marchandises y est parfois deux fois plus ÈlevÈ qu’a
l’extÈrieur.
Pour un
minimum de ressources
Nous demandons que toute personne
incarcÈrÈe ait droit ý un minimum de ressources personnelles, ce minimum Ètant
constituÈ soit par le maintien de ses droits (minima sociaux, notamment RMI), soit par
l’ouverture pendant l’incarcÈration des droits sociaux auxquels elle aurait pu
prÈtendre avant l’incarcÈration, soit par des prestations particuliËres lui
donnant droit aux mÍmes minima pendant toute la durÈe de son incarcÈration.
Les
signataires du texte
A C ! (Agir ensemble
contre le ChÙmage), Act up Paris, AIDES, GENEPI (Groupement tudiant National
d’Enseignement aux Personnes IncarcÈrÈes), GMP (Groupement Multiprofessionnel), OIP
(Observatoire International des Prisons), Syndicat de la Magistrature, Ligue des Droits de
l’Homme. Ce texte est soutenu par Jean-Michel Bellorgey, conseiller d’tat, qui
a ÈtÈ, en 1988, rapporteur de la loi sur le RMI.
..TÈmoignez !
Si vous souhaitez
apporter votre tÈmoignage sur les conditions de vie en prison, merci d’Ècrire ý :
AIDES, groupe prison, 247, rue de Belleville, 75019 Paris.
[sommaire] |