En juillet 1998, AIDES a menà une enquëte
nationale auprùs des personnes en traitement de substitution (màdicaments destinàs »
remplacer l’hàroåne). Les ràsultats confirment l’intàrët de ces traitements
: ils permettent un meilleur accùs » la santà et amàliorent la qualità de vie.
Cependant, le soutien màdical, social et psychologique reste assez souvent
insatisfaisant.
Màthode de
l’enquëte
L’enquëte a àtà
ràalisàe du 6 au 30 juillet 1998, au sein du ràseau AIDES, auprùs des personnes en
traitement de substitution. Des questionnaires ont àgalement àtà diffusàs par des
associations comme Màdecins du Monde ou ASUD (Auto-Support des Usagers de drogues) .
Cette enquëte est originale : pour la premiùre fois en France, les usagers sont
questionnàs directement, sans passer par l’intermàdiaire des intervenants en
toxicomanie ou des professionnels de santà. Pour 1 000 questionnaire s distribuàs, nous
avons eu 536 retours. 495 questionnaires ont àtà exploitàs. 41 ont àtà àcartàs car
non interpràtables.
AIDES a àtà amenàe, dùs le
dàbut de l’àpidàmie de sida, » mettre en place une ràponse aux besoins des
usagers de d rogues concernàs par le VIH. Il apparut trùs vite, dùs 1986, que les
usagers de drogues par voie intraveineuse àtaient le second groupe touchà par
l’àpidàmie de sida aprùs les homo-bisexuels. Ils repràsentent actuellement 28 %
des cas de sida dàclarà depuis le dàbut de l’àpidàmie.
 L’accùs
aux traitements de substitution pour les usagers de drogues dàpendants aux opiacàs a
àtà rapidement un enjeu de santà publique. En effet, si la substitution n’est pas
une fin en soi, elle offre aux usagers de drogues l’accùs » un traitement prescrit
màdicalement. Cela leur permet de sortir des alàas liàs » la drogue et de ràduire les
risques liàs » l’injection. Un travail de prise en charge màdico-psycho-sociale
peut dùs lors s‘effectuer et amàliorer la situation globale des personnes.
C’est cette hypothùse que nous avons voulu tester par une enquëte s’adressant
directement aux personnes concernàes et leur laissant toute libertà de ràponse. L’accùs
aux traitements de substitution pour les usagers de drogues dàpendants aux opiacàs a
àtà rapidement un enjeu de santà publique. En effet, si la substitution n’est pas
une fin en soi, elle offre aux usagers de drogues l’accùs » un traitement prescrit
màdicalement. Cela leur permet de sortir des alàas liàs » la drogue et de ràduire les
risques liàs » l’injection. Un travail de prise en charge màdico-psycho-sociale
peut dùs lors s‘effectuer et amàliorer la situation globale des personnes.
C’est cette hypothùse que nous avons voulu tester par une enquëte s’adressant
directement aux personnes concernàes et leur laissant toute libertà de ràponse.
Ç Marre des
galùres ˆ
Les ràsultats confirment ce que
l’association AIDES constate quotidiennement dans son expàrience d’accueil et
de soutien :
- les usagers de drogue ont une ràelle
demande d’accùs » un traitement de substitution : ils en ont massivement Ç marre
des galùres liàes » la drogue ˆ ;
- la qualità de vie de ceux qui
reêoivent un traitement de substitution s’amàliore ;
- avoir accùs aux droits sociaux est
un pràalable » l’accùs aux soins et » une amàlioration des revenus des
personnes;
- dans notre enquëte, les personnes
suivies dans les centres spàcialisàs o existe une prise en charge globale de leurs
difficultàs ont des ràsultats plus positifs dans les diffàrents domaines : insertion
sociale, accùs aux soins, qualità de vie, etc. Indàpendamment du produit de
substitution prescrit, c’est la qualità de l’accompagnement
màdico-psycho-social qui conditionne la stabilisation d’un ex-usager de drogues ou
sa rechute vers des opiacàs. Conscientes de cet enjeu, de nombreuses personnes ayant
ràpondu » l’enquëte demandent un meilleur soutien màdical et social ;
- l’ajustement du dosage du
traitement aux besoins de la personne est essentiel pour àviter le sentiment de manque et
le recours » d’autres produits.
Des adaptations
indispensables
Les points suivants devront ëtre pris en compte par les pouvoirs publics pour adapter le
dispositif actuel de la substitution aux opiacàs :
- les àlàments favorisant une bonne
prise en charge des usagers dans les centres spàcialisàs doivent ëtre transfàràs vers
les màdecins gànàralistes. Parfois isolàs dans leur pratique màdicale, ceux-ci
n’ont pas toujours le temps ou les moyens pour un suivi global des personnes. Adapter
la ràponse des màdecins gànàralistes passe, entre autres choses, par la reconnaissance
du rìle de soutien du màdecin vis-»-vis de la personne en traitement de substitution,
par un renforcement des ràseaux ville-hìpital et par un travail entre les diffàrents
intervenants : màdecins, psychologues, assistants sociaux, etc. ;
- il est urgent d’àlargir la
gamme des produits proposàs aux personnes afin
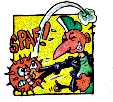 d’avoir une
ràponse correspondant » la diversità des toxicomanies. Plus de 50% des ràpondants
souhaitent d’autres produits et notamment une substitution injectable, avec des
produits conêus pour l’injection et qui n’abÆment pas les veines. Plutìt que
d’inciter les laboratoires » rendre les produits actuels ininjectables, les pouvoirs
publics doivent mettre en œuvre une vraie politique de substitution qui prenne en
compte les besoins des usagers ; d’avoir une
ràponse correspondant » la diversità des toxicomanies. Plus de 50% des ràpondants
souhaitent d’autres produits et notamment une substitution injectable, avec des
produits conêus pour l’injection et qui n’abÆment pas les veines. Plutìt que
d’inciter les laboratoires » rendre les produits actuels ininjectables, les pouvoirs
publics doivent mettre en œuvre une vraie politique de substitution qui prenne en
compte les besoins des usagers ;
- des àtudes comportementales autour
des pratiques d’injection doivent ëtre mises en œuvre. C’est » ce prix
que nous pourrons trouver un dàbut de ràponse aux problùmes posàs par la dàpendance
» l’injection ;
- on ne supprime pas des annàes de
dàpendance aux opiacàs en quelques semaines ou quelques mois. Un dosage initial
inadaptà ou une diminution trop rapide des doses du màdicament de substitution replonge
les personnes vers l’usage de drogues ou l’achat, par des moyens dàtournàs et
souvent illicites, de produits de substitution pour complàter leur prescription ;
- substituer n’est pas sevrer mais
permettre, par une prescription màdicale, de retrouver un àquilibre dans un mode de vie
perturbà par l’usage de drogues.
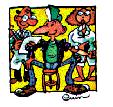 Quelle volontà politique ? Quelle volontà politique ?
Les moyens mis en œuvre par la politique de substitution actuelle ne sont que
partiellement adaptàs. La substitution peut ëtre une vraie ràponse aux usagers de
drogues souhaitant dàcrocher. Encore faudrait-il que les responsables franêais de la
santà aient la volontà politique d’amàliorer la prise en charge globale des
usagers de drogues, ce qui passe notamment par une sensibilisation et une meilleure
formation du corps màdical. Il faut aussi lever le tabou entourant la demande d’une
substitution injectable.
Jàrìme SOLETTI
La substitution en
France
Depuis le 12
fàvrier 1996, la possibilità de prescrire de la buprànorphine (Subutex)
en ville a ouvert la porte des gànàralistes aux usagers de drogues
et remàdià en part i e au manque de places dans les structures spàcialisàes,
notamment pour la dàlivrance de la màthadone. Plus de
45 000 personnes prennent aujourd’hui du Subutex alors que le
nombre de places màthadone reste dramatiquement bas. 4 500 personnes
environ sont substituàes » la màthadone dans des centres de soins.
2 000 personnes environ, pràalablement stabilisàes avec la màthadone
dans un centre de soins, sont suivies en ville par des màdecins gànàralistes.
Les centres de soins qui, en gànàral, dàlivrent une substitution »
la màthadone regroupent dans un mëme lieu une àquipe pluridisciplinaire
qui peut travailler » la prise en charge globale des usagers. Cet
accompagnement est une des raisons essentielles de l’intàrët
des usagers pour les centres de soins. Cependant, ces structures peuvent,
dans certains cas, s’avàrer trop contraignantes.
Enquête
substitution:
les principaux chiffres
Quel que soit
le produit utilisà, 81 % des personnes interrogàes considùrent que
la substitution a un effet positif dans leur vie. 6 0 % des personnes
en Ç avaient marre des galùres liàes » la drogue ˆ. Plus de la moitià
des personnes interrogàes avaient dàj» effectuà un sevrage.
Un
meilleur accùs » la santà
73% des personnes
dàclarent avoir des problùmes de santà. 6 personnes sur 10 dàclarent
sÚoccuper mieux de leur santà depuis quÚelles ont un traitement de
substitution.
37% des personnes interrogàes dàclarent ëtre sàropositives au VIH.
60% dàclarent ëtre touchàes par les hàpatites B et C. Les personnes
sàropositives pour le VIH sont cependant plus souvent en bithàrapie
(58 %) et moins souvent en trithàrapie (38 %) que la moyenne nationale
des personnes en traitement (47% en bithàrapie, 47% en trithàrapie).
Moins
de difficultàs sociales
30% des personnes
nÚont pas de logement et vivent en squat (11%) ou sans domicile fixe
(10%). Moins de 2 personnes sur 10 ont un emploi et prùs de 2 personnes
sur 10 dàclarent nÚavoir aucun revenu. Plus de la moitià des personnes
vivent avec moins de 3 000 F par mois, ce qui correspond, en gànàral,
au RMI.
Cependant,
plus de 9 personnes sur 10 ont une couverture sociale. La substitution
est, pour de nombreux usagers de drogues, le moyen dÚaccàder » une
prise en charge sociale permettant lÚouverture des droits sociaux
et lÚaccùs » des prestations de type Revenu Minimum dÚInsertion ou,
pour les personnes malades, Allocation Adulte Handicapà. 36%
des personnes considùrent quÚavec la substitution leur situation sociale
sÚamàliore
pour lÚobtention de leurs droits, 38% sur un plan matàriel et 20%
seulement au niveau de lÚemploi. Enfin, la moitià des personnes dàclarent
que leurs rapports avec les autres sont plus faciles depuis quÚelles
sont en traitement de substitution.
Quels
produits ?
69% des personnes interrogàes prennent du Subutex, 24% de la màthadone
et, malgrà lÚabsence dÚautorisation de Mise sur le Marchà dans cette
indication, 8% prennent des sulfates de morphine.
4 personnes sur 10 sous màthadone, contre 3 sur 10 avec le Subutex,
dàclarent continuer » utiliser de lÚhàroåne ou de la cocaåne. Cependant,
cet usage est occasionnel pour 70% dÚentre elles.
30% des personnes continuant » utiliser des drogues en plus de leur
traitement de substitution dàclarent le faire parce que le dosage
de leur traitement est insuffisant. Les personnes se plaignent surtout
de la volontà de certains màdecins de baisser les dosages trop rapidement.
LÚinjection
55% des ràpondants dàclarent sÚinjecter leur substitution. Plus de
6 personnes sur 10 dàclarent quÚelles le font Ç parce quÚelles ont
besoin dÚinjecter ˆ. 95% des ràpondants utilisent toujours ou la plupart
du temps (sauf impossibilità) une nouvelle seringue. 88% dàclarent
avoir un accùs facile » des seringues stàriles.
Quelles
relations soignant-soignà ?
Alors que 70% des ràpondants se dàclarent satisfaits des relations
avec le màdecin prescripteur de leur substitution, prùs de 50% disent
ne pas pouvoir parler de leurs pratiques dÚinjection avec lui.
A lÚhìpital, incompràhension et difficultàs relationnelles persistent
pour 4 personnes sur 10. Pour elles, la substitution nÚa pas amàliorà
leurs rapports avec les màdecins et les services hospitaliers. Malaise,
arrët de traitement de substitution, volontà de sevrage de la part
de lÚàquipe màdicale sont les causes de ces relations conflictuelles.
Cependant, une partie des services hospitaliers a intàgrà la notion
de substitution et les spàcificitàs de lÚaccueil des usagers de drogue.
En effet, 6 personnes sur 10 sont satisfaites de leurs relations avec
lÚhìpital.
Les
personnes sàropositives
Plus encore que les personnes sàronégatives, les personnes
sàropositives estiment que le traitement de substitution a un effet
positif dans leur vie. Les personnes sàropositives sont àgalement
plus nombreuses » dàclarer mieux sÚoccuper de leur santà et » constater
que celle-ci sÚest amàlioràe.
Jàrìme
SOLETTI
Les
résultats complets
Les
ràsultats complets de lÚenquëte sont disponibles sur demande àcrite
auprùs de : AIDES Fàdàration nationale, Coordinateur
national accùs aux soins,
23, rue de Chteau-Landon, 75010 Paris.
[sommaire]
|
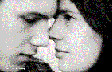
 L’accùs
aux traitements de substitution pour les usagers de drogues dàpendants aux opiacàs a
àtà rapidement un enjeu de santà publique. En effet, si la substitution n’est pas
une fin en soi, elle offre aux usagers de drogues l’accùs » un traitement prescrit
màdicalement. Cela leur permet de sortir des alàas liàs » la drogue et de ràduire les
risques liàs » l’injection. Un travail de prise en charge màdico-psycho-sociale
peut dùs lors s‘effectuer et amàliorer la situation globale des personnes.
C’est cette hypothùse que nous avons voulu tester par une enquëte s’adressant
directement aux personnes concernàes et leur laissant toute libertà de ràponse.
L’accùs
aux traitements de substitution pour les usagers de drogues dàpendants aux opiacàs a
àtà rapidement un enjeu de santà publique. En effet, si la substitution n’est pas
une fin en soi, elle offre aux usagers de drogues l’accùs » un traitement prescrit
màdicalement. Cela leur permet de sortir des alàas liàs » la drogue et de ràduire les
risques liàs » l’injection. Un travail de prise en charge màdico-psycho-sociale
peut dùs lors s‘effectuer et amàliorer la situation globale des personnes.
C’est cette hypothùse que nous avons voulu tester par une enquëte s’adressant
directement aux personnes concernàes et leur laissant toute libertà de ràponse.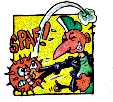 d’avoir une
ràponse correspondant » la diversità des toxicomanies. Plus de 50% des ràpondants
souhaitent d’autres produits et notamment une substitution injectable, avec des
produits conêus pour l’injection et qui n’abÆment pas les veines. Plutìt que
d’inciter les laboratoires » rendre les produits actuels ininjectables, les pouvoirs
publics doivent mettre en œuvre une vraie politique de substitution qui prenne en
compte les besoins des usagers ;
d’avoir une
ràponse correspondant » la diversità des toxicomanies. Plus de 50% des ràpondants
souhaitent d’autres produits et notamment une substitution injectable, avec des
produits conêus pour l’injection et qui n’abÆment pas les veines. Plutìt que
d’inciter les laboratoires » rendre les produits actuels ininjectables, les pouvoirs
publics doivent mettre en œuvre une vraie politique de substitution qui prenne en
compte les besoins des usagers ; 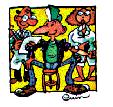 Quelle volontà politique ?
Quelle volontà politique ?