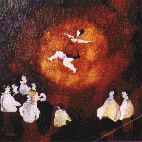
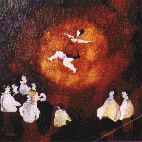
"Solitude de Mireille Cambau-Espagne"
Des techniques de mesure précise, fiable et reproductible de la charge virale sont maintenant au point. Elles devront, après validation définitive, rapidement passer aux mains des cliniciens afin d'optimiser chaque traitement individuel, combinant au mieux les cinq antiviraux actuellement disponibles : AZT, ddI, ddC, d4T et 3TC, ces deux derniers étant délivrés depuis plus d'un an à titre compassionnel aux patients chez qui les trois premiers sont, seuls ou associés, inefficaces ou mal tolérés.
Les résultats encourageants de l'association AZT+3TC ont fait l'objet d'une intense communication et les demandes d'octroi compassionnel se sont multipliées (22 000 patients traités dans le monde dont 3 000 en France) au point de conduire à un RATIONNEMENT des nouvelles inclusions. Officiellement en raison de problèmes de production. Ne serait-ce pas un moyen de pression pour accélérer la commercialisation du 3TC ? La mobilisation des associations de lutte contre le sida permettra-t-elle de débloquer la situation ?
Les résultats des premiers essais d'antiprotéases sont encourageants : forte chute de la charge virale, remontée des T4 ainsi qu'effets secondaires minimes. Des résistances apparaissent rapidement, mais l'association aux médicaments sus-cités devrait apporter un net bénéfice. La mise en place d'une distribution compassionnelle de ces nouvelles molécules est une URGENCE pour les malades les plus graves puisqu'ils ne peuvent être inclus dans les essais d'antiprotéases.
Les malades du sida se battent pour leur survie. Ne tuez pas leur espoir !
René FROIDEVAUX
Le cathéter veineux central, auxiliaire de vie
Touche pas à mon KT !
Cathéters : pour qui, pourquoi, comment ?
Cathéters : quelques conseils d'utilisation
Vivre avecõ son cathéter
Comment prescrivent-ils les antirétroviraux ?
AZT+3TC : résultats intéressantsõ et difficultés d'obtention
La conférence de Washington
Cannes : nutrition et VIH
Florence : usagers de drogue
Quand la sécu s'emmêle
Lettre de l'ANRS, Réponse de REMAIDES
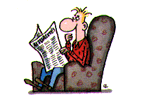
Infection à VIH et déficience visuelle : l'association AIDES Ile-de-France propose un groupe d'échanges et de paroles aux patients concernés par l'infection VIH et atteints de troubles de la vision. 1er et 3e jeudi de chaque mois, de 20h à 22h. Se renseigner à AIDES au 44 52 33 57 (répondeur).
AIDES Ile-de-France organise des ateliers santé (entrée libre et gratuite). Prochains thèmes abordés : la rétinite à CMV (lundi 10 juillet) ; soins dentaires et séropositivité (jeudi 28 septembre) ; actualités thérapeutiques (jeudi 26 octobre) ; traitement des candidoses (jeudi 23 novembre). Il est conseillé d'appeler AIDES avant, pour vérifier les dates (Tél. : 44 52 00 00 ; 247 rue de Belleville 75019 Paris). Signalons également les réunions publiques d'information sur les traitements, organisées par Act up (Tél. : 48 06 13 69) et les réunions d'information d'Actions-Traitements (Tél. : 43 67 66 00).
AIDES Fédération édite et diffuse gratuitement les Info Plus, brochures d'information médicale. Parmi les numéros parus récemment : les maladies de peau ; les mycobactéries atypiques. Pour toute information Tél.: (1) 53 26 26 70.
L'étude d'une cohorte française d'enfants nés de mères séropositives, suivie depuis 7 ans et comportant actuellement 2 500 enfants, a permis de préciser les facteurs de transmission materno-fČtale du VIH (dont le risque est chiffré en moyenne à 20 %). Certains de ces facteurs sont déjà connus : progression de l'infection chez la mère, allaitement au sein, antigénémie p24 positive, chiffre de T4 (15 % de transmission au-dessus de 600 contre 43 % en-dessous de 200 T4/mm3). Fait nouveau, l'âge maternel apparaît déterminant : 16 % de transmission pour les moins de 25 ans, 30 % au-dessus. En revanche, la région, l'origine ethnique et le mode de contamination de la mère n'affectent par le taux de transmission materno-fČtale du VIH.
Les laboratoires Janssen recommandent, en raison de la possibilité de survenue de troubles du rythme cardiaque, de ne plus associer leur spécialité Prépulsid® (utilisée dans le traitement de certains troubles de l'estomac) avec les antifongiques imidazolés (médicaments contre les mycoses) Nizoral®, Daktarin® et Sporanox®. Cette contre-indication ne concerne pas le Triflucan®.
Une enquête sur le comportement de 6 000 jeunes français âgés de 15 à 18 ans a montré que 55 % d'entre eux ont déjà eu un rapport sexuel, avec ou sans pénétration. 1,4 % (filles et garçons) ont déjà eu au moins une relation homosexuelle. 85 % des jeunes ont utilisé des préservatifs lors de leur premier rapport sexuel, le chiffre étant de 57 % en 1989. Cette proportion descend cependant à 72 % chez les garçons et 51 % chez les filles lors du dernier rapport en date.
Une enquête réalisée à la demande du ministère de la Santé, auprès de médecins généralistes, montre que 13 % pensent que le VIH peut être transmis par la salive, 6 % en donnant son sang, 2 % par un moustique, 7 % en étant hospitalisé dans le même service qu'un séropositif, 1,5 % dans les toilettes publiques et 49 % lors de soins dentaires. Seulement 70 % proposent un test de dépistage aux femmes enceintes, 73 % aux patients consultant pour une MST, 83 % lors de l'examen prénuptial et 81 % aux usagers de drogue. Par contre, 12 % admettent avoir prescrit un test de dépistage à l'insu du patient. Des résultats inquiétants, même si la méthodologie de cette enquête a été vivement critiquée.
Des américains ont rapporté un cas de guérison spontanée d'une infection à VIH (le VIH a disparu de l'organisme) chez un bébé dont 3 cultures virales, à 19 et 51 jours de vie, avaient été positives. C'est la première fois qu'une telle observation est parfaitement démontrée, une erreur de laboratoire ayant été incriminée auparavant dans des cas similaires.
La proportion de dons de sang positifs pour le VIH est passée en France de 6,4 à 0,47 pour 10 000 dons entre 1985, date de début du dépistage systématique des anticorps anti-VIH, et 1993. Grâce à une sélection des donneurs éliminant ceux appartenant aux « groupes à risque ». Certains départements présentent encore un taux élevé de dons positifs : 3,64 à la Réunion, 2,12 aux Antilles et en Guyane et 1,30 en Corse, toujours pour 10 000 dons de sang.
Les personnels de santé des établissements de soins publics ou privés contaminés par le VIH dans l'exercice de leur profession seront indemnisés par un fonds de solidarité du Ministère de la Santé.
Une équipe de l'hôpital Louis Mourier a rapporté le premier cas documenté de transmission du parasite Pneumocystis Carinii d'une mère à son fČtus. Très immunodéprimée, cette femme avait interrompu son traitement par AZT et aérosols de pentamidine un an auparavant.
La TVA sur les seringues et les Stéribox est passée de 18,6 % à 5,5 %. Une baisse que les pharmaciens se sont engagés à répercuter intégralement sur le prix de vente.
Les essais Delta (en Europe) et ACTG 175 (aux États-Unis) comparent l'AZT et les associations AZT + ddI et AZT + ddC, chez les personnes qui commencent le traitement, sur des critères cliniques (apparition d'infections opportunistes, durée de vieõ). On devrait avoir les résultats de l'ACTG 175 à l'automne et ceux de Delta en fin d'année. Pour éviter qu'un trop grand nombre de patients ne quittent Delta (en raison de sa durée), les organisateurs de l'essai l'ont modifié : les patients qui y participent depuis plus de deux ans, ou ceux dont l'infection à VIH évolue, peuvent avoir accès à une association d'antiviraux (ou changer d'association, s'ils en prenaient déjà une). Ils seront répartis au hasard entre AZT + ddI (ou AZT + ddC, s'ils prenaient auparavant AZT + ddI) et AZT + 3TC.
Cette année, faute d'accord entre les chaînes de télévision, l'émission Sidaction n'aurait rapporté que 40 millions de francs. Contre 300 millions, en 1994.
En mai, le ministère de la Santé a rendu public un « rapport sur les essais thérapeutiques menés hors cadre légal, dans le domaine du sida ». Parmi les irrégularités relevées, certaines concernent des scientifiques reconnus, qui n'ont pas respecté la législation protégeant les patients. La version du rapport diffusée aux journalistes ne cite pas de noms, mais on peut reconnaître le Pr Andrieu (fiche N°1) ou le Pr Chermann (fiche N°7). D'autres fiches concernent des « pratiques parallèles », qui ne respectent pas les procédures d'évaluation scientifique (en fiche N°8, on reconnaît M. Beljanski).
Le Pr Andrieu (Hôpital Laënnec, Paris) aime la publicité tapageuse. En 1985, il avait promu la ciclosporine comme traitement du sida. Il s'était trompéõ En mars 95, il récidive, en vantant les vertus des corticoïdes en couverture du magazine VSD. Alors que son étude a été réalisée au mépris des droits légaux des patients (le protocole n'a pas été soumis à un comité d'éthique, ou CCPPRB). De plus, ses résultats sont bien minces : 44 patients traités par prednisolone (un corticoïde). Chez 27 d'entre eux, les T4 ont augmenté. Pas d'effets secondaires graves. On est très loin d'une démonstration d'efficacité. C'est juste une donnée nouvelle, qui mériterait d'être confirmée (ou infirmée) par un véritable essai. Rappelons par ailleurs que les corticoïdes peuvent avoir des effets secondaires sérieux, lors d'un traitement de longue durée.
L'accès aux soins des personnes les plus démunies : tel est le thème d'une circulaire rédigée par Simone Veil et Philippe Douste-Blazy, avant leur départ du ministère de la Santé. Ce texte fait le point de manière détaillée sur les procédures d'accès aux soins, et insiste pour que les droits des personnes soient respectés. (Circulaire du ministère des Affaires sociales, N°9508 du 21/3/95).
L'essai international de prévention du CMV par le valaciclovir a été interrompu, car il y avait un peu plus de décès dans le groupe traité par ce médicament que chez les personnes qui recevaient le médicament de comparaison (aciclovir = Zovirax®). On ne connait pas les raisons de cette différence. Le valaciclovir serait peut-être responsable de problèmes vasculaires (entraînant des troubles rénaux ou neurologiques), survenus chez quelques patients traités.
Le Conseil national du sida a recommandé le suivi des enfants nés de mères séropositives traitées par AZT pendant la grossesse, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire à long terme (chez ces enfants, ou, à plus long terme encore, chez leurs descendants).
Plusieurs antiprotéases (un nouveau type de médicament anti-VIH) sont actuellement à l'essai en France. Ces études s'adressent surtout aux personnes qui commencent le traitement anti-VIH :
- Un essai en triple association (AZT + ddC + ABT-538, l'antiprotéase des laboratoires Abbott) est en cours. Il est coordonné par le Dr Leibowitch (hôpital Poincaré, à Garches). Cet essai est complet (30 patients).
- Un autre essai, coordonné par le Pr Katlama (hôpital Pitié-Salpétrière, Paris) est prévu. Il compare l'AZT à l'ABT-538 et à l'association des deux.
- Le MK 639 des laboratoires Merck (autrefois appelé L-624) sera comparé à l'AZT et à l'association des deux. Cet essai devrait avoir lieu dans les hôpitaux Rothschild (Paris) et Paul Brousse (Villejuif).
- L'essai portant sur le saquinavir, l'antiprotéase de Roche, continue. Il compare quatre traitements : AZT seul ; AZT + saquinavir ; AZT + ddC ; AZT + ddC + saquinavir. Les personnes recevant l'AZT seul passeront au bout d'un an à une association (on ne sait pas encore si ce sera AZT + saquinavir ou AZT + ddC + saquinavir). Cet essai est critiqué par le groupe TRT 5 (Act up, Actions Traitements, AIDES, Arcat-sida, VLS), en raison de sa longueur et de sa rigidité.
Pour les personnes qui ne peuvent pas entrer dans ces essais, il est urgent de mettre en place des programmes compassionnels. Roche l'avait promis pour le 1er semestre 95, mais n'a pas tenu son engagement. Le saquinavir sera peut-être disponible en août, pour 400 patients seulement (sur la France).
Force est de constater que depuis le début de l'épidémie, beaucoup de nouveaux traitements sont apparus dans l'infection par le VIH. C'est dans le traitement des affections opportunistes, infections et cancers, que ces progrès ont été les plus spectaculaires : bon nombre d'entre elles peuvent de nos jours être maîtrisées. Malheureusement certains traitements obligent à recourir à la voie intraveineuse pour une efficacité optimale. Notamment en cas de maladie sévère du tube digestif.
Au cours de l'infection par le VIH, de nombreuses situations peuvent à l'heure actuelle conduire à la pose de perfusions intraveineuses : chimiothérapie en cures répétées pour sarcome de Kaposi ou lymphome, traitement antiviral pour infection par le CMV (rétinite surtout), traitement antifungique pour candidose Čsophagienne résistante ou méningite à cryptocoques, antibiothérapie pour pneumonie ou septicémie, réhydratation en cas de diarrhées sévères, transfusion de culots globulaires en cas d'anémie ou apport calorique pour syndrome de cachexie (amaigrissement) sont les principales.
Mais la répétition des perfusions dans les veines des avant-bras peut s'avérer difficile, douloureuse voire impossible : on est alors amené à proposer la pose d'un cathéter veineux central.
C'est au patient que revient la décision de se faire poser ou non un cathéter et de son choix : à émergence cutanée ou à chambre implantable, l'un et l'autre ayant leurs avantages et leurs inconvénients. Le médecin le plus compétent pour poser le cathéter reste l'anesthésiste-réanimateur car les veines, c'est son métier ; mais certains chirurgiens y sont aussi très entraînés. Dans tous les cas sa mise en place doit avoir lieu comme une opération, dans un bloc opératoire non septiqueõ et pas sur un coin de table !
Pour devenir autonome, une éducation soigneuse par des infirmier(e)s est indispensable. Le temps pris pour se « brancher » ou se « débrancher » devient très court après quelques semaines de pratique. Certains préféreront ne pas s'en mêler et ce sont les infirmier(e)s qui manipuleront le « cathé ».
Le risque principal étant l'infection, l'asepsie («propreté», absence de microbes) doit être draconienne : les mesures les plus importantes sont le lavage soigneux des mains, le port d'une bavette (masque de papier) par le patient et par celui qui manipule le cathéter, l'usage généreux de Bétadine®, le port de gants stériles et le rinçage obligatoire au chlorure de sodium à 9 % (« sérum physiologique » stérile). Les règles sont strictes même si des aménagements sont possibles : héparinisation (rinçage du cathéter avec de l'héparine, pour éviter que du sang y coagule et le bouche) facultative en cas d'utilisation quotidienne, bains possibles même avec un cathéter à émergence cutanée (avec bien sûr un pansement étanche)õ
D'importants progrès ont été réalisés dans le matériel nécessaire pour les perfusions à domicile : diffuseurs portables dispensant du pied à perfusion et permettant de sortir, la perfusion dans la poche, pompes délivrant à débit constant les mélanges nutritifs, etc.
Lorsqu'on est opéré d'une appendicite ou des amygdales, on accepte le fait d'être perfusé sans se poser de questions métaphysiques. Pourquoi des perfusions répétées, ce qui est infiniment plus confortable par un cathéter veineux central, représenteraient-elles un quelconque acharnement thérapeutique parce qu'il s'agit du sida ? Non, décidément, la maladie a beaucoup changé et c'est être moderne que d'accepter et de dédramatiser le bénéfice des nouveaux traitements, fût-ce par voie intraveineuse. La qualité de la vie et sa durée en sont tributaires ! Et les séjours à l'hôpital n'en seront qu'écourtés voire évités. À la condition que tout le monde soit très vigilant sur les règles d'asepsie. La recherche de traitements par voie orale aussi efficaces doit bien entendu se poursuivre parallèlement (le Cymévan® en gélules par exemple).
René FROIDEVAUX
Mon cathéter, je lui dois la vie. D'une maigreur inquiétante voilà 6 mois, j'ai repris 12 kilos depuis et peux à nouveau mener une vie quasi-normaleõ du moins le jour. Alors qu'après moins de 50 mètres j'étais contraint de m'asseoir, je marche actuellement des kilomètres sans fatigue. Je ne suis plus tenu de faire la sieste. Je branche ma nutrition intraveineuse tous les soirs vers 23 heures et me débranche vers 8 heures. Une pompe permet un écoulement régulier de la perfusion. Son bruit comme un ronronnement continu ne me gêne plus du tout. Pour plus de commodité, je dispose d'un pistolet (pour pisser), d'un bassin (pour cõ) et d'une cuvette (en cas de vomissements) à portée de main. Ainsi que de somnifères, d'une bouteille d'eau et d'un thermomètreõ Au début, j'ai eu des maux de tête, la bouche très sèche et même de la fièvre lorsque la perfusion passait trop vite. Mon corps la tolère maintenant bien mieux.
Ce n'est pas tout : je me passe aussi tous les soirs une perfusion de Cymévan® pour une colite à CMV. Toutes les 3 semaines je reçois 3 flacons d'immunoglobuline ainsi que ma chimiothérapie (pour le traitement du Kaposi), à domicile bien sûr. Ma candidose Čsophagienne nécessite parfois des perfusions de Fungizone®. À chaque pneumonie, je dois faire une cure d'antibiotiques intraveineux adaptés à la bête retrouvée à la fibro. Si je pouvais recevoir la totalité de mes traitements par voie veineuse, je le ferais mais un certain nombre, comme les antiviraux, n'existent qu'en comprimés. Mon estomac les tolère mal et le manifeste souvent. 12 gélules de Cymévan® à la place de la perfusion ? Non merci !
J'en suis à mon deuxième cathéter, le premier s'étant infecté dans les premiers jours après sa pose. Le second est en place depuis plus de 6 mois. J'ai préféré un cathéter à émergence pour deux raisons : je ne me sentais pas me piquer (ou être piqué) tous les soirs et je n'ai plus de préoccupations esthétiques, ayant sur le thorax deux magnifiques lésions de Kaposiõ Sa manipulation me semblait aussi plus simple et la solidité du branchement meilleure pour des perfusions nocturnes prolongées (je suis un peu agité).
Je refuse qu'on me fasse les prises de sang par le cathé car c'est tellement moins risqué et plus rapide au bras. Quand c'est mon ami qui me branche, le plus souvent en fait, ça lui prend environ 8 minutes montre en main, c'est devenu un as de l'asepsie ! Le matin ça lui ou me prend 3 minutes, tout le matériel étant déjà prêt et emballé de la veille. Quand j'étais très fatigué, je crois que je n'aurais pas pu le faire tout seul. C'est une boîte privée qui me livre le matériel (on m'a dit : pas de publicité).
Je suis parti 3 fois en vacances avec tout le matériel nécessaire, y compris la pompe. Dont une fois aux Antilles. Pour le transport, le plus volumineux est la nutrition elle-même qui doit rester au frais dans une glacière. S'il n' y a que le Cymévan®, c'est beaucoup moins encombrant. Se brancher dans la brousse ne doit pas être évident, mais à l'hôtel c'est tout à fait réalisable. Ne pas oublier de prendre un clou et un marteau si les murs n'ont pas au bon endroit de cadre à décrocher (du genre voiliers sur la mer ou vue du mont Fuji) ! Ainsi qu'une petite boîte pour les aiguilles usées et des sacs poubelle rendant les déchets plus discretsõ Se faire une liste du matériel nécessaire afin de ne pas oublier quelque chose d'indispensable, comme cela m'est arrivé il y a 3 mois lors d'un week-end : il me manquait les tubulures ! Un détail enfin : je prends un bain tous les matins et de longs bains de mer à l'occasion, même si mon médecin fait la grimace !
Richard
Certains traitements imposent des perfusions répétées : antiviraux anti-CMV (Cymévan®, Foscavir®) (1), chimiothérapies anti-cancéreuses, nutrition intraveineuse (= parentérale)õ La pose d'un « cathé » (cathéter veineux central) évite d'abîmer les veines et permet une plus grande autonomie : on peut effectuer soi-même ses perfusions, se déplacer et même sortir de chez soi pendant ce temps, grâce aux diffuseurs portables. Il existe plusieurs types de cathéters. Il est utile de s'informer avant de choisir le modèle, en concertation avec son médecin-traitant et avec le médecin qui effectuera la pose.
Qu'est-ce qu'un cathéter veineux central ?
Un cathéter est constitué d'un embout (où l'on branche les perfusions), raccordé à un tube de plastique (silicone ou polyuréthane), qui passe sous la peau. Le tuyau aboutit dans une grosse veine (une veine «centrale», d'où le nom de cathéter veineux central).
Une fois le cathéter mis en place, la personne ne ressent ni douleur, ni gêne. Sous les vêtements, il ne se voit pas. Enfin, il est toujours possible de le retirer, en cas de problème ou si l'on n'en a plus besoin.
Pourquoi se faire poser un cathéter ?
Les cathéters centraux sont utilisés depuis une trentaine d'années, dans les services de réanimation, de cancérologie et d'hématologie. Au cours de l'infection à VIH, la grande majorité des cathéters sont mis en place pour le traitement des infections à CMV (cytomégalovirus), la plus fréquente étant la rétinite. Le traitement actuel impose des perfusions quotidiennes. Bien souvent, cela abîme les veines des avant-bras en quelques jours ou quelques semaines. Le cathéter évite ce désagrément. De plus, il permet d'effectuer soi-même ses perfusions (après un apprentissage) et d'utiliser des diffuseurs portables (Baxter®, Zambon®õ), avec lesquels on peut se déplacer et sortir de chez soi pendant les perfusions (voir article : Cathéters : quelques conseils d'utilisation). Avec un cathéter, on peut perfuser tous les médicaments intraveineux, la nutrition parentérale (intraveineuse), les transfusions (en cas d'anémie) et faire les prises de sang. Voilà pour les avantages. L'inconvénient médical le plus important réside dans le risque d'infection du cathéter (lorsque des bactéries parviennent à s'y loger). Le respect de certaines précautions réduit beaucoup ce risque. Quant aux inconvénients esthétiques et pratiques, ils dépendent du type de cathéter.
Quels sont les différents types de cathéters ?

Deux modèles de chambres implantables. Chacun mesure environ 3 cm de long, 2 cm de large, 1 cm de haut et pèse 8 grammes. Une fois mise en place, la chambre fait juste une petite bosse sous la peau. (Photo : Braun.)
Il existe deux grands types de cathéters : les cathéters «à émergence cutanée» et les cathéters «à chambre implantable». Ces deux types de cathéters sont «tunnelisés» : le tuyau passe sous la peau avant d'entrer dans la veine, ce qui diminue le risque d'infection.
- La chambre implantable est constituée d'un boîtier placé sous la peau, en général au niveau du thorax. Lorsque la personne est torse nu, on ne voit qu'une petite bosse, de la taille d'une pièce de monnaie. Certains cathéters (type Pas-port®) peuvent être implantés au niveau de l'avant-bras. Mais, dans la vie quotidienne, c'est parfois plus gênant qu'au niveau du thorax ; par ailleurs, les boîtiers Pas-port®, de très petite taille, ne sont pas vraiment adaptés à une utilisation quotidienne.
Avec un cathéter à chambre implantable, la personne peut se doucher ou se baigner, sans problème. Pour les perfusions, on pique au travers de la peau, puis au travers de la membrane en silicone du boîtier, avec une aiguille spéciale.
La pose d'un cathéter à chambre implantable n'est pas possible chez les personnes qui ont des troubles importants de la coagulation du sang. Il faut aussi que la peau soit en bon état, dans la zone de mise en place du cathéter.
- Le cathéter à émergence cutanée comporte un embout de quelques centimètres, qui dépasse de la peau. On branche directement les perfusions sur cet embout : il n'y a pas à piquer. Mais, en dehors des perfusions, la personne doit continuellement porter un pansement. Il est possible de prendre une douche (avec un pansement en plastique étanche) mais les bains sont déconseillés (ce qui n'empêche pas certains patients d'en prendre, en protégeant bien sûr leur cathéter avec un pansement étanche).
Il semblerait que le cathéter à émergence cutanée convienne mieux que le cathéter à chambre implantable, pour les perfusions fréquentes de produits relativement épais (nutrition parentérale ; concentré de globules rougesõ). La pose de ce cathéter est très simple et peut être réalisée chez tous les patients.
Le tuyau de certains cathéters à émergence cutanée est muni d'un manchon (de Dacron® ) : quelques jours après la mise en place, les cellules situées sous la peau s'y fixent. Ainsi, le tuyau ne peut plus glisser. Pour ôter ce type de cathéter, il faut pratiquer une petite incision.
Comment se passe la pose du cathéter ?
Elle se fait au bloc opératoire et doit impérativement être assurée par un spécialiste (médecin anesthésiste ou chirurgien) bien formé à cette technique. Avant la pose d'un cathéter à chambre implantable, il est nécessaire d'effectuer un bilan de coagulation ; de plus, il ne faut pas prendre de médicaments influant sur la coagulation (aspirine, Ticlid®õ) pendant les dix jours qui précèdent l'intervention.
La mise en place du cathéter peut très bien se faire en hôpital de jour (le patient entre le matin et sort l'après-midi). Dans la très grande majorité des cas, une anesthésie locale suffit. Cependant, il est recommandé d'arriver à jeun, dans le cas (très rare) où il serait nécessaire d'effectuer une anesthésie générale. Par ailleurs, les personnes anxieuses peuvent demander un anxiolytique (« calmant »). Si l'anxiété est forte, il est possible de faire une « anesthésie générale légère ».
Avant l'opération, la peau doit être désinfectée (douche et nettoyage avec un savon antiseptique). L'intervention elle-même, lorsqu'elle est réalisée par une équipe expérimentée, et qu'il n'y a pas de difficultés particulières, dure environ un quart d'heure pour un cathéter à émergence cutanée, et une demi-heure pour un cathéter à chambre implantable (le temps de mettre en place le boîtier).
Dans les deux cas, mieux vaut que l'embout soit placé assez bas sur le thorax : il sera plus facile à utiliser par le patient. Il faut aussi savoir si celui-ci est droitier ou gaucher.
Après la mise en place, on effectue une radio, pour vérifier que le cathéter est bien placé et qu'il n'y a pas de problème immédiat (comme le pneumothorax, qui peut se produire si la plèvre, la membrane qui entoure le poumon, a été touchée au cours de l'intervention). Le médecin doit enfin remettre un compte-rendu de l'opération au patient ou à son médecin-traitant. Ce document indique les caractéristiques de la pose du cathéter, ce qui est très utile s'il est nécessaire de l'enlever.
Après la mise en place d'un cathéter, le patient peut éprouver une légère douleur au niveau du cou, pendant 24 à 48 heures. Elle sera contrôlée par la prise de Doliprane® ou de Diantalvic®.
Un cathéter à émergence cutanée peut être utilisé tout de suite après la pose. Pour un cathéter à chambre implantable, on attend généralement 8-10 jours, durée nécessaire à la cicatrisation. Cependant, il est aussi possible de l'utiliser immédiatement après la pose, à condition que ce premier branchement soit effectué par le médecin qui a réalisé l'intervention.
En conclusion
La décision de se faire poser (ou non) un cathéter appartient au patient. Ce n'est pas une urgence : il est toujours possible de commencer le traitement en perfusions dans les veines des avant-bras. Prendre le temps de la réflexion permet de choisir un modèle qui correspond bien aux besoins (médicaux, esthétiques, pratiquesõ), en concertation avec son médecin traitant et avec le médecin qui effectuera la pose.
Ce dossier a été rédigé par Thierry PRESTEL, grâce aux informations et aux conseils du Dr Marie-Cécile DOUARD (médecin anesthésiste) et de Françoise CLÉMENT (infirmière), du service d'anesthésie-réanimation chirurgicale de l'hôpital Saint-Louis (Paris).
(1) - Pour s'informer sur l'évolution des traitements de l'infection à CMV, voir l'article sur la Conférence de Washington, dans ce numéro de REMAIDES.
Les personnes qui le souhaitent peuvent apprendre à effectuer elles-mêmes leurs perfusions (ou celles d'une personne proche). Cet apprentissage doit s'effectuer sous le contrôle d'un(e) infirmier(e) maîtrisant parfaitement la technique, car il faut respecter des précautions d'asepsie rigoureuses (l'asepsie est l'absence de microbes, de bactéries), afin d'éviter l'infection du cathéter. Nous n'abordons pas ici le détail de la procédure de soins mais proposons quelques conseils pratiques :
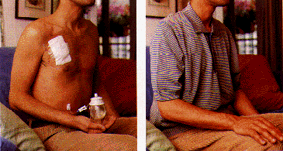
Perfusion avec un diffuseur portable. Photo de gauche : dans la main. Photo de droite : dans la poche. Léger et discret. On peut se déplacer, sortir de chez soi, travailler, aller au cinémaõ pendant la perfusion.
- C'est au patient, et non à l'infirmière, de décider s'il souhaite ou non apprendre à manier lui-même son cathéter. Cependant, cela exige une certaine habileté manuelle et l'apprentissage peut être plus ou moins long. Certains patients n'y parviennent pas : dans ce cas, mieux vaut laisser faire l'infirmière. D'autres demandent à cette dernière de brancher la perfusion, et savent la débrancher seuls. D'autres enfin maîtrisent ces opérations mieux que les professionnels. Signalons que les laboratoires Braun (qui fabriquent les chambres implantables Celsite®) envoient gratuitement une cassette vidéo et un livret expliquant l'utilisation de ce type de cathéter. (La demande doit passer par l'infirmière ou le médecin) (1).
- Choisir chez soi un espace où l'on peut confortablement effectuer la manipulation du cathéter. L'endroit où l'on pose le matériel de soins doit être très propre.
- Prendre son temps. Pour une personne entraînée, la mise en place d'une perfusion prend une dizaine de minutes (et environ cinq minutes pour dépiquer, après la perfusion). Mais, pour un débutant, compter une demi-heure (et parfois plus). Faire en sorte de ne pas être dérangé pendant ce temps (débrancher le téléphone, éloigner le chatõ). Personne ne doit fumer dans la pièce pendant les soins (les particules de fumée peuvent apporter des bactéries sur le matériel de soin).
- Si un jour on ne se sent pas capable de bien réaliser la mise en place de la perfusion, mieux vaut s'abstenir (et se reposer un moment). Au besoin, appeler l'infirmière pour qu'elle se charge de cet acte. Il est préférable de retarder la perfusion de quelques heures, plutôt que de risquer une infection du cathéter, à cause d'une erreur de manipulation.
- Avant de manipuler le cathéter, il faut toujours retirer bagues et bracelets et bien se laver les mains et les avant-bras, avec un savon antiseptique (Bétadine® rouge ou savon à la chlorexhidine : Hibitane®). Ce lavage des mains est indispensable, même si, ensuite, on enfile des gants stériles (il faut en mettre pour toutes les manipulations portant directement sur le cathéter). Mettre aussi une bavette (un masque en papier, qui couvre le nez et la bouche). En effet, par le souffle ou par la parole, des bactéries peuvent être projetées sur le matériel de soin. Si c'est un soignant ou un proche qui s'occupe du cathéter, il doit porter une bavette et le patient aussi. Enfin, pour la désinfection de la peau, l'alcool n'est pas assez efficace. Utiliser de la Bétadine® jaune (la laisser ensuite sécher 30 secondes environ).
- Si la peau, autour du cathéter, est rouge, gonflée ou douloureuse, ne pas faire la perfusion. Appeler l'infirmière ou le médecin. Il peut s'agir d'une infection ou d'une thrombose (la veine dans laquelle aboutit le cathéter est bouchée par un caillot de sang).
- L'infection du cathéter peut aussi être révélée par d'autres symptômes, comme une forte fièvre ou des frissons lors de la perfusion ou du rinçage du cathéter. En de tels cas, ne pas effectuer d'autre perfusion : on risque d'augmenter la quantité de bactéries qui passent dans le sang. Appeler rapidement son médecin (voir article sur les urgences dans ce numéro). Une infection du cathéter nécessite un traitement antibiotique. Mais elle peut parfois imposer le retrait du cathéter. Dans ce cas, après traitement de l'infection, il sera possible d'en mettre un nouveau en place.
- Bien respecter le protocole de soins élaboré avec l'infirmière. On peut se faire une liste de tout le matériel dont on a besoin, pour éviter les oublis. Si l'on pense avoir fait une « faute d'asepsie » (avoir apporté des microbes sur un matériel qui doit rester stérile (= sans microbes)), mieux vaut interrompre la manipulation. Il est souvent préférable de s'arrêter un moment, puis de recommencer au début, avec un nouveau set (emballage contenant le matériel nécessaire à un soin : gants, seringues, aiguilles, bavettes, compressesõ).
- Si l'on a un cathéter à chambre implantable, pour que la peau puisse cicatriser, éviter de piquer toujours au même endroit (si nécessaire, on peut tirer un peu sur la peau). On peut laisser l'aiguille piquée dans la chambre pendant quelques heures, voire une journée, afin d'éviter d'avoir à repiquer. Mais il ne faut pas la laisser pendant plusieurs jours : cela comporte un risque d'infectionõ et fait perdre tout intérêt au cathéter à chambre implantable (mieux vaut alors avoir un cathéter à émergence cutanée).
Certains soignants laissent l'aiguille en place, par crainte de se piquer en l'ôtant (avec les chambres implantables, il peut y avoir un « effet rebond » à ce moment-là). Signalons que le Geres (Groupe d'étude sur les risques d'exposition au sang) (2) informe (gratuitement) sur les techniques et les matériels destinés à éviter les accidents par piqûre. Un dispositif destiné à protéger la main a été mis au point par l'HAD de l'hôpital Pitié-Salpétrière (3). Par ailleurs, les laboratoires Vygon® commercialisent un dispositif de protection à usage unique, le Digiprotect® (8 à 11 F pièce, non remboursé) (4).
- Après la fin d'une perfusion, toujours rincer le cathéter avec 10 ou 20 ml de chlorure de sodium à 0,9 % stérile (« sérum physiologique » stérile), avant d'y injecter quelques ml d'héparine diluée. (L'héparine évite que du sang ne coagule dans le cathéter et le bouche). Certains modèles récents de cathéters n'ont pas besoin d'être héparinés, mais il faut néanmoins les rincer au « sérum physiologique » stérile.
- Il est possible d'effectuer les prises de sang sur le cathéter. Mais il faut respecter les précautions d'asepsie : lavage des mains, gants stériles, désinfection du site de piqûreõ (sinon, mieux vaut être piqué dans une veine du bras). Il faut ensuite rincer et hépariner le cathéter. Sinon, le sang risque d'y coaguler et de le boucher. Pour la même raison, pendant une transfusion, il faut rincer le cathéter tous les deux concentrés globulaires, ainsi qu'à la fin de la transfusion.
- Certains médicaments ne doivent pas être mélangés : ils risquent de précipiter (de se solidifier brusquement) et de boucher définitivement le cathéter. Pour éviter ce problème, toujours injecter les médicaments séparément, après avoir rincé le cathéter au sérum physiologique stérile.
- Lorsqu'un cathéter est bouché, c'est, la plupart du temps, parce qu'un caillot de sang s'y est formé. Ne jamais « pousser » (avec une seringue contenant du sérum physiologique ou de l'héparine) : la pression risque de fissurer ou de rompre le tuyau du cathéter. Le fragment brisé part dans la circulation sanguineõ La seule méthode efficace consiste à injecter (doucement) dans le cathéter un ou deux millilitres d'une solution d'Urokinase® (qui n'est disponible que dans certains services spécialisés). Ce médicament dissout le caillot. Il faut le laisser agir dans le cathéter entre 30 minutes et 24 heures, selon les cas. Si, après cela, le cathéter reste bouché, c'est probablement dû à une autre cause.
- Il arrive parfois qu'un cathéter à émergence cutanée glisse et se déplace. Ne jamais essayer de le remettre en place : cela entraînerait un important risque d'infection. Faire une radio : si le cathéter est resté dans la veine, on peut encore l'utiliser, de manière temporaire. S'il n'y est plus, il ne faut pas s'en servir. Dans les deux cas, il faut en parler à son médecin.
- En conclusion : Effectuer soi-même ses perfusions (ou celles de la personne avec qui l'on vit) permet une plus grande autonomie. Cependant, cela reste un acte délicat et il ne faut pas hésiter à appeler l'infirmière ou le médecin, lorsqu'on rencontre une difficulté.
1 - Braun-Celsa Tél. : 49 62 76 00, Demander Mme Cholet ou M. Gautier.
2 - Geres : Faculté de médecine Bichat. 16 rue Henri Huchard. BP 146. 75870 Paris Cedex 18, Tél. : (1) 44 85 61 83
3 - HAD Pitié-Salpétrière, Tél. : (1) 42 16 08 50.
4 - Laboratoires Vygon : 5-11 rue Adeline. BP 7. 95440 Écouen, Tél. : 39 92 63 63.
Les diffuseurs portables (Baxter®, Zambon®õ) sont des flacons de plastique qui remplacent le matériel de perfusion classique (pied métallique et flacons de verre). On remplit le diffuseur avec le médicament puis on le branche sur le cathéter. On peut alors le mettre dans sa poche, ce qui permet de se déplacer, et même de sortir de chez soi. On le débranche dans l'heure qui suit la fin de la perfusion (il faut rincer et hépariner, comme après la fin d'une perfusion classique).
Avec le Cymévan®, pas de problème. En revanche, le Foscavir® impose une hydratation, pour protéger le rein. Elle se fait habituellement par perfusion, avec 500 ml à 1 litre de sérum physiologique. Les flacons de verre restent donc nécessaires. Cependant, pour éviter cet inconvénient et permettre l'utilisation des diffuseurs portables, certains médecins proposent à leurs patients de boire beaucoup d'eau (avant, pendant et après la perfusion ; 2 à 3 litres par jour). Un essai est actuellement en cours (à La Pitié-Salpétrière, à Paris), pour s'assurer que cette méthode est fiable.
Pour remplir ces diffuseurs portables, il faut respecter les précautions d'asepsie. On peut préparer les diffuseurs de Cymévan® d'avance, pour quelques jours (ou demander à l'infirmière de le faire). Il est conseillé de les mettre au réfrigérateur (où le produit reste stable 15 jours). En revanche, le Foscavir®, une fois préparé, ne se garde que 24 heures, à température ambiante (ne pas le mettre au réfrigérateur).
Le matériel nécessaire à l'utilisation du cathéter (compresses, seringues, diffuseurs portablesõ) est remboursé par la Sécurité sociale sur la base d'un forfait (le TIPS). Certaines pharmacies pratiquent des prix nettement supérieurs au TIPS. La différence reste alors à la charge du patient !
Les personnes en HAD (hospitalisation à domicile) ne sont pas confrontées à ce problème, puisque le matériel leur est fourni. Il faut parfois insister pour obtenir des diffuseurs portables (en raison de leur prix). Mais c'est tellement plus pratique !
Les personnes qui ne sont pas en HAD peuvent faire appel à des sociétés qui livrent le matériel à domicile. Le patient ne paye rien (l'entreprise se fait rembourser par la Sécurité sociale). On peut se renseigner auprès de ces sociétés, pour connaître la procédure à suivre et les services proposés (récupération gratuite des déchets, formation à l'utilisation du matériel, livraison des médicamentsõ). Signalons que Caremark et West Home Care Medical livrent aussi les compléments alimentaires.
Voici une liste (non exhaustive) de ces sociétés :
* Caremark : Parc Burospace 14. 91572 Bièvres Cedex. Tél. : (1) 69 33 79 33 ou Tél. : (1) 69 33 79 00. France entière.
* Orkyn : 6-8 rue Robespierre. 93130 Noisy le Sec. Tél. : (1) 48 10 64 70. France entière.
* West Home Care Medical : 1 rond-point des Bruyères BP 101. 76300 Sotteville-lès-Rouen. Tél. : 32 81 97 81 (agence de Paris Tél. : (1) 44 95 14 26). Normandie et Paris. Développement national en cours.
* VitalAire Région Centre : Parc d'activité Adéis (ZI d'Ingré). 15 rue Pierre et Marie Curie 45140 St-Jean de la Ruelle. Tél. : 38 52 24 20. Sur les autres régions, l'activité de VitalAire concernant l'infection à VIH est en développement. VitalAire France Tél. : (1) 46 93 03 75.
* AMMA : 170 rue Henri Barbusse 95103 Argenteuil.Tél. : (1) 39 61 11 35. (Livre en région parisienne. Envoie en Colissimo sur toute la France)
* AMSD : 6 allée Pauline. 78150 Rocquencourt. Tél. : (1) 39 66 08 63. (Livre en région parisienne. Envoie en Colissimo sur toute la France).
Lorsque mon médecin m'a conseillé la pose d'un cathéter à chambre implantable (Port-a-Cath®), après la confirmation d'une rétinite à CMV, je n'ai pas réellement pris conscience de ce que cela représentait : il s'agissait pour moi de bénéficier d'un traitement par perfusion, et la pose d'un tel dispositif me paraissait naturelle.
Peu à peu, j'ai appris à vivre avec ce système « d'accès » à mon système veineux central. Certes, la pose s'est faite sans problème particulier (opération chirurgicale bénigne nécessitant une hospitalisation d'une journée) mais le résultat était là : je vivrai désormais avec ce petit appareil implanté dans mon organisme, un corps étranger, un intrus presque.
Sur le plan esthétique (on peut avoir perdu 15 Kg et être toujours aussi soucieux de son « aspect »), les conséquences étaient très limitées : seule une petite boursouflure avec une cicatrice à peine visible sur la poitrine marquent la présence de ce cathéter. J'en ai fait l'expérience il y a peu de temps, en me baignant en public : personne ne semblait remarquer cette « intervention ». Sur le plan physique, je sens à peine la présence de l'appareil, pouvant effectuer tout mouvement sans contrainte particulière.
C'est bien évidemment dans sa manipulation pratique et journalière que mon cathéter me rappelle ma « différence ». Je m'administre chaque jour une perfusion en observant, comme j'y ai été formé, des règles d'hygiène et d'asepsie très strictes car, et c'est là le risque majeur, la crainte d'une infection est permanente et ne tolère aucun écart.
Je suis actuellement sous Cymévan® et j'utilise pour mes perfusions des diffuseurs « Intermate » Baxter, qui ont littéralement changé ma vie : remplissage et manipulation faciles, discrétion et autonomie totales (je peux faire tout autre chose pendant ma perfusion, et même sortir) et réduction du temps de perfusion, à savoir 1h15 environ.
Je me « pique » chaque soir et cet exercice m'a appris à manipuler mon cathéter de mieux en mieux : je sais exactement à quel endroit piquer efficacement, permettant ainsi une perfusion sans problème. Parfois, il arrive que l'écoulement ne se fasse pas du premier coup : dans ce cas, je ne m'affole pas et manipule légèrement mon cathéter et mon aiguille afin de trouver le «bon endroit». Cette intervention est de plus en plus rare car je pense bien maîtriser aujourd'hui mon « compagnon » de soins.
Si j'ai un conseil à donner, n'hésitez pas à demander à un patient déjà porteur d'un cathéter ses impressions, afin de vous faire une idée objective de cette implantation somme toute banale.
Yvon LEMOUX
Quand commencer le traitement anti-VIH ? Faut-il toujours débuter par l'AZT ? Quand doit-on modifier le traitement ? Quels médicaments utiliser alors ? Nous avons posé ces questions à trois spécialistes de l'infection à VIH, qui suivent de près l'actualité scientifique. Ils nous ont expliqué la manière dont ils prescrivaient les cinq antirétroviraux actuellement disponibles en France : AZT, ddI, ddC, D4T, 3TC. Leurs propos ont été recueillis par Thierry PRESTEL.
Pr Christine KATLAMA. Service de maladies infectieuses, hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris . Coordinateur pour l'Europe de l'étude AZT plus 3TC.
Quand proposez-vous un traitement antirétroviral ?
Pr Christine Katlama : Je propose un traitement aux personnes qui ont une infection à VIH évolutive. J'évalue cette évolutivité à la chute des lymphocytes CD4 (T4). Ainsi, compte tenu de données récentes, montrant la production d'une quantité très importante de virus, je suis favorable au traitement précoce des patients qui ont 300 ou 400 CD4/mm3, mais dont les CD4 baissent rapidement, plutôt que d'attendre que se soit installé un déficit immunitaire important.
Quel(s) médicament(s) proposez-vous pour commencer le traitement ?
De nombreux essais cliniques portant sur des associations de deux ou trois molécules sont en cours, notamment dans notre service. En dehors de ces essais, je propose l'AZT en monothérapie (seul). Je prescris un bilan biologique dans les deux mois qui suivent le début du traitement, pour une première évaluation de son efficacité.
À quoi évaluez-vous l'efficacité d'un traitement ?
À l'heure actuelle, au fait que les CD4 remontent ou, en tous cas, qu'ils se stabilisent. S'ils baissent, je change de traitement. Je n'attends pas qu'ils se soient effondrés ou que la personne ait développé une infection opportuniste, pour intervenir. La mesure de la charge virale pourra dans un proche avenir nous guider plus précisément.
Avec quelle fréquence prescrivez-vous les bilans biologiques ?
Je prescris des bilans rapprochés (tous les deux mois, parfois tous les mois) pour les personnes dont les CD4 sont inférieurs à 250 ou 200/mm3. En revanche, lorsque les CD4 sont relativement stables, et supérieurs à 250/mm3, un suivi tous les quatre mois suffit généralement.
Que proposez-vous lorsque l'AZT n'est pas, ou n'est plus efficace ?
En schématisant, on a deux situations, en fonction de l'importance du déficit immunitaire : chez une personne qui a plus de 250 CD4/mm3, il faut prévoir la durée et ne pas épuiser les ressources dont on dispose. Lorsque l'AZT n'est pas efficace, je propose une monothérapie (un seul antirétroviral) par ddI. En revanche, chez quelqu'un qui a moins de 200 CD4/mm3, je pense qu'il faut être plus offensif. On passe rapidement à une bithérapie (deux antirétroviraux). On commence par AZT plus 3TC, car c'est l'association qui s'est montrée la plus efficace actuellement. Les résultats que j'ai présentés au congrès de Washington indiquent que ce bénéfice peut se poursuivre pendant plus de 56 semaines.
Que proposez-vous lorsque les traitements cités plus haut cessent d'être efficaces ?
Si la personne était en monothérapie par ddI, on passe à une association, comme AZT plus 3TC. Si elle prenait déjà une association, on la modifie. On passe d'AZT plus 3TC à AZT plus ddI, ou parfois à AZT plus ddC. Nous ne prescrivons pas de trithérapie (trois antiviraux), car ce n'est pas autorisé (en dehors de certains essais).
Et le D4T ?
Nous l'utilisons aussi. Un certain nombre de nos patients en reçoivent actuellement, en monothérapie, dans le cadre de l'usage compassionnel.
Comment voyez-vous évoluer les traitements antirétroviraux, dans les mois qui viennent ?
Les traitements en association, que nous devons encore évaluer, seront de plus en plus utilisés. La mesure de la charge virale n'est pas encore complètement validée, mais elle présente certainement un intérêt. Je regrette que cet examen coûte scandaleusement cher. Il faudrait qu'il soit disponible dans les laboratoires, à un prix raisonnable. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est pour cela que nous ne l'utilisons pas, en dehors des essais cliniques.
Quant aux essais, je crois qu'ils devraient s'orienter dans deux directions :
- Évaluer rapidement le pouvoir antiviral de nouvelles molécules ou d'associations. Ceci peut se faire en quelques mois, avec peu de patients, grâce à la mesure de la charge virale.
- Étudier les stratégies thérapeutiques : que vaut-il mieux faire, à tel stade de l'infection, lorsque la personne a déjà reçu tel et tel médicament ? Ce traitement améliore-t-il la qualité de vie ?
Je pense que les protocoles qui mélangent tout, qui prétendent mesurer l'effet antirétroviral en fonction de critères cliniques, sur plusieurs années, en attendant que les gens développent des infections opportunistes, ne sont pas raisonnables. Ils sont en retard sur la pratique quotidienne. On a actuellement aucun traitement qui guérisse l'infection à VIH. On sait que les médicaments dont on dispose ont une durée d'action limitée. L'efficacité antivirale doit donc être évaluée sur des critères virologiques, pendant des périodes brèves. Il faudra que les institutions, les Agences du Médicament, prennent en compte cette situation. On n'a plus de temps à perdre.
Dr. Myriam KIRSTETTER. Médecin de ville et attachée à l'hôpital Saint-Antoine ; Paris.
Quand proposez-vous un traitement antirétroviral ?
Dr Myriam Kirstetter : Je propose un traitement lorsque je perçois un mouvement biologique, qui semble indiquer une activité virale plus intense. Le signe principal est généralement une baisse des T4 ou de leur pourcentage, mais je prends aussi en compte la hausse de l'antigénémie p24, de la Bêta-2-microglobuline, une baisse des anticorpsõ
En pratique, je propose généralement l'AZT autour de 200 T4/mm3. Mais ce n'est pas une limite absolue. Il m'est arrivé d'en prescrire à un stade plus précoce, chez un patient dont les T4 avaient chuté de 800 à 500, et pour lequel d'autres marqueurs s'étaient modifiés. Je propose aussi ce médicament aux personnes qui ont une antigènémie p24 très élevée, car cela indique probablement un risque majoré d'évolution de l'infection.
Certaines manifestations cliniques pour lesquelles aucune cause autre que le VIH n'a pu être diagnostiquée (problèmes de peau, problèmes digestifsõ) m'incitent aussi à proposer l'AZT. Conformément aux recommandations officielles, j'en prescris également chez des patients dont les T4 sont élevés, en cas de thrombopénie (chute des plaquettes, un des constituants du sang).
Enfin, je prends en compte la situation psychologique du patient : certaines personnes se sentent envahies par le virus et veulent avoir un moyen de lutter. Le traitement peut les y aider. À l'inverse, d'autres ont un compte de T4 stable, entre 100 et 200, et refusent le traitement antirétroviral. J'explique l'intérêt d'un tel traitement mais, si la personne persiste à le refuser, je respecte sa décision.
Le début du traitement antirétroviral est très rarement une urgence. Patient et médecin doivent trouver ensemble le moment le plus opportun.
J'espère qu'à l'avenir, la mesure de la charge virale constituera un indicateur utile. Mais, actuellement, cet examen n'est pas disponible.
Par quel(s) médicament(s) commencez-vous le traitement ?
En dehors des essais thérapeutiques, je commence par l'AZT (actuellement, c'est le seul médicament qui ait fait la preuve de son efficacité comme premier traitement), mais j'évoque déjà avec le patient la possibilité de passer ensuite à une association. Environ 4 à 6 semaines après le début de l'AZT, nous faisons le point, en fonction du premier bilan biologique et des éventuels effets secondaires. Ensuite, je propose un bilan biologique tous les mois ou tous les deux mois. On se donne trois à quatre mois pour juger de l'efficacité de l'AZT. Si ce médicament montre une efficacité (amélioration des signes cliniques et biologiques), on continue. Certaines personnes sont sous AZT depuis plusieurs années et se portent bien, avec un état clinique et biologique stable.
Cependant, compte tenu des résultats récents, favorables aux associations d'antirétroviraux, je propose fréquemment d'ajouter un autre antirétroviral (ddI, 3TC, parfois ddC) après 3 à 6 mois de traitement.
Que proposez-vous, en cas d'intolérance à l'AZT ?
Je propose les autres antirétroviraux. En général, nous commençons par la ddI, sauf si la personne trouve que c'est trop lourd au quotidien (obligation de le prendre à jeun) ou s'il y a une contre-indication. Dans ce cas, je m'oriente vers les autres antirétroviraux (ddC, d4T ou 3TC).
Que proposez-vous lorsque l'AZT n'est pas, ou n'est plus efficace ?
Quand, sous AZT, les T4 diminuent, je propose de passer à AZT plus ddI ou AZT plus ddC. Si ce problème d'inefficacité se présente à nouveau, nous essayons les autres antirétroviraux, seuls ou en association. On se donne à chaque fois trois ou quatre mois pour évaluer un traitement. Le choix des médicaments dépend des effets secondaires, du désir de la personne (une association peut être contraignante, en termes de prises) et des précédentes expériences. Il faut savoir qu'un antirétroviral peut perdre son efficacité, en raison de l'apparition de résistances, et la retrouver ensuite, après quelques mois de traitement par un autre antirétroviral.
Parmi les associations, on a surtout des données sur celles qui comportent de l'AZT. Mais il existe d'autres possibilités. J'ai une attitude pragmatique. J'essaie de trouver ce qui est adapté à chaque patient. Il m'arrive de prescrire une association de trois antirétroviraux à une personne chez qui rien d'autre ne s'ést avéré efficace.
À l'inverse, j'accepte totalement l'attitude de quelqu'un qui a peu de T4, qui a essayé différents traitements et qui ne veut plus prendre d'antirétroviraux. C'est toujours un équilibre à trouver entre l'efficacité, les effets secondaires et la situation psychologique du patient. Par ailleurs, la prescription d'antirétroviraux s'intègre à une stratégie globale et personnalisée, où la prévention et le traitement des infections opportunistes tiennent une place essentielle.
Dr. Gilles PIALOUX. Médecin-adjoint ; service de maladies infectieuses ; hôpital de l'Institut Pasteur ; Paris
Quand proposez-vous un traitement antirétroviral ?
Dr Gilles Pialoux : Je propose le plus souvent un traitement aux personnes asymptomatiques ayant entre 350 et 200 T4/mm3 ou à celles qui ont des signes cliniques, y compris des symptômes dits « mineurs ». En effet, les antirétroviraux permettent souvent d'améliorer ces symptômes, en plus de l'effet antirétroviral attendu.
D'un patient à l'autre, les éléments cliniques et biologiques n'ont pas tous le même poids. Certaines personnes acceptent l'idée d'une baisse progressive des T4. Pour d'autres, c'est insupportable. C'est quelque chose à prendre en compte, pour débuter un traitement. Le dialogue qui s'instaure au fil des consultations, dès la découverte de la séropositivité, permet de discuter de ces questions. Par ailleurs, je trouve très sain que les gens puissent chercher un deuxième avis, auprès d'un autre médecin, aux moments clés.
Actuellement, on parle beaucoup de charge virale. Je m'y intéresse depuis plusieurs années. Mais je constate qu'on n'a encore que partiellement réussi à établir le lien entre ce marqueur, l'évolution clinique et surtout la décision de stratégie thérapeutique.
Par quel(s) médicament(s) commencez-vous le traitement ?
Actuellement, plusieurs essais cliniques sont ouverts aux personnes qui commencent le traitement, avec des associations de deux ou trois antirétroviraux. Il faut informer le patient des diverses possibilités qui existent. En entrant dans un essai, la personne « perd la chance » d'accéder aux autres. Il faut donc qu'elle puisse choisir en connaissance de cause.
En dehors des essais cliniques, je prescris l'AZT seul, pour le tout début de traitement. Pour le moment, il n'y a pas d'argument solide pour débuter par un autre médicament ou par une association. De plus, il est utile, pour la suite du traitement, de savoir si l'AZT a une efficacité chez un patient. Je propose un bilan biologique mensuel, pendant les deux ou trois mois nécessaires pour évaluer l'efficacité du médicament. Si on voit une amélioration, on continue. En l'absence d'amélioration, je passe très vite à AZT + ddI, à AZT + ddC, ou à AZT + 3TC. C'est également ce que je propose, lorsque l'AZT seul a été efficace pendant un moment, puis a cessé de l'être.
Actuellement, il n'y a aucun argument scientifique pour préférer l'une de ces associations à l'autre. Cela dépend de la tolérance et du désir du patient (la ddI doit être prise à jeun ; la ddC impose trois prises par jour, la 3TC est liée à un essai clinique).
Que proposez-vous, lorsqu'une de ces associations cesse d'être efficace chez un patient ?
En général, sauf intolérance, nous essayons une autre association de deux antirétroviraux. Pour modifier un traitement, je n'attends pas que les T4 soient descendus en dessous de leur niveau de départ. J'essaye d'intervenir avant, dès le moment où l'on discerne une diminution d'efficacité (quand les T4 commencent à baisser). Ensuite, je propose le D4T ou le 3TC en association. Ces deux molécules sont disponibles sur toute la France. Leur prescription impose quelques formalités administratives. Mais cela ne doit pas servir de prétexte aux médecins pour refuser ces médicaments aux patients chez qui ils se justifient.
Outre le D4T et le 3TC, il est toujours possible de revenir à l'AZT, à la ddI, au ddC, en association : les inversions de résistance existent (une souche de VIH devenue résistante à un antirétroviral peut perdre cette résistance, au cours du traitement par un autre antirétroviral).
En cas d'intolérance à l'AZT, que proposez-vous ?
La ddI ou le ddC. Si l'un de ces médicaments est inefficace, j'essaye l'autre. En l'absence de résultats favorables, ou en cas d'intolérance, je propose le D4T ou le 3TC. J'attends des informations sur ddI + D4T, D4T + 3TC, sans oublier les antiprotéases dont on attend la mise à disposition en « humanitaire ».
Quelle est votre position vis à vis des associations d'antirétroviraux, sachant qu'aucune d'elles n'est autorisée en France ?
Tout médecin a une obligation de moyens. Il ne doit pas se cacher derrière des arguments administratifs ou derrière une prétendue « défense » des essais. Notre rôle consiste à chercher une stratégie thérapeutique adaptée à chaque personne. Elle s'appuie sur la prévention et le traitement des infections opportunistes et sur les cinq antirétroviraux dont on dispose actuellement. Si la monothérapie (un seul antirétroviral) est inefficace, il faut proposer une bithérapie (deux antirétroviraux) voire une trithérapie. On verra bientôt comment utiliser la charge virale.
Je n'utilise que des associations sur lesquelles des données ont été publiées, pour lesquelles il y a des arguments rationnels. C'est le cas d'AZT + ddI ou d'AZT + ddC. À ma connaissance, rien, dans l'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) de la ddI, par exemple, n'interdit cette association.
Les associations comportant du D4T ou du 3TC posent des problèmes particuliers : ces deux médicaments sont disponibles dans un cadre restrictif. Il est consternant de voir les laboratoires Glaxo faire du marketing indirect autour des résultats de l'association AZT + 3TC depuis fin 1994, sans l'autoriser dans leur protocole compassionnel avant avril 1995. J'espère par ailleurs que l'accès compassionnel aux inhibiteurs de protéase va s'ouvrir rapidement.
Le 3TC est un antirétroviral (anti-VIH) de la même famille que l'AZT, la ddI, la ddC, le D4T. Les laboratoires Glaxo, qui fabriquent ce médicament, le mettent à disposition des patients, au moyen d'un essai clinique ouvert («compassionnel»). Il est destiné aux personnes qui ont moins de 300 T4/mm3 et présentent une intolérance ou une résistance à l'AZT, la ddI et la ddC. Le 3TC est généralement très bien toléré. Mais, donné seul, son efficacité est souvent limitée à quelques mois, en raison de l'apparition de résistance.
Les résultats de l'association AZT + 3TC ont été présentés aux congrès de Glasgow (novembre 1994) et de Washington (janvier 1995). Précisons que ces études ne donnent pas d'information sur les critères cliniques (on ne sait pas si ce traitement diminue le risque d'infections opportunistes, s'il augmente ou non l'espérence de vie), et qu'elles ne portent que sur des personnes ayant plus de 100 T4/mm3. Voici les principales données :
- AZT + 3TC provoque une hausse des T4 et une baisse de la charge virale (quantité de VIH présente dans le sang) nettement plus importantes et plus durables que l'AZT seul.
Cette hausse de T4 est plus marquée chez les personnes qui n'ont jamais pris d'AZT (ou n'en ont pris que pendant quelques semaines) que chez celles qui en ont pris pendant longtemps (deux ans en moyenne) : + 80 T4, contre + 30 T4, après 6 mois de traitement. Dans les deux cas, après un an sous AZT + 3TC, le nombre de T4 reste supérieur à ce qu'il était avant le traitement (alors qu'avec l'AZT seul, la hausse de T4 ne dure en moyenne que 6 mois).
- L'association AZT + ddC a été comparée à AZT + 3TC, chez les personnes ayant pris de l'AZT pendant deux ans en moyenne. Leurs effets sur la charge virale sont comparables. Cependant, chez ces personnes, AZT + ddC n'entraîne pas de hausse de T4 (contrairement à AZT + 3TC).
- La tolérance d'AZT + 3TC est bonne et semble comparable à celle de l'AZT seul.
- En association avec l'AZT, il est désormais recommandé d'utiliser la dose de 300 mg/jour de 3TC : elle donne de meilleurs résultats que celle de 600 mg/jour (en raison d'une moindre toxicité). Glaxo a diffusé cette information aux médecins et a également autorisé l'association AZT + 3TC, dans le cadre de son « compassionnel ».
- L'efficacité d'AZT + 3TC s'explique probablement ainsi : le VIH devient résistant au 3TC en quelques mois. Mais cette résistance le rend sensible à l'AZT. Il garde (ou retrouve) donc cette sensibilité à l'AZT beaucoup plus longtemps que lors d'un traitement par AZT seul.
- Cependant, il semblerait que la résistance au 3TC entraine aussi à une résistance à la ddI et à la ddC. C'est pour cela que certains spécialistes estiment préférable de proposer la ddI ou la ddC, seules ou en association avec l'AZT, avant de passer à AZT + 3TC (conformément aux critères du « compassionnel »).
Glaxo ferme le robinet
En début d'année, Glaxo est devenu le premier laboratoire pharmaceutique mondial, en rachetant Wellcome (le producteur de l'AZT), pour la somme de 74 milliards de francs. Parallèlement, les demandes de 3TC sont montées en flèche, suite aux bons résultats des études concernant AZT + 3TC. Brutalement, en mars, contrairement à ses engagements, Glaxo a annoncé qu'il restreignait l'accès au « compassionnel » (1). Les personnes qui recevaient déjà le médicament ont continué à l'obtenir, mais celles à qui il est prescrit pour la première fois ont dû souvent attendre plus de deux mois pour le recevoir : les entrées dans le « compassionnel » ont été limitées à 460/semaine dans le monde, dont 350 aux États-Unis.
Afin de faire évoluer cette situation, les associations de lutte contre le sida ont rencontré Glaxo à plusieurs reprises, aux niveaux français (groupe TRT-5 : Actions-Traitements, Act-up Paris, AIDES, Arcat-sida, VLS) et européen (EATG : European Aids Treatments Group). De son côté, Act up Paris a mené une campagne d'actions vigoureuses, vis à vis de Glaxo.
En mai, on a appris que ce laboratoire déposait une demande d'homologation pour le 3TC aux États-Unis, en association avec l'AZT, pour les personnes qui commencent le traitement anti-VIH. L'agrément pourrait intervenir à l'automne. Il autorisera Glaxo à vendre ce médicament, au lieu de le donner, comme il le fait actuellement (à la mi-mai, 22 000 patients recevaient du 3TC, dans le monde). Prévoyant un important marché, le laboratoire ne constituait-il pas un stock de médicament, au détriment du « compassionnel » ?
La mobilisation associative semble finalement porter ses fruits : au cours de la réunion du 21 juin, avec l'EATG, Glaxo paraissait disposé à mettre fin à la limitation arbitraire du nombre d'entrées dans le « compassionnel ». Le laboratoire prévoyait aussi d'informer régulièrement les médecins sur les délais d'obtention du 3TC (qui ne devraient plus dépasser 5 semaines). Espérons que ces bonnes nouvelles se concrétiseront rapidement !
T.P.
(1) Signalons que les trois interviews des Drs Katlama, Kirstetter et Pialoux ont été réalisées avant l'entrée en vigueur des restrictions sur le 3TC.
Plusieurs exemples récents de négligence, tant de la part des médecins que de celle des patients séropositifs, conduisent à un constat : on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La connaissance par le malade ou son entourage des principaux symptômes urgents devant l'amener à consulter dans les 24 heures pourrait éviter certaines situations catastrophiques, comme en témoignent les quatre exemples qui suiventõ
Essouflement
Serge, séropositif depuis une dizaine d'années, asymptomatique en dehors de problèmes cutanés allergiques, d'infections ORL répétées (angines, otites, sinusitesõ) et d'une intolérance à la ddC (Hivid®), part en vacances d'été dans le midi de la France. Il a moins de 10 T4 depuis 2 ans et prend dapsone + Malocide®. Il est discrètement fébrile (il a un peu de fièvre), 38° à 38°5, et il met cela sur le compte de l'opération pour sinusite chronique réalisée avec succès 6 semaines auparavant. En vacances, il se met à tousser de façon un peu insistante, une fièvre plus élevée s'installe, vers 39°, et surtout quelques jours après il devient essouflé, à l'effort - escaliers, marche rapide - puis au repos. Après une semaine d'aggravation progressive de ces symptômes, sans avoir consulté sur place ni fait de radiographie pulmonaire, il se résout à rentrer précipitamment à Paris. Directement de l'aéroport au service où il est suivi. Diagnostic immédiat : pneumocystose grave, et un passage en réanimation pour surveillance voire ventilation artificielle est même envisagé. Finalement, il s'en sortira sans séquelles après 10 jours à l'hôpital sous oxygène, Bactrim® et cortisone intraveineux. Il a senti la mort passer très près et sait qu'il a négligé un symptôme grave : l'essouflement.
Troubles visuels
Yasmina, séropositive asymptomatique depuis 7 ans, 40 T4, sous ddC et Bactrim®, mène à Rennes une vie privée et professionnelle tout à fait normales avec sa fille de 10 ans. Un beau jour, elle ressent des troubles visuels minimes : quelques mouches volantes devant un Čil. Elle ne s'inquiète pas. Mais ces troubles réapparaissent 3 jours plus tard et deviennent permanents. Plus grave, elle constate un jour, au lever, un voile devant le même Čil gauche, comme un rideau de théâtre abaissé devant la partie supérieure de son champ visuel. Elle envisage de consulter, mais son emploi du temps est très chargé en cette fin d'année scolaire. Les choses semblent se tasser. Trois semaines plus tard, elle se rend compte qu'elle ne voit plus du tout de son Čil gauche et qu'elle a également des petits signes à droite. Elle panique et consulte en urgence le lendemain un ophtalmo : le décollement de rétine de l'Čil gauche est total et irréversible, et l'Čil encore fonctionnel présente plusieurs foyers de rétinite à CMV (cytomégalovirus). Un traitement biquotidien de ganciclovir (Cymévan®) est débuté en hospitalisation puis, après pose d'un cathéter central, à domicile. 15 jours plus tard, les lésions sont en voie de cicatrisation, mais elle sait que le mois de retard qu'elle a pris avant de consulter lui a fait perdre totalement la vision d'un Čil. Elle a maintenant bien conscience qu'un traitement anti-CMV strictement suivi et une surveillance draconienne de son fond d'Čil devraient permettre, malgré les rechutes qu'elle sait possibles, de ne pas devenir aveugle.
Paralysie
Philippe, séropositif depuis 6 ans, présente depuis 18 mois des signes généraux - fatigue, perte de poids, muguet buccal, diarrhée - mais sans infection opportuniste caractérisée. 15 jours avant son départ pour les États-Unis, il a de la fièvre, sans autre symptôme : la prise de sang est inchangée (moins de 50 T4/mm3 depuis un an), le scanner cérébral, la radio pulmonaire et l'échographie abdominale sont normaux. Une fibroscopie bronchique est réalisée : pas de Pneumocystis carinii le soir même, mais en fait le lendemain il est averti de la présence de quelques parasites. Il prend donc du Bactrim®, mais 48 heures après, nouveau contre-ordre : c'était une erreur ! Arrêt du Bactrim®. Il n'est plus fébrile (il n'a plus de fièvre) jusqu'à la veille de son départ. Dans l'avion il a 39°, à l'arrivée 39°5, le lendemain 40°. Très faible, ni lui ni son ami ne veulent admettre que la moitié droite de son corps est partiellement paralysée. Quand il marche, il penche à droite lourdement. L'hémiplégie (paralysie de la moitié du corps) devient complète en 48 heures : il tombe dans la baignoire sans pouvoir se relever . Aux urgences de l'hôpital, le diagnostic de toxoplasmose cérébrale est confirmé par le scanner, avec un énorme abcès cérébral gauche. La paralysie régressera après 10 jours de traitement intraveineux puis oral (antibiotiques et cortisone) et une rééducation prolongée. Les erreurs auront été : du laboratoire qui a conduit à un traitement bref mais suffisant pour masquer la toxoplasmose ; du patient et de son entourage, de nier pendant plus de 48 heures la paralysie d'un côté du corps. Des séquelles auraient pu être définitives (boîterie, difficultés à la marche ou à l'écriture, raideurõ).
Fièvre et cathéter
Greg, séropositif depuis 11 ans, ayant moins de 50 T4 depuis 18 mois, est malade du sida depuis un an : candidose Čsophagienne, tuberculose pulmonaire et plus récemment rétinite à CMV. Il est sous ganciclovir (Cymévan®) en traitement d'entretien et complètement autonome depuis plusieurs mois pour ce qui concerne le maniement de son cathéter central : il pique lui-même sa chambre implantable tous les soirs et utilise un diffuseur portable (Intermate Baxter®) s'il a prévu de sortir chez des amis ou d'aller au cinéma. Peu avant Noël, il présente une fièvre à 38°5, le lendemain il est franchement fébrile à 40° et plus et il a des frissons intenses et répétés. Il prend rendez-vous avec son médecin hospitalier pour le lendemain. Autre fait à noter : lors de sa dernière perfusion, le rinçage et l'héparinisation (rinçage du cathéter avec de l'héparine) ont déclenché un grand frisson qui a duré 15 minutes. Son médecin lui demande une radio des poumons et une échographie de l'abdomen, et il rentre chez lui, épuisé. Dans la soirée, inquiet, il appelle un ami médecin qui immédiatement évoque le diagnostic de septicémie sur cathéter. Ni le médecin ni le patient n'y avaient pensé. Il lui recommande d'aller dans le service dès le lendemain matin, et de ne surtout pas utiliser le cathéter d'ici-là. Sa perfusion est faite ce soir-là sur une veine périphérique. Le lendemain, des hémocultures sont prélevées au bras et sur le cathéter, et des antibiotiques y sont injectés. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le taxi à l'entrée de l'hôpital, il est pris d'un grand malaise et de frissons tellement intenses qu'un médecin présent évoque une crise d'épilepsie. Finalement, on l'amène à l'hôpital de jour d'où il sortait. Le « choc septique », forme gravissime d'infection bactérienne sévère, est évident et traité énergiquement. On décide de lui retirer le cathéter le lendemain matin après une nuit à l'hôpital sous antibiotiques intraveineux. Il en sort le surlendemain, à 37°, et reprend ses perfusions quotidiennes par les veines des bras jusqu'à la pose, 15 jours plus tard, d'un nouveau cathéter central. On ne l'y reprendra plus : fièvre élevée et frissons sur cathéter = septicémie jusqu'à preuve du contraire ! Il devient draconien avec l'asepsie pour manipuler son cathéter. C'est vrai qu'il a failli mourirõ
Ne pas hésiter à consulter
Ces situations, dramatiques mais réelles, doivent être évitées. Aux médecins d'avoir une information et une formation continue de meilleure qualité, mais aux patients aussi d'être mieux informés, plus vigilants et de ne pas négliger des symptômes débutants voire flagrants. Dans tous les cas, mieux vaut consulter inutilement, pour une simple grippe par exemple, qu'hypothéquer sa santé !
Mais qui consulter ? Dans l'idéal, le médecin généraliste ou hospitalier qui vous suit et connait votre dossier. Ou un collègue du même service. La nuit ou le week-end, aux urgences de l'hôpital où vous êtes suivi si possible. Si vous êtes trop fatigué(e) pour vous déplacer, un taxi ou une ambulance peuvent vous y amener. Voire le SAMU si la situation l'impose (faire le 15). SOS médecins peut aussi être utile (c'est un service privé et ses interventions ne sont qu'en partie remboursées par la Sécurité sociale). Dans tous les cas, il est préférable de ne pas rester seul(e). À noter : urgences ophtalmologiques de l'Hôtel-Dieu 24h/24. Tél.: 42 34 80 36. Accueil : 1 place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris).
Par ailleurs, disposer de la liste À JOUR de vos antécédents, principales affections opportunistes, derniers examens (chiffre de T4 notamment) et traitements en cours peut se révéler extrêmement utile et vous faire gagner du temps et de la salive ! Faites votre CV médical !
Le tableau qui suit indique les principaux symptômes qui doivent alerter. Attention, cette liste n'est pas exhaustive ! Bien entendu, chaque situation est particulière. La fièvre est très souvent associée à ces symptômes. Elle est définie par plus de 37°3 le matin et/ou plus de 37°8 le soir. Son degré et son caractère évolutif peuvent orienter déjà le diagnostic, ainsi que des frissons. En cas de fièvre nue (sans autre signe), des hémocultures (examens du sang, pour y détecter la présence de bactéries) et une batterie d'examens complémentaires seront demandés, en hospitalisation ou non selon l'urgence. Un traitement antibiotique à l'aveugle (sans cause prouvée) est rarement nécessaire sauf critère de gravité. À l'inverse des mesures symptomatiques (oxygène, perfusion, intubation, corticoïdes, Valium®õ) qui peuvent être mises en Čuvre immédiatement si nécessaire.
Rappelons que l'EXAMEN CLINIQUE méticuleux par le médecin commence toujours par la recherche du diagnostique. Et suffit souvent à rassurer tout le monde !
René FROIDEVAUX
|
Symptômes (avec ou sans fièvre) |
Signes cliniques de gravité |
Premiers examens (en plus du bilan biologique et si nécessaire des hémocultures) |
Principales causes liées au VIH |
Causes non spécifiques |
|
Respiratoires : Essouflement à l'effort, voire au repos. Crachat sanglant. Point de côté. |
Cyanose : ongles, lèvres violets. Sueurs. Epuisement respiratoire |
Radio thoracique face et profil. Fibroscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire. Gaz du sang. |
Pneumocystose Pneumonie bactérienne Tuberculose Kaposi pulmonaire. Pleurésie. Pneumothorax |
Anémie. Embolie pulmonaire. Asthme. ļdème pulmonaire. Cancer pulmonaire. |
|
Digestifs : Difficultés à avaler, vomissements + ou - sanglants Selles sanglantes ou noires Douleurs abdominales |
Déshydratation. Etat de choc. Hypotension artérielle. Anurie (pas d'urines). |
Fibroscopie gastrique. Coloscopie. Examens de selles. Radios et échographie de l'abdomen. |
Candidose Čsophagienne. Colite infectieuse (CMV, clostridium, crypto/microsporidiose) Kaposi ou lymphome digestif. Pancréatite (ddI, pentamidine). |
Ulcère gastrique. Urgences chirurgicales: appendicite, péritonite, cholecystite, fistule anale, occlusion intestinale... |
|
Neurologiques : Paralysie ou anesthésie d'un hémicorps. Perte de vision d'un côté.Crise d'épilepsie. Troubles de l'équilibre (paralysie faciale, tremblements permanents, ). Méningite = maux de tête, vomissements, fièvre. |
Somnolence. Obnubilation. Coma.
Hypertension intracranienne = maux de tête + vomissements + vue double |
Scanner cérébral. IRM. Eventuellement : - Ponction lombaire. - EEG |
Toxoplasmose cérébrale. Lymphome cérébral. Encéphalite (VIH, CMV, herpès). Polynévrite (VIH, antiviraux...). Polyradiculonévrite. Cryptococcose. Tuberculose. Méningite bactérienne. |
Epilepsie. Accident vasculaire cérébral. Tumeur cérébrale. |
|
Psychiatriques : Tentative de suicide. Hallucinations. Etat maniaque. Delirium tremens. |
|
Scanner cérébral |
Dépression. Bouffée délirante. Intoxication (amphétamines, alcool) |
Psychose maniaco-dépressive. Schizophrénie. Etat de manque (alcool, morphiniques) |
|
Ophtalmologiques : Tout trouble visuel. Kératoconjonctivite. |
Corps volants. Mouches flottantes. Voile devant un Čil. |
Fond d'Čil. +++ |
Rétinite à CMV. Lésion cérébrale (toxo...). Uvéite. Zona. Herpès. |
Conjonctivite banale (bactérienne ou allergique). |
|
Cardiologiques : Douleur thoracique. Essouflement. |
Cyanose. ļdème pulmonaire. |
Electrocardiogramme. Echographie cardiaque. |
Péricardite (tuberculose...) Endocardite (usagers de drogues). Myocardite (VIH, médicaments). |
Infarctus du myocarde. Hypertension artérielle. |
|
Dermatologiques : Purpura (petites tâches rouges, surtout aux membres inférieurs). |
|
Numération formule sanguine. Chiffre de plaquette. Fond d'Čil. |
Thrombopénie (baisse du nombre de plaquettes). |
|
|
Allergiques : Rougeur cutanée généralisée.ļdème du visage, de la gorge. Urticaire. Démangeaisons. |
Signes respiratoires. Etat de choc. Hypotension artérielle. |
|
Antibiotiques : sulfamides (Bactrim ++) |
Alimentaire. Aspirine. Bêta-lactamines : Pénicilline, Clamoxyl, Augmentin... |
|
Usagers de drogues intraveineuses |
Coma + pupilles serrées + respiration lente = overdose Abcès cutanés, septicémie, endocardite. |
| ||
|
Porteurs de cathéter veineux central : Fièvre élevée. Peau rouge. Douleur à l'emplacement du cathéter. |
Frissons pendant la perfusion ou lors du rincage du cathéter. Etat de choc. |
Hémocultures. |
Septicémie sur cathéter |
|
La seconde conférence américaine sur les maladies rétrovirales s'est tenue fin janvier à Washington (les rétrovirus sont une famille particulière de virus, dont fait partie le VIH). Deux sujets ont tenu la vedette : les antirétroviraux (médicaments anti-VIH), d'une part, et les traitements du CMV (cytomégalovirus), d'autre part.
Médicaments anti-VIH
Deux thèmes ont donné lieu à de multiples présentations : le 3TC (voir l'éditorial de ce numéro ainsi que le dossier sur les antirétroviraux) et les inhibiteurs de la protéase virale. Ces derniers (aussi appelés antiprotéases) ont fait l'objet de plusieurs essais visant à mesurer leur toxicité et leurs effets à court terme. Ces essais ont révélé qu'une protéine présente dans le sang s'attache à certains inhibiteurs de la protéase, réduisant leur pénétration dans les cellules infectées et donc leur efficacité. Les molécules des laboratoires Searle (SC 52151) et Wellcome (141W94) semblent les plus touchées par ce problème. Les inhibiteurs ABT 538 (Abbott), MK-639 (Merck), AG 1343 (Agouron) et saquinavir (Roche) semblent moins affectés par ce phénomène, et gardent une efficacité certaine, au moins à court terme. Ces quatre molécules font aujourd'hui l'objet d'essais cliniques pour évaluer leur efficacité sur un à deux ans.
Concernant le saquinavir, une petite étude sur 40 personnes a étudié les effets de son administration à fortes doses. La dose de 7,2 grammes par jour (soit 6 fois la dose testée aujourd'hui !) s'est montrée la plus efficace pour réduire la charge virale (la quantité de VIH présente dans le sang) et augmenter les taux de T4 pendant 6 mois. Malgré ce dosage très élevé, seuls quelques cas de diarrhées et de chute transitoire des globules blancs ont été observés.
Charge virale
De nombreuses présentations ont exploré les relations entre la charge virale (quantité de VIH présente dans le sang) et la progression de l'infection par le VIH. Des échantillons provenant de quatre essais cliniques ont été analysés. Ils indiquent que la diminution de la charge virale moyenne d'un groupe comportant un grand nombre de patients prédit une progression plus lente de la maladie, au sein de ce groupe. Cette information devrait être bientôt validée par des essais conçus à cet effet. La charge virale servira alors à reconnaître, dans le cadre d'essais cliniques, les associations de molécules les plus prometteuses. Sans avoir à attendre que les participants développent des infections opportunistes.
Par contre, il est beaucoup trop tôt pour savoir si les variations de la charge virale d'UN patient peuvent être utilisées pour décider de changements dans le traitement de cette personne. Des essais complexes, dits «de stratégie», se mettent en place aux États-Unis et en France, pour évaluer la place de la charge virale dans le suivi individuel des personnes séropositives.
CMV (cytomégalovirus)
Plusieurs présentations ont confirmé ce qui avait été pressenti lors de la conférence ICAAC (voir Remaides n°15) : le traitement et la prévention des infections à CMV évoluent et deviennent plus souples. Cette infection touche souvent l'Čil (provoquant une rétinite), chez les personnes ayant moins de 50 T4/mm3. Elle ne bénéficiait pas jusqu'ici de traitement préventif (pour éviter l'infection) ; son traitement curatif (une fois l'infection déclarée) est rigide et lourd (Cymévan® ou Foscavir®, en perfusions intraveineuses quotidiennes). La conférence de Washington a confirmé l'efficacité de deux nouveaux modes d'administration du Cymévan® : les gélules et les implants intra-oculaires.
Cymévan® en gélules
Le Cymévan® oral (en gélules) a fait l'objet d'essais à la dose de 3 g/jour (soit 12 gélules, prises en 3 fois, avec les repas afin d'améliorer l'absorption du médicament par le tube digestif). Ce médicament présente un intérêt dans deux situations différentes :
- Pour éviter les rechutes, chez les personnes qui ont déjà eu une rétinite à CMV. L'efficacité des gélules est moindre que celle des perfusions, mais suffisante pour permettre de les utiliser chez les patients ne pouvant pas bénéficier de perfusions, ou désirant les interrompre pour une courte période (vacances, par exemple).
Le Cymévan® en gélules a obtenu son AMM (autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministère de la Santé) pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de perfusions. Dans cette indication, ce médicament est disponible dans les pharmacies hospitalières (en 1996, il le sera en pharmacie de ville).
Par ailleurs, le traitement par voie orale peut probablement être amélioré par des injections hebdomadaires de Cymévan® directement dans l'Čil atteint (impressionnant, mais peu douloureux).
- Les gélules de Cymévan® semblent également efficaces pour retarder l'apparition d'infection à CMV chez les personnes ayant moins de 50 T4/mm3 (et n'ayant jamais eu de maladie due au CMV). Lors d'une étude de 18 mois portant sur 725 patients, l'administration de gélules de Cymévan® a diminué la fréquence des infections à CMV de moitié (17 % contre 31 % pour le groupe placebo). Cependant, on peut se demander si ce traitement ne favorise pas l'apparition de CMV résistant au Cymévan®, ce qui rendrait ensuite le traitement plus difficile en cas d'infection déclarée. Par ailleurs, le Cymévan® oral peut avoir des effets secondaires : baisse de certains globules blancs (neutropénie), des globules rouges (anémie), diarrhée, nausées.
Un programme « compassionnel » d'accès au Cymévan® en gélules, pour les personnes ayant moins de 50 T4/mm3, et n'ayant jamais eu de maladie due au CMV, s'ouvre au début de l'été 1995.
Implants de Cymévan®
Les minuscules implants intra-oculaires de Cymévan® sont placés directement à l'intérieur de l'Čil. Ils ne gênent pas la vision. Ils diffusent du Cymévan® pendant 8 mois en moyenne. Ils doivent donc être changés régulièrement. Deux études présentées à Washington ont démontré leur efficacité dans le traitement des rétinites à CMV. L'une d'entre elles a comparé sur 188 patients les effets de ces implants par rapport aux perfusions de Cymévan® classiques : l'Čil des personnes recevant des perfusions a rechuté en moyenne en 2 mois, alors que l'Čil des personnes recevant un implant a rechuté en moyenne en 6 mois. Cependant, ces implants ne protègent que l'Čil où ils sont implantés (alors que les perfusions ou les gélules traitent l'ensemble du corps). Leur mise en place doit être effectuée par un médecin ophtalmologue expérimenté, pour réduire le risque d'hémorragie de l'Čil. De plus, il semblerait que la présence d'implant augmente la fréquence des décollements de rétine.
Le groupe TRT-5 (Actions-Traitements, Act-up, AIDES, Arcat-sida, VLS) a demandé aux laboratoires Chiron (qui fabriquent ces implants) l'ouverture d'un programme « compassionnel ». Réponse cet étéõ
Traitements du CMV : le futur
On pourrait se diriger vers le schéma suivant :
- Pour les personnes développant une rétinite à CMV, un traitement d'attaque par perfusion, suivi d'un traitement d'entretien à base de gélules et d'implants de Cymévan®. Des essais cliniques sont en cours pour comparer ces différentes modalités et identifier la meilleure façon de traiter le CMV tout en préservant la qualité de vie des patients.
- Pour les personnes ayant moins de 50 T4/mm3, n'ayant pas eu de maladies dues au CMV, mais estimées « à risque » pour cette infection, une prévention par gélules de Cymévan® est envisageable. Le concept de « risque » est encore mal défini et varie selon les pays. Les médecins américains pensent que l'augmentation des taux d'anticorps contre le CMV dans le sang, ou la présence de CMV dans les urines peut annoncer une infection à CMV. De plus, une étude a montré que les personnes ayant développé une mycobactériose atypique (MAC) ont plus de risques d'avoir une infection à CMV.
Cidofovir (HPMPC)
Une nouvelle molécule est à l'étude dans le traitement des infections à CMV et autres herpèsvirus : le cidofovir (ex-HPMPC). Une étude sur 48 personnes souffrant de rétinite à CMV a montré que cette molécule est très efficace mais assez toxique pour les reins et les globules blancs. Elle est administrée en longues perfusions (12 heures en comptant les perfusions annexesõ) deux fois par semaine pendant le traitement d'attaque, et une fois par semaine en traitement d'entretien. D'autres études sont en cours : injections intra-oculaires de cidofovir (en cas de rétinite à CMV) ; pommade au cidofovir (pour les lésions d'herpès classique).
Moins de 10 T4
Plusieurs présentations se sont penchées sur les traitements des personnes très immunodéprimées (moins de 10 T4). À la question « doit-on continuer à prendre des antirétroviraux lorsqu'on a moins de 10 T4 ? », les réponses étaient plutôt en forme de questions. Il semble clair que les personnes n'ayant jamais reçu de traitement antirétroviral et ayant peu de T4 bénéficient d'un tel traitement. Mais la question reste entière pour les patients qui ont derrière eux des années de traitement par ces molécules. Les problèmes de résistance du VIH, des nombreux autres médicaments pris à ce stade, de la plus grande sensibilité des personnes immunodéprimées aux effets secondaires des médicaments et la notion de qualité de vie doivent être pris en compte par le médecin et le patient.
Stéphane KORSIA
Les 28 et 29 mai derniers s'est déroulée à Cannes une conférence internationale sur le thème « Nutrition et VIH ».Voici quelques thèmes qui y furent abordés :
La dénutrition est une cause de mortalité à part entière, au même titre que les maladies opportunistes. À un stade avancé de la maladie, la dénutrition permet mieux de prédire l'espérance de vie que la mesure des T4. Un des objectifs majeurs de la prise en charge des personnes atteintes est donc la lutte contre l'amaigrissement. Ses enjeux : une meilleure résistance aux infections et une amélioration de la qualité de la vie.
Comment ? Les réponses restent encore incomplètes, de l'aveu même des chercheurs. Une seule règle fait cependant l'unanimité : mieux vaut prévenir que guérir. Une évaluation précoce de l'état nutritionnel et des conseils diététiques sont primordiaux, dès le stade asymptomatique de la maladie.
Des simples conseils de rééquilibrage de l'alimentation jusqu'à l'alimentation par voie veineuse (dite alimentation parentérale), il existe de multiples possibilités pour lutter contre la perte de poids, toutes compatibles avec une vie active et dont aucune n'est à négliger.
De l'intérêt d'une supplémentation en minéraux et en vitamines, on retiendra surtout l'absence de consensus. Priorité doit être donnée à la lutte contre les carences avérées (diagnostiquées avec un examen sanguin spécifique) en vitamines du groupe B (surtout B12 et B6), et en antioxydants (vitamines C et E, bêta-carotène, zinc et sélénium). Attention à la supplémentation « sauvage » : l'excès de zinc, par exemple, est nuisible au système immunitaire.
Enfin, l'utilisation d'hormones anabolisantes pour stimuler la prise de poids est une voie de recherche intéressante mais surtout efficace lorsqu'une activité physique est possible.
Maryse KARRER
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Maryse KARRER, diététicienne à AIDES Fédération . Tél. : (1) 53 26 26 72) ou Martine LECOMPTE, diététicienne à AIDES Ile-de-France ((1) 44 52 33 49), qui ont assisté à ce congrès.
C'est à Florence, du 26 au 30 mars, qu'a eu lieu la 6e conférence internationale sur la réduction des risques. Bernard Kouchner a prononcé l'allocution d'ouverture, en insistant sur l'évolution et l'extension du phénomène « drogues » : 300 000 utilisateurs en France, 1,85 million dans la CEE. Contrairement au début des années 70, où faire usage d'une drogue était une attitude contre-culturelle, c'est devenu une banalité, expression d'un malaise social, symptôme d'un manque d'espoirs, de rêvesõ
La plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que la répression et la criminalisation font beaucoup plus de dégâts que les drogues elles-mêmes, à part peut-être le crack, dont les méfaits sont unanimement reconnus et dont l'usage se répand de façon de plus en plus alarmante en Angleterre et aux États-Unis. Pour ce produit, il n'existe aucune substitution efficace. La grande majorité des consommateurs de crack sont des gens en situation de très grande précarité, avec peu ou pas du tout de perspectives d'avenir.
Les Suisses, les Hollandais, les Canadiens, les Australiens sont en train de tenter des expériences apparemment concluantes de distribution contrôlée d'héroïne. Tim Rhodes, un ethnologue anglais, nous a démontré, chiffres à l'appui, que les usagers de drogues désinhibantes (cocaïne, ecstasyõ et alcool) se protégeaient moins lors des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels. Pat O'Hare, l'un des organisateurs, a insisté sur le fait qu'il est plus important de réduire les comportements à risque que l'usage des drogues. Les soignants doivent arrêter de faire obstacle à ces changements indispensables, cesser d'être trop directifs. Ils ne doivent plus voir le sevrage comme une fin en soi.
Aux USA, la vente libre des seringues est interdite (pression des lobbies chrétiens fondamentalistes et de la middle class politically correct). Tout au plus tolère-t-on quelques programmes municipaux dans les très grandes villes (New-York, Philadelphieõ). Pourtant, toutes les études montrent l'importance des programmes d'échange de seringues, pour réduire la séroprévalence du VIH et des hépatites B et C.
Côté français, Cocorico ! Anne Copel a obtenu le prix Rolleston, pour son implication dans la politique de réduction des risques. Et le magazine ASUD (auto-support usagers de drogues) a eu un très grand succès. On regrettera toutefois que, pendant cette conférence où il n'a été question que d'usagers de drogues, ceux-ci, quoiqu'invités et représentés, n'aient, une fois de plus, pas eu droit à la paroleõ
Jimmy et Phuong
(AIDES Ile-de-France, groupe AUDVIH : Aide aux Usagers de Drogue confrontés au VIH).
Je suis salarié à temps plein depuis mars 93 et j'ai une carte d'assuré social à 100 %. En octobre 94, je fais faire des examens dans un laboratoire d'analyses. Lorsque je vais les reprendre, on me dit que je dois payer mes analyses, parce que je ne suis plus assuré social. Je m'étonne. Le laboratoire appelle mon centre de Sécu (CPAM de Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis), qui confirme : je ne suis plus assuré social. Cette caisse de Sécurité sociale exige que je me présente dans ses bureaux, avec 3 fiches de paye. À partir de ce moment-là, il me faudra attendre 10 jours pour être à nouveau assuré social.
Je vérifie auprès de mon employeur qu'il a bien versé les cotisations de Sécurité sociale me concernant. Aucun problème de ce côté-là. J'explique à la caisse de Sécu que je suis séropo et ne peux pas me permettre de ne pas être assuré pendant 10 jours. Je propose d'envoyer des photocopies de mes fiches de paye. Rien à faire.
Furieux d'être puni pour une erreur commise par la Sécurité sociale, je menace de venir avec tous les papiers demandésõ et des journalistes, et de foutre le bordel dans ce centre. À partir de ce moment-là, le problème se résoud miraculeusement vite. La Sécu envoie une personne, à qui je remets les documents et l'affaire est réglée !
O.T.A.F.
Cher Monsieur,
Je comprends mal pourquoi dans les infos de TRT5 (REMAIDES n°15 du 1er février 1995) vous publiez des informations inexactes. Je ne vois pas comment nous pouvons envisager des collaborations utiles si vous ne vous renseignez pas avant d'écrire.
Certes l'essai des Docteurs Vittecoq et Lefrère (1) ne porte pas de numéro ANRS mais toute la virologie de cet essai, soit 416 000 francs, a été payée par l'ANRS pour cet essai.
En ce qui concerne l'immunothérapie passive d'une façon générale, le problème n'est pas de s'y intéresser ou non, c'est de trouver un protocole qui ait le moindre sens et nous pouvons avoir quelques doutes sur les possibilités d'y aboutir à courte échéance, et ce pour des raisons techniques sur lesquelles l'ANRS est tout à fait prête à vous donner des explications. Elle l'a d'ailleurs fait à répétition dans les réunions d'associations.
Je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(1) Note de la rédaction : l'essai d'immunothérapie passive IP002, conduit par les Drs Vittecoq et Lefrère, consistait à prélever du plasma riche en anticorps anti-VIH chez des personnes séropositives en bonne santé, à le chauffer pour inactiver le VIH et à le transfuser à des personnes malades du sida.
Cher Monsieur,
Nous sommes flattés de l'attention avec laquelle vous lisez Remaides. Cependant, votre réponse montre bien l'ambiguïté de votre position vis-à-vis de l'immunothérapie passive :
D'un côté, vous montrez un grand scepticisme de principe à l'égard de l'immunothérapie passive, notamment au cours des réunions avec les associations.
De l'autre, vous réagissez vivement quand on écrit que le sujet n'intéresse pas l'ANRS. Et vous rappelez que l'agence que vous dirigez a payé les frais de virologie (ce que nous savions, puisque vous l'aviez dit au cours d'une réunion avec les associations).
Cependant, il est clair que si l'immunothérapie passive ne constitue pas aujourd'hui une possibilité de traitement, elle représente une voie de recherche intéressante. Ne méritait-elle pas d'être explorée ? Pourquoi négliger cette piste ? Un investissement plus précoce et plus soutenu de l'ANRS (institution dont vous dites vous-même qu'elle ne manque pas de moyens financiers) n'aurait-il pas permis d'obtenir un peu plus tôt des résultats un peu plus clairs ?
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre revue, nous vous prions, cher Monsieur, d'agréer nos meilleures salutations.
Vous souhaitez nous écrire et faire part de vos commentaires. N'hésitez pas.
Vous pouvez, si vous le souhaitez recevoir REMAIDES chez vous. Pour cela il suffit de nous écrire à :
AIDES
REMAIDES
247, rue de Belleville
75 019 PARIS
Directeur de la publication :
Pierre LASCOUMES
Comité rédactionnel :
Agnès CERTAIN
Hervé CREUSVAUX
Dominique FAUCHER
René FROIDEVAUX
Stéphane KORSIA
Yvon LEMOUX
Bernard NICOUD
Thierry PRESTEL
Alain PUJOL
Emmanuel TRÉNADO
À la mémoire des membres du comité rédactionnel morts du sida :
Philippe BEISO, Richard DAVID, Christian MARTIN
Coordinateur :
Thierry PRESTEL
Maquette et mise en page :
Alain MACÉ
Emmanuel TRÉNADO
Remerciements à :
KROMOSCAN (pour la photogravure), à CHÉREAU (pour le dessin), à Frédéric VIELCANET (pour les photos) et à Jean-François DEBONO pour la relecture.
REMAIDES est édité à 20 000 exemplaires et diffusé gratuitement par l'association AIDES, Ile-de-France 247 rue de Belleville 75019 Paris. Tél. : 44 52 00 00, Télécopie : 44 52 02 01,
REMAIDES, Tél. : 44 52 33 79. Minitel : 36 15 AIDES.
Les informations contenues dans REMAIDES peuvent être reproduites, sous réserve de mention de la source. Impression : IMPRIMAINE 72650 La Chapelle St Aubin.
SIDA INFO SERVICE répond par téléphone à toutes les questions concernant l'infection à VIH et le sida. Numéro vert (appel gratuit) : 05 36 66 36 (24h/24).
SIDA INFO DROIT répond par téléphone à vos questions juridiques concernant la séropositivité et le sida (droit du travail, assurances, successionõ). Numéro de téléphone azur (0,73 F. l'appel) : 36 63 66 36, uniquement le mardi, de 17h à 22h.
ISSN : 11620544