

PLANTU pour Remaides
Remaides est un trimestriel d'informations médicales sur l'infection à VIH.
Ce numéro spécial de REMAIDES donne la parole, ou plutôt la plume, à des séropositifs, malades ou non du sida. Il s'agit davantage de réflexions personnelles sur leur parcours avec le VIH que de témoignages sur un problème médical précis, comme nous le faisons d'habitude.
Ce numéro spécial esquisse également un bilan succinct des actions menées depuis le début de l'épidémie par les différents gouvernements. Daniel DEFERT, fondateur en 1984 de l'association AIDES, nous livre son point de vue personnel.
Quinze ans d'épidémie, deux septennats. Beaucoup n'a pas été fait. Ou trop mollement. Le sida suscite pourtant des questions cruciales de santé publique : dépistage, sang contaminé, réduction des risques, exclusion, prévention, droits des étrangers, etc. Le quart-monde paye un lourd tribut.
Alors que les médias façonnent une campagne électorale particulièrement terne, le débat éthique et politique n'a une fois de plus pas eu lieu. L'urgence n'est pas perçue. Le sida n'a pas la place centrale qui (malheureusement) lui revient dans les priorités de nos futurs élus. Il y va de la survie de la société toute entière ! Plus facile de pêcher les voix des médecins que celles de leurs malades !
René FROIDEVAUX
Je remercie le gouvernement, Alain
La séance d'aérosols, Eric
Le double traitement, Eric
Soignants mal informés ?
Amour, peine et latex
"On s'accroche à la vie", m'avait dit mon parrain de AIDES avec un sourire si calme et si peu moralisateur, que je m'étais dit en faisant un rapide remake de la mienne complètement destroy, qu'il y avait là peut-être une pointe de vérité. La première phrase du premier jour de ma formation de volontaire prononcée par Jean-Claude B. fut : « être volontaire à Aides ce n'est pas un accompagnement à la mort c'est au contraire un accompagnement à la vie ». Toute ambiguïté était levée et suscitait dès lors une énigme : vivre avec, alors que la presse, les médias, nous bourraient le crâne du contraire.
En 1992, une éditrice m'a renvoyé un manuscrit que j'avais écrit en me disant hargneusement : « Guibert a clos le chapitre sur le sida ; et alors ma belle, la toxicomanie n'en parlons même pas, cela n'intéresse plus personne !ä Ça pour écrire vous savez écrire, vous êtes une très bonne romancière, mais vous savez, le sida, insista-t-elle, on en meurt, on en meurt vous savez ! ». Silence devant ma sidération, elle reprit : « Vous n'auriez pas quelque chose d'autre, de moins rebutant à me proposer ? ». Très peu de temps après, les vautours avaient déniché Cyril Collard qui a fait couler pas mal d'encre passant du statut d'ange à celui de démon.
Il était une fois
Génération soixantuitarde, baba cool, Mai 68, l'Inde, l'Asie, le voyage, la défonce, c'était beau comme dans le film « More » de Barbet Schroeder. L'aiguille était nickel et avait une odeur de révolteä Évidemment, je fonçais dedans, mes veines en prirent un coup, et les grains de poudre qui me débarrassaient de mon mal de vivre au début furent vite badigeonnés du mot galère.
S'en sortir, c'était le premier objectif de chaque toxicomane, pendant qu'il s'envoyait son shoot : « c'est le dernier, demain j'arrête ». Bonne parole, après avoir fait la queue dans un squat à dix sur une seringue ; puisque nos copains, les pharmaciens sympas, daignaient nous vendre au bout de la n-iéme boutique, le fameux vaccin antigrippe accompagné de la shooteuse. Entre l'aiguille commune et le Néocodion, notre santé vacillait et quand les premières rumeurs vinrent des States : sida-homos tombent comme des mouches, l'info était loin loin loinä
Alors vinrent les bons samaritains, genre Monsieur le Docteur Olivenstein à qui j'ai proposé plus tard mes services en le rencardant quand même que j'étais séropositive et qui m'a répondu texto de sa voix bourrue, qu'il n'en avait rien à foutre et que c'était mon problème.
Les docteurs qui ont bien voulu nous sauver nous proposèrent les sevrages de l'époque où l'on n'avait plus le droit d'écouter les Rolling Stones, des fois que ça nous remettrait dans l'ambiance.
Sortie d'affaire par un acharnement acharné, je n'avais qu'un seul désir : « être beau et con à la fois » c'est à dire être comme tout le monde : maison, bébés, amour, boulotä le rêve.
Bonheur
Et cela s'est passé comme dans ce rêve où mon corps a appris la vraie chaleur du soleil, la pluie qui mouille et autres broutilles comme d'acheter un disque, en m'étonnant que le vendeur me rende la monnaie. L'eau ne me faisait plus peur, la sueur puante du manque ne tombait plus glaciale sous mes aisselles, enfin le vrai froid, chaud, boire, manger, dormir, aimer enfin au naturel.
Le 8 Août 85 un enfant est né en pleine forme et il y avait même le papa qui allait avec. J'étais réconciliée avec la vie, j'avais quelqu'un au bout de mes doigts à aimer et il m'en fallait plein d'autres comme ça.
Super boom patatrac ! autour de mon bidon presque gros de 6 mois, un zona se développe en même temps qu'on commence à parler du VIH, et mon instinct me fait faire le test. Coup de fil du labo assassin pour m'annoncer sans ménagement - en m'engueulant - ma séropositivité.
Patratrac
Port Royal, service maternité, cinq minutes pour choisir, à l'époque 60 % de chances que le bébé soit infecté, on ne savait rien de rien et les médecins avaient un regard inquisiteur en me faisant comprendre que le garder était criminel. Douleur, affolement.
Alors moi je m'en foutais du VIH, fallait surtout pas en parler et naïvement on a pensé qu'on pourrait oublier, le passé de tox, le bébé raté, et que la science allait faire vite puisque dans un an, m'avait-on promis , on trouverait quelque chose : « c'était trop grave ».
Mais les années passent sur la déprime où je néglige le premier enfant, le mari et mon corps.
«Oubliez, me disaient les médecins, ayez une vie saine et vous vivrez comme tout le monde, vous ne tomberez pas malade». J'ai mis un scotch sur ma mémoire pendant des années. Mais le virus avait la santé, et fit quelques polyradiculonévrites qui me plantèrent sur une chaise roulante. Les kilos partaient, la faim aussi, la gueule des gens du quartier devant mon physique chamboulé ; que m'était-il arrivé ?
Le tournant
Bizarrement, j'ai réappris à vivre, en rencontrant des gens comme moi, après avoir écrit le livre que les éditeurs m'ont renvoyé en plein bide. Des amis sont partis, avec qui j'ai fait un bout de chemin.
Aujourd'hui la pluie tombe, il fait nuit dehors, le vent souffle et c'est comme cela que je pourrais commencer un nouveau roman, celui des gens qui vivent avec, pressés de tout, mais tremblant toujours un peu quand le téléphone sonne pour annoncer quelque chose qui fera de la peine.
Sale époque ? génération sidaä « pour l'instant vivez », m'a ordonné le docteur R. quand je lui réclamai le droit à la dignité, si jamaisä Il me répondit : « pour la qualité de la vie on verra plus tard ! ». Comment lui en vouloir, après toutes ces années d'études où on lui a dit qu'il allait soigner et guérir, alors qu'il voit les hôpitaux se remplir d'une clientèle nouvelle, jeune, et pas faite pour prendre des médics à 20, 30, 40 ans. Des malades qui veulent vivre coûte que coûte, sans s'effrayer de la blouse blanche.
Quelquefois j'enrage de voir des gens en bonne santé et ne rien faire de leur temps, alors que moi j'ai tant de choses encore à faire, vite, faire, écrire, témoigner, surtout ne pas oublier.
Savoir que pour nous un déjeuner de décalé, c'est toute une organisation à reconstruire, à articuler avec les rendez-vous des médecins, des labos, et surtout de la vie sentimentale tout en sachant que demain, on sera peut-être patraque, même si on nous croise avec le sempiternel « ça va ? » forcément on répondra que : « oui, ça va bien ! ».
Bonjour
Insomnies, 5 heures du mat', c'est là que je suis bien, tellement sereine, en pensant à mon programme de demain. J'ai l'impression de toucher la vie comme on soupèse sensuellement un tissu d'une inimaginable densité, entre mes deux doigts. Je ne dirais pas que le VIH rend heureux, mais sa perversion nous permet un fusionnement tellement profond et intime qu'il intensifie la sensualité à la vie. Ces courts moments valent le temps qu'on s'y fonde.
Le rituel veut ensuite que je ferme la fenêtre, je fais le tour de la maison, je recouvre mon fils, avec cet éternel tourbillonnement dans ma tête qui m'interroge, lui dire ou ne pas lui dire.
Le réveil sonne, petit déj', agitation, autour d'une vie aménagée comme celle de tout le monde mais si différente.
Christine WEINBERGER
Je survis avec le VIH depuis environ 5 ans. C'est pourtant peu de temps mais j'ai tout perdu. Je paye les erreurs de par la dope et d'avoir trop aimé les femmes. Je ne regrette rien. Vivre jeune, mourir vite !!
Les conséquences sur le plan personnel : quand je me réveille le matin, je suis mort. Professionnel : ambiance tendue. Côté amoureux, y'a plus rien. On ne gère pas sa relation avec le virus, c'est lui même qui nous gère, en ce qui me concerne.
Je hais toutes ces pubs qui nous font croire au bonheur, et nous ouvrent ces portes sur l'avenir.
Je remercie le gouvernement pour cette 3ème guerre (sang contaminé, prohibition de la dope, seringue interdite, et le manque de communication, information 10 ans après que le mal soit fait).
Alain
Mon histoire débute en 1982, au paradis (des amoureux) : je rencontre le « jeune homme de ma vie », nous sommes dans la même année d'études médicales et l'avenir est à nous. Un nuage vient assombrir le rêve en 1983 : mon intradermo annuelle devient négative ; des examens biologiques montrent un syndrome inflammatoire. Plus tard, je comprendrai que c'étaient les premiers signes d'infection par le VIH. Mais, pour le moment, tout va pour le mieux, nous devenons tous deux internes à Parisä
On entend çà et là parler de cancer gay mais cela ne peut nous concerner ! Pourtant l'idée fait son chemin, et nous allons en 1985 consulter un illustre professeur d'immunologie à l'hôpital St-Louis. Il est très embarrassé de nous annoncer qu'effectivement, ce nouveau virusä et mon ami serait plus gravement atteint, du moins biologiquement. Quelques mois ou années au maximum ? C'est impossible, notre forme est éblouissanteä Que faire quand il n'existe aucun traitement, quand on ne sait rien ? Se raccrocher à ces supposés 90 % d'infectés qui ne seront pas malades et essayer d'oublier le troublion.
Quatre taches suspectes
Un ami bisexuel meurt en 1985 d'une encéphalopathie. Bigre !
L'année suivante, au cours d'un voyage en Égypte, je découvre quatre taches suspectes sur mes chevilles. Impossible de ne pas paniquer, l'ennemi est là. Confirmation par une biopsie. Le sida est donc déclaré d'après la définition de la maladie, et la survie s'annonce de courte durée d'après les statistiques de l'époque. Mais mon immunité est encore bonne, reste à prendre une décision de traitement. Trois mois de consultations et de lectures : il faut absolument vous procurer de l'AZT aux États-Unisä il n'y a qu'une forte chimio qui puisseä ne faites rienä pas d'hésitation, une cure d'interféronä C'est cette dernière proposition que je choisis. Heureusement les injections sont efficaces et mon immunité reste satisfaisante. Je me rassure et travaille intensément.
Médecins et malades
C'est peu après que tout bascule pour mon ami : il perd 10 kg, fait un muguet, devient fatigué. Ses T4 chutent. Pas facile d'être médecins, très informés, et malades. Les relations avec les confrères changent du jour au lendemain : on se vouvoie, même si on se tutoyait auparavant. Un médecin utilise même « vous » en consultation et « tu » dans les rapports professionnels ! Heureusement, certains ont l'intelligence de maintenir une proximité chaleureuse tout en offrant humblement leur compétence. Est-ce un avantage d'être médecin soi-même ? Oui car toutes les informations sont accessibles et on comprend le jargon. En outre on reconnait plus facilement les bons des moins bons collègues. Un excellent indice de qualité : ceux qui savent répondre « je ne sais pas, allez voir untel de ma part ». Pour les qualités humaines, c'est différent.
Nous nous sommes lancés tous deux dans la bataille, de toutes nos forces. Toxoplasmose, mycobactériose, candidose, atteinte cardiaque, rétinite : chaque infection a été maîtrisée. Mais un lymphome l'a tué en 1991. Et avec lui tous nos rêves.
Difficile de parler du deuil, de la douleur, de la séparation, du désespoir et du videä Ce sont nos propres tripes qu'on arrache. Comme durant la maladie, ce sont les familles, les amis et le volontaire de AIDES aux malades qui m'ont permis de ne pas basculer et de préserver, peut-être idéalisés mais qu'importe, ces souvenirs de bonheur et de lutte.
Atterrissage
De retour sur terre, je devais reprendre le travail, même si je m'étais orienté par nécessité depuis trois ans vers un secteur bien moins astreignant, plus lucratif certes mais aussi bien moins intéressant. Faire correctement son travail, quel qu'il soit, c'est déjà en soi une satisfaction. Savoir écouter l'autre quel qu'il soit.
Malade moi-même, je devais préparer les années à venir car la seule idée d'être dépendant d'autrui, de ne pas maîtriser ma vie, me ramenait à mes premières années de médecine quand il m'avait fallu travailler la nuit pour vivre comme je l'entendais. Idée obsédante. La liberté, lorsqu'elle est possible, a un prix : la volonté. Si j'ai un conseil à donner aux séropositifs après toutes ces années, c'est celui-là : organisez votre avenir ! C'est quand le temps nous est compté qu'on en prend la mesure.
Préservatifs
Comme me l'avait prédit et souhaité mon ami, j'ai le bonheur de tomber amoureux et d'investir dans une nouvelle relation. Après des débuts safe (safer plutôt), mon nouvel ami refuse de se protéger à partir du moment où nous décidons de vivre ensemble : pendant près de six mois. J'ai mis tout ce temps pour le convaincre. Séronégatif, cela ne lui faisait nullement peur d'être contaminé : quelle preuve d'amour embarrassante ! Et comment ai-je pu l'accepter, ayant vécu et vivant le sida dans ma chair ? Maintenant encore, je n'ai pas d'explication autre que l'inconscience qui accompagne parfois la passion. Mais il est resté séronégatif et a accepté les préservatifs. Sa vie ultérieure n'est pas obérée. Le rationnel peut-il atteindre le sexuel ? Par l'éducation très précoce peut-être, avant-même les premiers rapports sexuels. Et poursuivie sans relâche. Préservatifs gratuits. Seringues gratuites. Sinon seuls moines et nonnes survivront (et encore) !
Destructions
En 1992, mes T4 s'effondrent de 400 à 10 en moins de 6 mois. Rien n'y fait : passage à la ddI (dégueulasse) puis à la ddC (neuropathie). Depuis, les infections se succèdent : tuberculose ganglionnaire, toxoplasmose cérébrale (trois abcès), colite pseudo-membraneuse puis colite à CMV, infections bactériennes récidivantes : 5 pneumonies (10 fibroscopies), moûlt sinusites et otites (intervention chirurgicale), septicémie sur cathéter, prostatite, candidose ¶sophagienneä
La maladie de Kaposi me pose de gros problèmes psychologiques, car ce sont maintenant environ 200 taches noires ou violettes qui parsèment mon corps, plutôt ce qu'il en reste. Ce n'est pas douloureux, juste un peu d'¶dème d'une cheville, mais c'est très moche. J'ai eu plusieurs chimiothérapies depuis deux ans et n'ai pas d'atteinte profonde (objectif premier du traitement).
Mon image physique est importante, sa représentation mentale surtout, ce qui est somme toute assez normal à mon âge. Le Kaposi s'ajoutant à une fonte de plus de 20 kg et aux diarrhées incessantes, j'ai rejetté ce corps détruit. Difficile de rester indifférent aux regards des autres, l'été surtout. Je n'arrive pas à les ignorer, et préfère ne plus m'exposer. Finis plages, piscines, shorts et débardeurs. Bien entendu, on peut vivre sans mais ma libido s'est effondrée, en partie aussi du fait d'une grande fatigue physique. Lorsque le Kaposi s'est attaqué à mon visage, cela a été une nouvelle épreuve. J'assume assez mal les modifications physiques rapides de mon corps et elles contribuent à un état dépressif chronique plus ou moins contrôlé chimiquement. Difficile de tirer un trait dessus. La baisse de mes facultés intellectuelles est réelle mais moins flagrante.
Je pense assumer bien par contre ma maladie. Je ne vois plus ceux qui ne l'acceptent pas. Parmi les collègues certains (rares) ont des craintes parfaitement irrationnelles et des comportements indignes. Il s'agit en règle des moins informés, comme souvent dans l'intolérance. Les dentistes particulièrement !
Mourir de faim ?
Je vomis quotidiennement depuis plus de deux ans, parfois tous les repas de la journée. La moindre toux me fait rejeter un repas patiemment ingurgité. Le manque d'appétit ne répond dans mon cas ni aux traitements hormonaux ni aux drogues douces. Et l'inexorable perte de poids, jusqu'à 25 kg il y a 6 mois, n'a pas été améliorée par les compléments nutritionnels (enfin remboursés). N'arrivant plus à avaler quoi que ce soit en raison de la candidose, j'ai décidé de débuter une alimentation par voie intraveineuse. Je me suis donc fait poser un cathéter. Pour contraignante qu'elle soit (10 heures de perfusion par jour), cette méthode m'a permis de prendre 10 kg, de reprendre la gym et même un peu le travail. Je vis quasiment une résurrection. Le moral a suivi. La contrainte est acceptable : on s'habitue à toutä Je trouve que cela aurait été dommage et stupide de mourir littéralement de faim en France en 1994. Pas vous ?
Un plein temps
De manière plus générale, je refuse (pour le moment) la résignation et l'attentisme. Je survis grâce à plusieurs traitements compassionnels : d4T, 3TC (antiviraux), itraconazole en suspension (pour les champignons), Neupogen (pour les globules blancs), Zophren (pour les vomissements) et j'en passe. Chacun améliore ma qualité de vie, sinon sa durée mais c'est moins important. Tout le monde y a droit. Bien entendu, pour bénéficier de ces soins « de pointe », il me faut passer beaucoup de temps chez les confrères : un généraliste et des spécialistes pour chaque organe malade, sans oublier la cervelle. Les attentes inutiles sont très pénibles (le service d'ophtalmo de la Pitié détient le record en la matière). Avoir une bonne mutuelle se révèle important si on préfère consulter en ville : le 100 % ne suffit pas.
Un plein temps qu'il ne m'est possible de réaliser que libéré de tout problème matériel : je continue à avoir des revenus suffisants pour me loger, manger, partir en vacances, sortir et prendre en charge l'étudiant qui partage ma vie et ma maladie et qui s'est formé aux soins infirmiers assez lourds que je requiers. Incontestablement, on vit mieux et plus longtemps si on est deux au front. Même si l'on se sent toujours très seul face à la souffrance, que je redoute davantage que la mort. Je bénéficie aussi d'un entourage formidable. L'amitié et l'amour sont mes plus puissants antalgiques. Finalement, grande est ma chance : il serait indécent de ne pas en tirer partie. Pour un beau concert, pour son rire ou les enfantsä des autres. Optimiste, moi ? Réaliste plutôt.
Au cours de ces huit années de sida, j'ai tout fait pour éviter d'être hospitalisé : on est tellement mieux chez soi et je suis assez maigre comme ça. Une seule fois, il y a deux ans, j'ai vraiment dû céder : j'avais 41° depuis deux jours et ne tenais plus debout. Mais je n'y suis resté que trois jours. Hôpitaux de jour, soins à domicile et autres portages de médicaments se sont certes beaucoup améliorés depuis quelques années, mais beaucoup reste à faire et il faut parfois les exiger pour en bénéficier. Ce n'est pas toujours évident, même lorsqu'on est médecin (ou ex) et même à Paris.
Vivre dignement et mourir serein, tout un programmeä De vie !
Richard

En janvier 1985, j'ai dû faire une primo-infection : je me réveillais plusieurs fois par nuit, en sueur. J'ai mis neuf mois à me décider à faire le test. Je l'ai effectué dans un laboratoire que je connaissais. À l'époque, ce n'était pas remboursé par la Sécurité sociale. J'ai eu le résultat rapidement. J'ai demandé à rencontrer le médecin responsable. Il m'a reçu et m'a très bien conseillé. Je suis allé à l'hôpital Saint-Louis, sur les indications d'une de mes amies médecin. Là, on a confirmé le test. La secrétaire m'a annoncé au téléphone : « Monsieur, vous êtes séropositif ». C'est comme cela que ça se passait en 85 : sans le moindre emballage psychologique. Ce qui explique qu'il y avait des gens qui se suicidaient.
Depuis dix ans, je me fais suivre médicalement dans le même service hospitalier. Je fais les analyses et je vois le médecin tous les six mois. Cette régularité permet d'avoir du recul et d'éprouver moins d'inquiétude lorsque le nombre de T4 baisse un peu. Je sais maintenant qu'il varie : 500, 600, 500ä Mon immunité s'est maintenue à ce niveau-là depuis 1985. À un moment, on m'a proposé de tester l'AZT pour savoir si, donné précocément, il présentait un intérêt. J'ai toujours refusé les protocoles thérapeutiques : comme mon corps fonctionne bien, je ne veux pas le déstabiliser. Cependant, depuis janvier 1994, je participe à une étude concernant l'immunité. Elle ne comporte aucun traitement, mais seulement quelques prises de sang supplémentaires, pour étudier entre autres l'aspect fonctionnel des cellules lymphocytaires T4. Elle permettra probablement de mieux connaître les raisons pour lesquelles l'organisme de certaines personnes se défend davantage vis-à-vis de l'infection à VIH.
J'ai tout de suite informé mes partenaires
Après le test pratiqué en novembre 85, j'ai tout de suite informé tous mes partenaires. Pour moi, c'était normal. Cela fait partie de mon éthique. Très peu m'ont complétement rejeté. Certains m'ont évincé de leur vie sexuelle mais ont conservé avec moi des rapports amicaux. Avec les autres, nous avons reconverti nos rapports : nous avons mis des préservatifs. Sur le moment, tout cela était très lourd à gérer. J'étais très perturbé psychologiquement. Ce fut un grand Big-Bang dans ma vie. Maintenant, j'en parle avec beaucoup plus de maîtrise : en fait, toutes ces personnes ont réagi comme n'importe quel échantillon d'une société humaine à qui on soumet un problème grave. Cependant, c'était tout de même très dur de prendre conscience de la pauvreté de certains comportements humains.
Beaucoup ont choisi de ne pas faire le test, pour ne pas être perturbés. Mais ils se sont mis à avoir des rapports protégés. De mon côté, je n'ai rien changé à ma vie sexuelle. Je n'ai pas freiné ma consommation. Mais, depuis, j'ai systématiquement utilisé des préservatifs pour toute pénétration sexuelle. Parfois, je m'accorde une petite dérogation : je fais, ou me fais faire, une fellation sans préservatif (sans aller jusqu'à l'éjaculation, afin d'éviter le contact de la bouche avec le sperme). Je me protège et protège l'autre. Je suis frappé par le relâchement actuel des pratiques de prévention, dans les boîtes et les bars. Je remarque aussi qu'il n'est pas facile de parler du virus dans les milieux homo ou hétéro. De nombreuses personnes refusent le dialogue.
Dès le résultat de mon test, j'ai cherché à m'informer le mieux possible sur cette maladie. Je suis allé à l'association AIDES, naissante à l'époque. Il y avait déjà d'excellentes réunions d'information. Je me souviens des interventions d'un épidémiologiste, Jean-Baptiste Brunet. Dès 1985, il exposait les problèmes qui allaient se poser en Afrique, dans les prisons, chez les prostitués des deux sexes, chez les usagers de drogue. On y parlait de la prévention à organiser. Le simple fait de mettre des préservatifs à disposition dans un sauna posait problème au dirigeant de l'établissement et aux pouvoirs publics : c'était reconnaître que dans cet endroit, les clients consommaient sexuellement. D'où contradiction, puisque chacun sait très bien depuis toujours que les cabines mises à disposition ne sont rien d'autre que des salles de repos !
Tenue de cosmonaute
C'était le début de l'épidémie. La plupart des gens n'y connaissaient pas grand chose.
En 1984, un médecin que j'étais allé consulter m'avait affirmé : «ne vous inquiétez pas. Le sida, c'est aux États-Unis ! ». Je n'ai pris conscience de la gravité de ce qui se passait, et de ce qui m'arrivait, qu'en 1986, lorsque deux de mes amis sont morts, atteints du sida. Pour situer l'époque, une des infirmières n'entrait dans la chambre de Philippe, 26 ans et Pascal, 22 ans, qu'habillée en tenue de cosmonauteä C'est-à-dire, ayant une trouille monstre. Depuis, les situations ont terriblement changé. Le personnel para-médical est tout à fait bien formé et maîtrise mieux l'encadrement procuré au malade.
Famille, je vous aime
C'est dans la difficulté qu'on voit la valeur des gens. J'ai annoncé ma séropositivité à ma famille six ou sept mois après l'avoir moi-même apprise. Mes parents ont d'abord marqué un recul. Il a fallu leur expliquer ces notions médicales auxquelles ils n'étaient pas formés. Sur le plan professionnel, je traversais une période de chômage. Cela tombait très bien. J'ai complètement changé d'activité. Je travaille beaucoup moins. Cela me permet de mieux me reposer lorsque je suis fatigué. Je trouve important de mener une vie saine, en dormant assez, en mangeant bien, en ne faisant pas trop d'excès. Mais il est certain que d'autres paramètres, comme la génétique, interviennent dans la défense de l'organisme contre le virus.
Paradoxe : se construire en étant décalé
Parmi les personnes que je fréquentais voici dix ans, trop sont mortes. Les copains tombent les uns après les autres. C'est très dur à vivre. C'est comme une guerre. Je suis content que mon corps fonctionne bien mais je ressens une injustice, en voyant mes amis malades. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, leur donner un peu de mon immunité. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai tout de suite participé au protocole médical dont nous parlions précédemment.
Avec mon profil de santé, la communication n'est pas toujours facile. Les gens bien portants voudraient que je fasse partie de leur famille et les gens malades, de la leur. Je ne suis ni dans l'une, ni dans l'autre tout en étant dans les deux. Etre séropositif, c'est être en décalage par rapport au monde. Le tout, c'est d'en faire quelque chose. Je m'y suis employé totalement. Cette période m'a permis de découvrir ce que l'on appelle la pensée positive et toute l'énergie qui l'accompagne. Je suis plus humain, plus proche des gens que je ne l'étais. J'ai toujours aidé tous les amis malades et le ferai encore. J'ai aussi vu des personnes, que j'avais connues assez moyennes, devenir extraordinaires, forçant le respect et l'admiration de tout le monde. Paradoxalement, on peut se construire au travers de la maladie, devenir quelqu'un de tout à fait fantastique et avoir pleinement réussi sa vie, même si celle-ci n'a pas été longue.
Je suis conscient que ma réflexion est celle d'une personne touchée, solidaire des personnes malades, mais qui n'est pas confrontée aux mêmes problèmes. Si j'étais très atteint dans mon corps, je suis convaincu que ma façon de voir les choses changerait.
En 1985, en annonçant sa séropositivité, on risquait d'être considéré comme un pestiféré. Aujourd'hui, on peut parler de cela. Il faut saisir cette chance. Le sida est devenu un fait culturel. Notre société respecte de plus en plus les personnes séropositives. Il y a moins de discrimination. Nous sommes sur le bon chemin. Je suis persuadé que le plus dur est fait et que nous avançons à grands pas vers des solutions médicales de plus en plus efficaces. Il faut tenir bon et surtout ne pas relâcher toutes les attitudes de prévention. Ce n'est pas facile, ça dure depuis trop longtemps, j'en suis tout à fait conscient. Cependant, notre vie doit être associée totalement à cette situation incontournable qu'est le préservatif, dans la conjoncture médicale actuelle. Vraiment, il faut insister : si on considère le préservatif comme une gomme, alors, en amour, mettons la gomme !
Alain
Comme beaucoup de gens, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, aux homos, aux marginaux. Pourtant, j'avais beaucoup d'amis homosexuels et plusieurs d'entre eux étaient morts du sida. Mais, en tant que femme menant une vie « normale », je me sentais protégée. C'est vraiment bête, ces idées-là, qu'on nous avait fourrées dans la tête.
Fin 1990, Bruno, avec qui je vis depuis plusieurs années, a donné son sang. C'est comme cela qu'il a appris qu'il était séropositif. On m'a conseillé de faire le test. Je suis sortie du centre de dépistage avec mes résultats. Il neigeait. Je me sentais complètement désemparée. On devrait mieux accompagner les gens à ce moment-là.
J'aurais préféré ne pas savoir
J'en ai voulu à Bruno. J'aurais préféré ne pas savoir. Cela m'aurait évité toutes ces angoisses, tous ces soucis. Je serais partie rapidement, un jour. Depuis l'annonce de ma séropositivité, je fais un blocage sexuel complet. Je refuse toute vie de femme. Mon corps n'a plus le désir de l'autre. Chaque rapport m'apporte des infections dues au manque d'envie, à ce mental si atteint. Je suis une « cérébrale ». Utérus et vagin se sont refermés comme un coquillage qui ne voudrait plus entendre l'appel du sexe et recevoir des ondes de plaisir. Mon corps, ne me parle plus de douleurs, de médicaments à prendre, de maladie mais parle moi d'amourä
J'ai consulté une psychologue, au centre de soins palliatifs de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, à Paris. Elle disait qu'il faut réapprendre à vivre, à se laisser caresser. J'ai cessé d'aller la voir le jour où j'ai compris que personne ne pourrait « porter » ma maladie à ma place et que, si je voulais survivre, il fallait que je me prenne en charge.
Heureusement, il y a beaucoup d'amour entre Bruno et moi, beaucoup de tendresse, de compréhension. Je ne pensais pas qu'une telle relation pouvait exister, qu'on pouvait dépasser le sexuel. On ne peut pas savoir qui a contaminé l'autre et c'est très bien comme ça.
Je trouve inadmissible que certaines personnes qui se savent séropositives ne le disent pas à celles avec qui elles ont des rapports et les contaminent. Je ne suis pas non plus d'accord avec les femmes séropositives qui font un enfant. Il risque de se retrouver malade ou orphelin.
Peut-être réagirais-je autrement si j'avais vingt ans. La question ne se pose plus pour moi. J'ai eu un retour d'âge précoce, en 1992. J'avais 48 ans. Cela s'est passé à la période où ma mère est morte. Je ne la voyais plus depuis un an. Elle passait son temps à me contrarier. J'étais séropositive, fatiguée ; je voulais me préserver. J'ai su qu'elle était malade quatre mois avant son décès. Je me suis beaucoup culpabilisée de ne pas avoir été plus présente auprès d'elle. Cela a été la grande chute de mes T4.
Médecin attentiste
J'ai longtemps été suivie à l'Hôtel-Dieu, par un médecin hématologue. Quand je suis arrivée à 170 T4, il m'a dit que ce devait être passager, qu'il fallait attendre pour voir si ça n'allait pas remonter. Au bilan suivant, 110 T4. Il a demandé un troisième bilan. 99 T4. Quand il a voulu en faire un quatrième, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai commencé l'AZT à 89 T4. Les quinze premiers jours, j'ai eu des nausées, j'étais obligé de prendre du Primpéran. Ensuite, je l'ai bien supporté. Mes T4 sont remontés à 114, puis à 115. J'aurais voulu qu'ils augmentent plus. On m'a doublé les doses d'AZT. Je ne l'ai pas très bien supporté. Le médecin de l'Hôtel-Dieu ne m'expliquait pas grand chose. Il ne voulait pas non plus que mon généraliste renouvelle les ordonnances d'AZT, alors que cela m'aurait évité d'aller à l'hôpital et d'attendreä Ce généraliste est très bien. Il nous écoute, mon ami et moi et se tient informé des dernières découvertes. Voici quelques semaines, nous nous sommes décidés à changer d'hôpital. On devrait créer le guide « Gault et Millau » de l'hôpital : tant d'étoiles pour survies par an. Enlèvement d'étoiles pour nombreux décès dans l'annéeä
Ces dernières années, j'ai eu plusieurs problèmes avec les médecins. Un ophtalmologue que j'avais consulté, dans le privé, était mécontent parce qu'il allait devoir nettoyer tous ses appareils. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, pour ses patients séropositifs qui ne le lui disaient pasä Il est très difficile de trouver un dentiste. Lorsque je lui ai dit que j'étais séropositive, ma gynécologue ne m'a pas dit qu'elle ne voulait plus me suivre. Mais elle a cessé de m'examiner. Résultat : j'avais une mycose, qui s'est aggravée. Une autre gynécologue que j'avais consultée à l'Hôtel-Dieu, a refusé de me donner une ordonnance à 100%. J'ai décidé de ne pas quitter son bureau jusqu'à ce que je l'obtienne. Elle a fini par céder. J'ai écrit au directeur de l'hôpital, qui m'a donné raison. Mais, dans cette lettre, je dénonçais un autre problème et, comme par hasard, suite à cela, mon dossier a disparuä Mon ami et moi ferons ce qu'il faut pour qu'ils le retrouvent ! Heureusement, il y a aussi des médecins qui font bien leur métier. Le tout, c'est de s'adresser à une bonne boutique !
Je suis révoltée
Tous ces grands professeurs, qui passent à la télé et ne prononcent jamais une parole optimisteä Ils ne veulent pas donner de faux espoirs. Mais un petit encouragement de temps en temps, ça ferait du bien ! Je suis très révoltée contre la maladie qui a gâché ma vie. Je la ressens comme une injustice. Pourquoi moi ? J'ai l'impression d'être punie pour quelque chose que je n'ai pas commis. Avant, j'étais très croyante. Depuis quelques mois, je ne crois plus en rien. Je ne peux plus prier. Avec toutes ces catastrophes dans le monde, comment penser qu'il y a un bon Dieu ? La foi, c'était comme une consolation, une bouée à laquelle se raccrocher. Je me retrouve avec un grand vide.
Je suis assez pessimiste. Bruno est plus calme, plus intérieur. Il m'épaule, il me remonte le moral. J'aimerais mieux partir la première. Je demanderais à des amis de s'occuper de lui. De son côté, il m'a dit que, si un jour j'allais trop mal, que je souffrais trop, il ferait quelque chose. Au début, ça m'a réconfortée. J'ai pensé que c'était une grande preuve d'amour. Maintenant, ça me fait un peu peur : et si, même très malade, j'avais envie de vivre ? Moi, je suis égoïste : je ne ferais pas la même chose pour lui. Je préférerais le garder avec moi, même s'il allait mal.
Je n'ai jamais été rejetée
En un sens, j'ai de la chance : je vis en couple et j'ai des amis. J'ai parlé de ma séropositivité au travail, à quelques collègues. Je n'ai jamais été rejetée. La journée mondiale du sida a été mémorable : lorsque j'ai pris mon poste, mes collègues arboraient un ruban rouge, paroles muettes de soutien, comme s'ils avaient voulu me montrer qu'ils étaient avec moi dans cette lutte. Maintenant, ces personnes viennent me voir, m'apportent des livres de la bibliothèque, me téléphonentä J'ai aussi annoncé ma séropositivité au médecin du travail et à l'assistante sociale, qui ont tout fait pour m'arranger. J'ai pu travailler à mi-temps, puis passer en longue maladie. Heureusement, je travaillais dans une grande institution, où les malades sont protégés.
Je l'ai aussi dit à mon frère et à sa famille. Ce ne sont pas des gens très instruits. Ils vivent en profonde Provence. Je ne me serais jamais attendue à une réaction pareille. Ils ont pris rendez-vous avec un médecin, qui leur a tout expliqué. Depuis, mon frère, qui ne me téléphonait jamais, m'appelle régulièrement.
Ce qui me gêne avec cette maladie, c'est que, recevant tant, je ne donne pas. Je voudrais aller visiter des malades, dans les hôpitaux. Mais je suis trop sensible. Lorsque j'allais voir mes amis, je leur prenais la main et je pleurais. Ça n'est pas d'un grand réconfort pour la personneä J'ai quand même fait de petites démarches. J'ai mis en relation l'association Sol En Si et le comité d'entreprise de la société où je travaillais.
Depuis plusieurs mois, je vais aux ateliers santé de AIDES. Avant, je ne voulais pas : je craignais d'être enfermée dans un ghetto. J'ai aussi peur de devenir amie avec des personnes séropositives, et de les perdre ensuite. Beaucoup de mes amis homosexuels sont décédés ces dernières annéesä
C'est un crime de s'aimer ?
Je ne supporte pas de vivre dans le mensonge. Avant, quand quelqu'un mourait du sida, on racontait que c'était un cancer. L'hypocrisie a changé. Maintenant, les médecins demandent : « Comment avez-vous été contaminée ? ». Comme si ça les regardaitä Souvent, les gens répondent : par transfusion. Même si ce n'est pas vrai. Moi je dis : par rapports sexuels. C'est un crime, de s'aimer ? Tout ce mensonge m'étouffe. Ce n'est pas comme ça que les choses avanceront !
Depuis quelque temps, j'ai un peu plus de sérénité. Je me dis que j'ai un peu de temps et que c'est bien d'en profiter. Si j'ai la chance de vieillir, j'achèterai une grande maison. J'y logerai gratuitement les animaux des personnes qui ne peuvent pas les garder, parce qu'elles sont hospitalisées ou décédées et j'y garderai tous les animaux abandonnésä C'est là mon rêve (finir entourée d'animaux familiers).
Maryse
En 1990, j'ai donné mon sang. Comme j'avais une vie assez calme depuis plusieurs années, j'ai rempli le questionnaire sans inquiétude. Dix ou quinze jours plus tard, j'ai reçu une lettre me demandant d'aller me présenter à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. C'est là que j'ai appris ma séropositivité. J'ai eu l'impression que le médecin, sans me le dire clairement, me reprochait d'avoir failli contaminer des dizaines de personnes. En rentrant, je l'ai annoncé à Maryse, avec qui je vivais depuis un ou deux ans. Elle est allée faire le test. Elle aussi est séropositive. J'ai ensuite essayé de joindre des personnes avec qui j'avais eu des relations sexuelles ces dernières années, pour les prévenir.
C'est plutôt calme
Depuis que j'ai appris ma séropositivité, je ne vis plus, je survis. J'ai 38 ans et je n'ai plus vraiment de projets, sinon de partir en vacances de temps en temps. Je pense qu'à un moment, je tomberai malade. Je ne crois pas au médicament miracle. Mais je ne pense pas non plus tout le temps à la séropositivité. Je tâche de profiter des petits plaisirs de la vie, déguster un bon repas, regarder le ciel lorsque je me promèneä Avant, j'aurais cru que, si j'apprenais que j'étais contaminé, j'aurais envie de brûler la vie par les deux bouts. En fait, c'est plutôt calme. J'ai la chance d'être en ménage, d'avoir un travail, un logement. J'ai un fils, que j'avais eu avant d'être avec Maryse. J'aurai le sentiment de laisser une trace derrière moi.
Au début, Maryse pensait que c'était moi qui l'avait contaminée. Elle a arrêté de se poser la question. On ne sait pas et c'est bien comme ça. La séropositivité ne nous a pas éloignés. Nous étions déjà très proches. On s'épaule, on se soutient. Mais ça ne nous a pas rapprochés non plus. Dans notre vie sexuelle, il y a quelque chose de cassé. Nous n'avons plus de rapports. Mais je n'ai pas envie de consulter un psychologue. On voit assez de médecins comme ça !
Les dentistes, c'est la folie
Si j'avais été seul, je crois que je ne me serais pas fait suivre. Mais, à deux, c'est différent. Pendant cinq ans, on a vu le même médecin, à l'Hôtel-Dieu. Il commentait les analyses et c'était tout. Ma consultation la plus longue a dû durer dix ou douze minutes. Cela devrait faire partie de son travail, d'expliquer les choses, petit à petit. Nous sommes beaucoup plus proches de notre médecin de ville qui, par chance, s'intéresse au sida. Grâce à lui et aux ateliers santé de AIDES, nous avons pu en savoir un peu plus. D'ailleurs, nous avons récemment changé d'hôpital. Quant aux dentistes, c'est de la folie. Certains, même à l'hôpital, ont refusé de me soigner en raison de ma séropositivité. J'en ai vu d'autres, très bien mais trop chersä
Je n'ai parlé de ma séropositivité ni à mon travail, ni à ma famille. Je veux qu'on me considère comme un bien-portant. Je n'ai pas envie qu'on me plaigne. Mais je commence à avoir des difficultés professionnelles. Je dois m'absenter une fois par mois, pour les examens et autres petits tracas, m'arrêter tous les quatre mois, parce que je suis fatigué. On me demande ce qui se passe. J'ai un métier physique : je suis dans le bâtiment. Je me demande comment je vais faire, quand je n'aurai plus la force. Je n'ai pas envie de rester inactif. J'aimerais bien travailler à mi-temps mais je pense que ce n'est pas possible : l'entreprise est trop petite.
Dans les cafés, sur les chantiers
C'est vraiment un problème crucial, qui mériterait d'être débattu au niveau national. Pour les personnes qui ont un métier intellectuel, il est sans doute plus simple de continuer à travailler, à être autonome quand on est malade. C'est comme les émissions télévisées : on voit toujours des gens qui savent parler, qui ont de l'instruction. C'est très bien. Cela fait avancer l'information. Mais on ne voit pas de gens comme nous, des gens du peuple, des ouvriers, des petits Françaisä Nous avons pourtant des choses à dire, même si nous ne savons pas toujours bien les dire. Dans les cafés, sur les chantiers, les gens pensent que le sida ne les concerne pas. S'ils voyaient à la télé des gens comme eux, cela les aiderait peut-être à prendre conscience. On risque peut être de les affoler. Mais ça vaut mieux que d'être contaminé.
Une autre chose qui me frappe, c'est le peu de monde qui vient aux manifs. D'ailleurs, on n'en parle quasiment pas à la télévision. Même aux ateliers santé de AIDES, on est très peu nombreux. Si les gens atteints eux-mêmes ne se mobilisent pas pour quelque chose qui les concerne directement, je me demande comment les choses changeront !
En revanche, certaines associations sont très actives. Je les félicite. Cependant, on peut regretter qu'aucun homme politique n'ait inscrit dans son programme électoral le problème du sida à un rang honorable. Le combat contre le sida ne doit-il pas être aussi virulent que le virus lui-même ?
Bruno
En France, quatre majorités se sont succédé depuis le début de l'épidémie. Les gouvernements ont toujours eu peur des échéances électorales : chacune d'entre elles a fait perdre de longs mois à la lutte contre le sida. Avant, on n'ose prendre aucune mesure qu'on croit heurter l'opinion ; l'année qui suit, le nouveau gouvernement apprend à connaître les dossiers. Comme il n'existe en France aucune vraie structure de santé publique, capable d'imposer ses décisions aux politiques, la même situation se répète à chaque fois.
Lors de la première conférence publique de AIDES, le 28 février 1985, Jean-Baptiste Brunet, médecin épidémiologiste travaillant pour le ministère de la Santé, a exposé trois priorités pour le gouvernement : le dépistage des dons de sang ; l'autorisation de la publicité sur les préservatifs ; des mesures pour que cesse le partage des seringues chez les usagers de drogues. C'est le 19 juin 1985 que le Premier Ministre, Laurent Fabius, a annoncé le dépistage des dons de sang. Il n'a été effectif qu'en août 1985 et la distribution des stocks de sang contaminé s'est poursuivie jusqu'en septembre 1985.
L'échelonnement des mesures fut un problème électoral : il a fallu attendre décembre 1986 pour que Michèle Barzach, ministre de la Santé du gouvernement Chirac, annonce l'autorisation de la publicité sur les préservatifs et mai 1987 pour que les seringues soient en vente libre en pharmacies.
On m'a dit que le gouvernement socialiste avait commandé un sondage aux renseignements généraux, pour savoir si la vente libre des seringues aurait un impact électoral. J'ai trouvé cela si énorme que j'ai posé la question à Laurent Fabius, en 1987. Il m'a répondu que ça n'avait pas été le seul élément de la décisionä
Consensus
Chaque gouvernement commence par affirmer que le précédent n'a rien fait. Mais, en réalité, il y a une grande continuité de principes depuis 1987. En 1988, Claude Évin a continué le travail sur les mêmes bases que Michèle Barzach, mais en affectant beaucoup plus de moyens financiers et humains. La décision de développer les programmes méthadone a été prise tardivement et timidement par Bernard Kouchner, qui l'a annoncée aux Assises de AIDES, à Lille. Mais ce sont Simone Veil et Philippe Douste-Blazy qui ont véritablement mis cette politique en place, avec un nombre de places nettement supérieur.
Dans les pays démocratiques et développés, il y a consensus sur un modèle de contrôle social de l'épidémie qui jusqu'ici n'a pas été remis en cause par les changements de majorité. On peut dire que ce modèle repose sur l'éducation et la coopération avec les populations vulnérables. Mais cette coopération est très inégale selon ces populations. On l'a vu en France avec les usagers de drogue. Mais dans ce domaine même, elle est en pleine transformation.
Précédemment, le système de contrôle des épidémies visait d'abord à protéger la population des bien-portants en recourant à des mesures contraignantes de mise à distance des personnes contaminées ou supposées l'être : entrave à la circulation, dépistage aux frontières, au seuil du mariage, au seuil de la procréation et dépistage prénatal ; dépistage au seuil de la Fonction publique puis d'autres emplois, parfois des écoles. Ces mesures de contrôle des seuils ont un caractère obligatoire. Elles sont assorties d'atteintes à la vie privée : rupture de la confidentialité, déclaration nominative des cas à un organisme central, recherche des partenaires sexuels.
L'histoire du dépistage
Dans chaque pays, l'histoire du dépistage - obligatoire ou volontaire - illustre l'affrontement entre ces deux modèles. La Russie, Cuba ont puisé surtout dans le répertoire des mesures traditionnelles. Les pays occidentaux ont choisi le nouveau modèle. Dès le début, le mouvement associatif est intervenu auprès des politiques, pour promouvoir une gestion de l'épidémie qui respecte les droits des personnes. Les médecins engagés dans la lutte contre l'épidémie étaient partie prenante de cette démarche.
À l'inverse, l'extrême-droite et, en France, une partie du Sénat, proposent souvent de recourir à l'ancien modèle. Les personnes mal informées réagissent fréquemment comme cela. Ce fut le cas de nombreux professionnels de santé, qui ont commencé par freiner l'application des mesures nécessaires (réticences de certains pharmaciens à vendre des seringuesä). Cela se voit dans le grand public, avec les « fantasmes de contamination » dans la vie quotidienne (confondus avec la transmissibilité), qui conduisent à la mise à l'écart de personnes séropositives. Avant d'être ministre, Simone Veil s'est prononcée plusieurs fois pour certains dépistages obligatoires. Elle a changé rapidement, une fois en charge du dossier.
Actuellement, il y a une volonté politique mais les relais locaux sont loin d'avoir compris et accepté la stratégie nouvelle de contrôle social de l'épidémie et tous les acquis précédents, sur lesquels il y a consensus, sont toujours limités, instables et il faut les réactualiser dans le contexte des campagnes électorales.
Daniel DEFERT
|
Année |
Cas de sida déclarés dans l'année |
Quelques évènements |
Principales mesures administratives (nom des ministres de tutelle) |
|
1982 |
20 à 50 |
Description des premiers cas français. Des médecins créent un groupe de travail : "Kaposi et pneumocystose". |
|
|
1983 |
50 à 100 |
L'équipe du Pr Montagnier isole le virus LAV. Le terme sida apparaît en France. Création de l'association VLS (Vaincre le sida). |
La direction générale de la santé (DGS) recommande : - la sélection des donneurs de sang (en vain!) - des mesures de sécurité pour les soignants. |
|
1984 |
230 |
L'équipe du Pr Gallo isole le virus HTLV III. Mort de Michel Foucault ; Création de AIDES. AIDES organise permanence téléphonique, conférences, prévention et aide aux malades. Création de l'association ARCAT. 1ère conférence internationale sur le sida (Atlanta). |
Mars : le test de dépistage disponible aux Etats-Unis. Juin : le test Pasteur est disponible et L.Fabius annonce le dépistage obligatoire des dons de sang (effectif en août ; sang contaminé distribué jusqu'en octobre). (E.Hervé, G.Dufoix). |
|
1985 |
580 |
Le Pr Adrieux et G.Dufoix font (à tort) un éloge tapageur de la ciclosporine. 1ère émission TV de collecte de fonds pour le sida. Création de AIDES Marseille. J.-P.Aron révèle publiquement sa séropositivité. Le terme VIH (HIV in English) remplace LAV et HTLV III. AZT disponible aux Etats-Unis. En France, les essais commencent. |
Test de despistage remboursé (à 70 %). (E.Hervé, G.Dufoix). Début du recensement (anonyme) des cas de sida (M.Barzach). |
|
1986 |
1200 |
Le Front National veut des "sidatoriums" pour les "sidaïques". L'AZT est disponible en France. Déclaration universelle des droits des malades et des séropositifs (AIDES et Médecins du Monde). Création du programme mondial sur le sida à l'OMS. |
Le sida grande cause nationale (M.Barzach). La publicité pour le préservatif autorisée (M. Barzach). Seringues en vente libre en pharmacie pour un an (M.Barzach). 100 % Sécu en cas de sida déclaré. |
|
1987 |
2200 |
Des hémophiles et des transfusés contaminés par le VIH portent plainte. 1ère journée mondiale de lutte contre le sida (1er décembre). " Rapport sur le sida " du Pr Got. |
Première campagne nationale d'information : " le sida, il ne passera pas par moi ". (M.Barzach). Dépistage du VIH avant don d'organe ou de sperme. (M.Barzach). Norme NF obligatoire pour les préservatifs (M.Barzach). Création des centres de dépistage anonyme et gratuit (M.Barzach). Nette augmentation du financement de la lutte contre le sida (C.Evin). |
|
1988 |
3000 |
|
La loi Huriet organise les essais thérapeutiques et la mise à disposition des médicaments expérimentaux. Création du RMI (revenu minimum d'insertion). (C.Evin). Vente libre des seringues reconduite (et pérennisée en 1989). (C.Evin, B.Durieux). |
|
1989 |
3800 |
Création de l'association Act Up Paris. 1er programme d'échange de seringues (Médecins du Monde). |
Suite au rapport Got, création des agences ANRS (recherche), AFLS (prévention) et du CNS (éthique). (C.Evin, B.Durieux). Campagne AFLS : " les préservatifs vous souhaitent de bonnes vacances". |
|
1990 |
4300 |
Etats généraux : Vivre le sida (Paris). Création de l'association Sol En Si. Création de Sida Info Service (05 36 66 36). Boycott de la conférence de San Francisco. Création du journal Remaides. La ddI disponible en France. Création d'AIDES à domicile. |
Loi sur la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap (C.Evin). Rapport du Pr Dormont (sur le suivi médical). Suite à ce rapport, 100 % Sécu pour tous les séropositifs en dessous de 350 T4. (C.Evin, B.Durieux). |
|
1991 |
4600 |
Plusieurs associations dénoncent l'inertie de la Mairie de Paris dans la lutte contre le sida. Création de l'association Actions-Traitements. L'affaire du sang contaminérévélée par l'Evènement du Jeudi et reprise par la presse. Débat parlementaire sur le dépistage. |
Convention avec les assurances pour permettre aux séropositifs de contracter un emprunt. Loi sur l'indémnisation des hémophiles et des transfusés. Campagne AFLS : " Si je suis séropositif, tu joues avec moi ? "
|
|
1992 |
5000 |
L'affaire du sang contaminé en justice. Garreta en prison. Sortie du film "Les nuits fauves". Arrêt de l'essai Imuthiol (commencé en 1987). Cinq associations créent le groupe TRT5 (Traitements et Recherche Thérapeutique). |
Test de dépistage remboursé à 100 %. (B.Kouchner). Restrictions de prescription du Temgésic. (B.Kouchner). Les RMIstes ont droit à l'aide médicale. (R.Teulade).
|
|
1993 |
5400 |
Collectif pour " Limiter la Casse " chez les usagers de drogues. Enquête hôpital AIDES Ile-de-France. Rapport du Pr Montagnier. Résultats de l'essai Concorde (AZT). |
100 % Sécu pour tous les séropositifs. (B.Kouchner). Droit à la Sécu quand on habite avec un assuré social. (R.Teulade). Expulsion de malades étrangers (C.Pasqua). Lancement du préservatif à 1franc. (P.Douste-Blazy). |
|
1994 |
5800 |
Emission TV Sidaction (le 7 avril). Résultats de l'essai AZT chez les femmes enceintes. Débat parlementaire sur le dépistage. Création de l'ADMEF (pour les droits des malades étrangers en France). Etats généraux drogue et sida. Sommet mondial sur le sida à Paris (S.Veil). |
Suite au rapport Montagnier, dissolution de l'AFLS et création d'un comité interministériel à la lutte contre le sida. (S.Veil). Les compléments nutritionnels remboursé. (S.Veil, P.Douste-Blazy). Ouverture de 1000 places méthadone. (S.Veil, P.Douste-Blazy). Conventions prisons-hôpitaux et inscription des détenus à la Sécu. (B.Kouchner / S.Veil, P.Douste-Blazy). Sous la pression des associations, l'AP-HP modifie son système de dispensation des médicaments. |
|
1995 |
? |
Rapport du Pr Henrion sur la toxicomanie. Etats généraux homosexualité et sida. |
Baisse de la TVA sur les seringues. Les associations autorisées à distribuer des seringues. Elargissement de la prescription et de la dispensation de la méthadone et de l'AZT. (S.Veil, P.Douste-Blazy). |
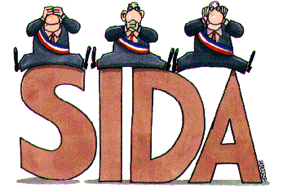
Je pars aux États-Unis fin1982 pour deux ans. J'avais lu un article dans Libération sur le « cancer gay », ça m'avait paru absurde. À New York, à Los Angeles, il y a une affiche dans les bars : « si vous avez tel type de symptômes, appelez ce numéro ». Je ne suis pas concerné. Pourtant, début 83, j'ai de la fièvre, des ganglions énormes. Je suis très fatigué. On finit par me dire : vous devez être atteint de cette nouvelle maladie qui touche les homosexuels. Ça ne m'atteint pas, je crois que je ne réalise pas. On me demande de ne plus avoir aucun type de relations sexuelles. C'est ce qui m'affecte le plus, car c'est pour moi le moyen le plus efficace pour nouer des liens. Arrivant aux U.S.A., je n'ai pas eu le temps de me créer un environnement social. Je me retrouve très seul.
Je débute une psychothérapie, de type Gestalt. Elle s'avére rapidement efficace. Je commence à avoir des relations sexuelles protégées. Je me dis qu'il n'est pas prouvé que je sois malade, surtout que je me sens bien, et je fais le pari que certaines pratiques, comme de s'embrasser ou de se masturber mutuellement, sont sans risques.
Choisir mes risques
Septembre 84, je rentre en France, le test est fiable, un médecin de ville me le propose, résultat positif. Comme je me doutais du résultat, je l'ai bien vécu. J'ai continué à vivre ma vie, sans rien changer. En 1985, mon médecin me propose l'Imuthiol, à titre préventif, j'en prends pendant deux ans. En 87, je rencontre un mec. J'en tombe amoureux fou. On sort pas mal et, avec l'Imuthiol, je ne peux pas boire d'alcool. J'arrête l'Imuthiol (bonne initiative car il a été prouvé, par la suite, qu'il était plus nocif que bénéfique). Mon amant est séropositif. On se le dit dès le départ. On fait l'amour comme des fous, sans précautions. La théorie dominante est qu'on risque d'aggraver la maladie en se surcontaminant. Mais c'est un risque que je choisis de prendre, et que je continue à prendre aujourd'hui, parce que les capotes me gâchent mon plaisir. Avant l'action, je préviens à chaque fois mes partenaires. C'est quelque chose que j'ai toujours fait et je n'ai jamais éte rejeté. En revanche, j'ai remarqué que, malgré ma franchise, quand l'autre est séropositif, il ne me le dit souvent que plus tard, et avec difficulté. Quant j'ai un amant séronégatif, du fait de mes choix, j'ai une sexualité différente, au spectre beaucoup plus restreint. Quelques mecs séronégatifs, dont je n'étais pas vraiment amoureux, m'ont demandé : « si je prends des risques avec toi, est-ce que tu m'aimeras ? ». J'ai toujours refusé (le deal était absurde). Pourtant, ils étaient bien informés, mais le danger du sida, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas.
En 88, mon médecin me propose l'ozonothérapie, dans le cadre d'une étude. Trois fois par semaine, on me prend un litre de sang, on l'ozonifie et on me le ré-injecte avec de la vitamine C. J'ai les bras bleus. Je suis obligé de me lever tôt. Je suis fatigué, j'arrive tard au boulot. Injustice, tout le monde croit que je fais la fête. Alors, là aussi, je joue franc jeu, et j'informe mes collègues les plus proches. Je n'ai jamais eu à le regretter et ça m'a permis d'être compris et soutenu. L'ozonothérapie ne marche pas, j'arrête.
Prévoir
Quand je change de travail en 88, je choisis une société dont les conventions collectives garantissent un revenu à vie, en cas d'arrêt de travail. De même, devant trouver un appartement, j'en choisis un agréable, bien exposé, plein de soleil et avec ascenseur. Je suis en forme mais je tiens à prévoir l'avenir.
Enfin, par le biais d'activités associatives, je commence à m'informer sérieusement sur les traitements et l'actualité médicale. À ce jour, j'y suis plus que jamais attentif, je gère au mieux mes traitements et je suis toujours à la pointe. J'ai l'impression de maîtriser et de ne pas trop subir.
Les premières contraintes
En mai 89, j'ai mal dans la bouche. Le dentiste que je consulte et qui est très flippé d'avoir à me soigner (deux paires de gants et un masque) me dit : « ça doit être un Kaposi ». Je bondis chez mon médecin. Il diagnostique une candidose et me prescrit du Triflucan. En juin-juillet, mes T4 chutent. L'AZT s'impose. Je l'accepte facilement car le Triflucan a préparé le terrain et puis avec un joint et une vodka tonic, j'exorcise, c'est moi le plus fort. De même, dès le début, je décide de ne prendre l'AZT que deux fois par jour, alors que certains de mes copains se réveillent la nuit pour avaler leurs gélules toutes les six heures.
Parallèlement, je fais tous les voyages dont j'ai envie : Europe, Amérique du Sud, Asieä Je prends plusieurs mois d'arrêt-maladie afin d'avoir de longues vacances. Mon souci est d'en profiter au maximum, pour n'avoir rien à regretter.
En 1991, je commence à être fatigué. J'ai du mal à me concentrer. L'après-midi, au bureau, je m'endors. Je me renseigne sur le médecin du travail. Il paraît fiable. Nous décidons ensemble d'un mi-temps thérapeutique. J'informe la direction de mon état de santé. Cependant, je ne veux pas que toute l'entreprise sache que j'ai le sida. Pour couper court aux futures rumeurs, je demande à une collègue de raconter, sous le sceau du secret, à une secrétaire bavarde que je suis atteint d'un lymphome quelconque. Ça marche.
Les premiers handicaps
En mars 92, l'AZT cesse d'être efficace. Je commence la ddI. Pour compenser, je reprends trois mois d'arrêt-maladie, et je voyage. Rentré en France, je décide de cesser de travailler. Je n'en ai plus l'énergie, ni la motivation. Grâce à la mutuelle, j'en ai les moyens. Comme j'ai toujours su comment occuper mon temps, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour me faire plaisir.
La ddI ne marche pas. Je reprends l'AZT puis je passe à la ddC. En février 93, je commence à avoir des fourmillements dans les pieds, puis ça devient douloureux. Je ne peux pas marcher longtemps, la nuit la douleur m'empêche de dormir. Après plusieurs examens et comme cela ne passe pas, le diagnostic tombe « neuropathie causée par le V.I.H. ». On me dit qu'il n'y a rien à faire contre la douleur. Panique. Heureusement, je m'obstine, je rencontre un médecin spécialiste de la douleur, et ça marche. Cependant, je mets bêtement ma vie en stand-by, j'attends que mon symptôme disparaisse pour vivre et faire des projets. Aider deux copains très malades me fait réaliser que, pour moi, tout est encore possible
En juillet 93, je rencontre Luc, dans un bar. C'est le coup de foudre et malgré la neuropathie, je m'autorise à vivre cette histoire.
Novembre 93, je commence à maigrir, à avoir des diarrhées violentes. Cela me prend n'importe où, sans délai. C'est très handicapant, très humiliant. Je n'ai plus d'érections. Je me demande comment Luc peut encore me désirer, je pense qu'il va se tirer, je deviens jaloux. Cette dégradation de l'image de soi, cette diminution des capacités physiques est très difficile à vivre.
Début de la dépendance
Septembre 94, en consultant l'ophtalmo, j'apprends que j'ai une rétinite à CMV. Ça y est, c'est mon tour. Pose d'un cathéther, H.A.D. (hospitalisation à domicile), perfusions quotidiennes. Quand l'infirmière a trois heures de retard - ce qui n'est pas rare - et que ça fout complètement en l'air mon emploi du temps, il n'y a rien à dire : elle a toujours de bonnes excuses et j'ai besoin d'elle. Il me faut trois mois pour négocier un arrangement qui me convienne. Décembre 94, j'ai une forte fièvre. Première hospitalisation. À l'hôpital, je suis paniqué. Je vois des gens qui vont très mal. Je ne veux pas vivre la même chose. À ma sortie, je décide de me tuer. J'ai, chez moi, les médicaments nécessaires. Luc sent quelque chose. Pendant quinze jours, il ne me quitte pas. Je m'en sors.
Aujourd'hui, le poids des traitements et des problèmes divers - diarrhée, neuropathie, fatigueä - est très lourd. Depuis un peu plus d'un an, en complément de la médecine « classique », j'ai recours à tout ce qui peut me donner de l'énergie (acupuncture, ostéopathie, massagesä). De même, je maintiens différentes activités associatives. Ça me donne un statut autre que celui de malade.
Luc n'est pas parti, on fait toujours l'amour, c'est passionnel. Je l'aime. Ce sera ma dernière histoire, mais c'en est une comme je les aime, alors !
Pierre
J'étais dealer. C'était mon métier. Mon business marchait bien. J'ai fait beaucoup de mal. Je suis dans la came depuis quinze ans. Au début, je ne me défonçais que le soir, pour rester clair dans la journée. Et puis, petit à petitä
Je vivais avec Nathalie. Elle était malade. Il y a deux ans, j'ai fait le test. Il était positif. C'est avec Nathalie que j'ai eu le virus. Par les seringues ou par les rapports. Je ne lui en veux pas. L'amour, c'est plus fort que tout. Dans le milieu toxico, les échanges de seringues étaient très fréquents. On n'a entendu parler de sida que vers 1989. C'était considéré comme une maladie d'homo. Presque tous mes copains sont séropositifs. Nathalie est morte à la fin 93. Elle avait une toxoplasmose cérébrale. Elle répétait : « J'ai fait du mal. Je suis sale ». J'ai essayé de la rassurer. Elle a profité d'un moment où je somnolais pour sauter par la fenêtre.
J'ai complètement plongé
Elle et moi, on s'entraidait, pour essayer de sortir de la défonce. Après son décès, j'ai complètement plongé. Mais j'ai réagi. Je suis allé voir William Lowenstein, à Laënnec. Il m'a donné du Temgésic. Ça n'allait pas. J'en shootais des dizaines par jour. Un peu malgré moi, je me suis retrouvé en cure de désintoxication. On m'a envoyé en postcure, dans les Pyrénées. Je travaillais dans la montagne. J'ai repris dix kilos. C'est là que j'ai découvert l'Église. J'ai aussi fait un pèlerinage à Lourdes.
En rentrant à Paris, le jour même, je suis retombé dans la dope. J'ai reperdu mes kilos. Je suis maigre, je n'ai plus de bras. Avant, j'étais vraiment costaud. J'ai demandé à mon médecin de me filer un autre truc, plus fort. Avec le Palfium, ça n'a pas été bien longtemps. Au bout d'un moment, j'en shootais toutes les heures, j'allais d'un médecin à l'autreä
Heureusement, il y a eu la méthadone. Lowenstein m'a très vite fait rentrer dans son programme. C'est beaucoup mieux. J'ai encore shooté un peu, mais plus beaucoup. J'évite le plus possible. J'ai plus d'énergie. J'ai pu faire refaire mes lunettes. Ça faisait des années qu'elles étaient cassées. Je vais m'occuper de mes dents, qui sont très abîmées. Récemment, j'ai eu une candidose. Je ne pouvais plus rien avaler. Le Triflucan n'a pas suffi. Il a fallu du Sporanox pour que ça passe. J'ai aussi une hépatite C et une hépatite médicamenteuse.
J'aimerais que les médias arrêtent de prendre les gens pour des cons, d'annoncer aux malades qu'on a trouvé un médicament alors qu'il n'a même pas été testé sur les animaux et encore moins sur des humains. Ils n'arrêtent pas de susciter de faux espoirs.
Avec la méthadone, le plus dur, c'est l'ennui. Quand tu vas choper, tu passes tes journées à chercher le fric, à chercher la dope, et après, ça shoote, ça shoote. Et le lendemain, rebelote. Avec la métha, ta vie n'est plus remplie par ça. Tu as le temps de penser, de ruminer. J'aimerais bien bosser à mi-temps. Avant, j'allais à Tibériade, où ils accueillent les séro. Mais je passais mes journées à jouer au tarot. J'avais l'impression de stagner. Il m'ont exclu deux fois. Ils avaient peur que je deale. À ce moment-là, ça n'allait pas dans ma tête. C'était presque la folie. Mais, même quand je n'avais plus le droit d'y aller, ils continuaient à m'appeler, à prendre de mes nouvelles. Ils m'ont trouvé un petit studio.
Le yin et le yang
J'ai fait la formation de volontaire à AIDES. Quand je pense qu'il y a encore plein de pharmacies qui refusent de vendre des seringues, ou ne le font que par paquets de 10 ou 20ä Je vais participer au groupe AUDVIH (Aide aux usagers de drogues touchés par le VIH). Je veux faire quelque chose, aider les gens. C'est con à dire, mais c'est grâce à la maladie que ma vie a changé. C'est le jour et la nuit, le yin et le yang. Je touche le RMI. Pour la première fois, je peux acheter des choses en toute légalité. Je n'ai pas de comptes à rendre. Je me sens libre. J'ai plaisir à sortir, à parler avec les gens. J'ai pu revoir mon meilleur ami. Je croyais qu'il s'était éloigné de moi à cause de la maladie, mais c'était parce que je me défonçais trop. Je vois aussi ses enfants. Les miens sont gardés par d'autres personnes. Je n'ai pas pu m'en occuper et ça me fout les boules. Avec la came, j'étais dans un autre monde.
J'aimerais bien rencontrer une fille et refaire ma vie avec elle. Mais, avec la maladie, ça crée des blocages. Avant, il n'y avait que le cul qui m'intéressait. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce que les gens ont dans la tête.
Patrick
J'inspire le produit protecteur qui se répand en moi en un nuage amer et sifflant, régulièrement, et j'expire aussi fortement, bruyamment, allongé sur le lit blanc, seul dans la chambre impersonnelle où mon souffle résonne.
J'inspire, j'expire. Je serre dans ma bouche le tuyau de plastique en maintenant l'extrémité inférieure, le petit réservoir, d'une main. Ce réservoir contient le liquide antibiotique. L'oxygène le propage. La trompe est reliée à l'arrivée de gaz, placée dans le mur.
La vapeur légère se répand dans l'effort depuis mes lèvres jusqu'à mes bronches. Le parcours est long : l'exercice artificiel éprouve et rend les minutes plus pesantes qu'au dehors.
J'inspire, j'expire.
Les aiguilles traînent au cadran de ma montre. Ignorons les ! L'épreuve est nécessaire, mensuellement, s'apparente à ma lutte contre un mal sournois, imperceptible.
J'inspire, j'expire. Mon souffle se fait entendre depuis le début. C'est l'écho de mes efforts qui engendrent craintes, doutes, regrets et souvenirs, des promesses de sentiments plus grands pour les amis, des confidences retenues, des élans d'affectionä Les larmes me viennent. Je les retiens. J'inspire. J'expire et j'aspire à la vie.
La course se termine. Il ne reste plus que des gouttelettes blanchâtres dans le petit réservoir. Le nuage se dissipe, avec lui mon écho. Je suis las. Debout ! Rendez-vous le mois prochain ! Les images de l'effort se poursuivront-elles ? L'épreuve a éveillé ma conscience. J'aimerais que tous mes actes s'accompagnent des pensées altruistes, puissantes, qui se sont déclenchées sur le lit blanc sous ma respiration exagérée. J'aimerais vivre plus justement pour ce qui est essentiel, me consacrer utilement aux autres et être davantage aimé de mes proches.
Je vis. J'inspire, j'expire.
Éric
Je me lève. J'aimerais que ma nuit ne soit pas finie. Il est 4 ou 5 heures du matin. Je me lève, guidé par le besoin de me soumettre à mon traitement. Je me lève, pressé, encore endormi, insatisfait de moi-même.
Je dévisse le couvercle de la boîte cylindrique en plastique, la penche au-dessus de ma main et verse dans ma paume les deux gros cachets blancs de rigueur - ddI ou VIDEX 100 - à consommer une heure avant chaque repas. (L'acidité due aux aliments en réduirait l'efficacité.) Je porte à ma bouche les dragées plates et rondes, les croque, en fait rapidement disparaitre l'amertume et la consistance pâteuse d'une gorgée d'eau.
L'eau, il m'en faudra encore pour absorber les deux gélules bleues et blanches d'AZT, puis le demi comprimé de Malocide. Les médicaments sont prêts à être avalés dans leur compartiment du jour. Nous sommes lundi ou jeudi. Les sept barres pour les sept jours de la semaine contiennent le traitement complémentaire anti-VIH, contre la toxoplasmose et composent la trousse bleue posée au bord de la table, sans laquelle j'oublierais d'absorber un des remèdes.
Je me suis levé. Il est 4 ou 5 heures. La posologie est respectée. Le double traitement a été rapidement ingéré. Il se propage en moi - épreuve matinale à renouveler, le soir, 12 heures plus tard - et me rappelle mes craintes, ma haine du virus qui m'habite.
C'est ainsi depuis deux ans. Il y a eu d'abord l'AZT, seul, sans succès au bout de plusieurs mois ; puis le ddI, sans plus d'efficacité. Alors, il y a maintenant les deux remèdes que je ne juge pas miraculeux, depuis 6 mois. Ils sont ma communion quotidienne, matin et soir. Je suis seul, soumis. J'ai bien pensé ne plus les absorber. Qu'adviendrait-il ?
Je me suis levé. Il est plus de 4 ou 5 heures. Invariablement, chaque nuit, ainsi, je me lève. Et quand je peux me recoucher pour me rendormir quelque temps, je suis satisfait, moins accablé et moins dégoûté de moi-même.
Éric
En 1985, alors que j'étais enceinte de mon cinquième enfant, j'étais venue à Paris. La poche des eaux s'est rompue dans la rue. On m'a amenée à l'hôpital Boucicaut. Ils m'ont fait une prise de sang. J'ai pensé que c'était la routine. Après l'accouchement, je suis rentrée chez moi, en grande banlieue, avec le bébé, Catherine. Dix jours plus tard, j'ai reçu un télégramme qui me disait d'appeler d'urgence l'hôpital. J'ai téléphoné mais on n'a rien voulu m'expliquer. J'y suis allée. Le pédiatre m'a dit qu'on devait me faire un prélèvement pour la toxoplasmose. J'ai eu des doutes. J'ai demandé à la sage-femme qui m'avait accouchée quel était l'examen qu'on m'avait fait. Elle m'a répondu que, dans cette maternité, ils le faisaient à toutes les femmes d'origine haïtienne ou africaine. C'est tout.
J'ai refusé cette vérité
Entre-temps, Catherine avait dû être hospitalisée, à Saint-Germain en Laye. C'est là que le pédiatre m'a proposé un dépistage. Le test était positif. Pendant quatre ans, j'ai refusé cette vérité. J'étais persuadée qu'on allait découvrir que je n'avais rien et le bébé non plus. Mais je l'ai quand même annoncé tout de suite au père de Catherine. Il a mis un an à faire le test, qui s'est avéré négatif. Il refusait d'avoir des rapports protégés. Il voulait que tout le monde soit pareil, que tout le monde meure ensemble. Je lui ai dit qu'il fallait au moins qu'il y en ait un qui ne le soit pas, pour pouvoir assumer, après. À partir de là, il a accepté d'avoir des rapports protégés. J'ai aussi parlé à ma fille ainée, mais pas à mes trois garçons. Je ne sais pas comment le leur dire, comment répondre à leurs questions.
Pendant sa première année, Catherine a souvent été malade. Deux fois, j'ai cru qu'elle allait mourir et j'ai à chaque fois fait une paralysie faciale, qui a en grande partie disparu depuis.
Traitements
Le pédiatre connaissait le Dr Blanche, à l'hôpital Necker, à Paris. Depuis, ma fille est suivie là-bas. Cela lui a permis de bénéficier des meilleurs soins. Tous les mois, en rentrant de Necker avec elle, j'avais un gros paquet dans les bras : c'était son traitement. J'avais l'impression que je transportais un mois de vie, pour mon enfant.
Le médecin, à Saint-Germain, m'a proposé une prise en charge pour moi. À chaque fois, je décommandais les rendez-vous : j'avais trop peur. Cette femme a compris et m'a dit de venir voir ce qu'elle me proposait, avant de me décider. J'y suis allée. J'ai tout de suite eu confiance en elle. Elle m'a proposé l'AZT. J'ai dû arrêter, à cause des effets secondaires. Quand j'ai pris de la ddI pour la première fois, j'ai pensé qu'il fallait avoir le sida pour avaler une horreur pareille. J'ai pleuré, seule, devant mon lavabo. J'en ai pris pendant trois ans. Le médecin m'a ensuite proposé la ddC. Ce médicament me dégoûte, à cause de son nom : Hivid. HIV, c'est un rappel constant de la maladie. J'ai dû arrêter à cause d'une intolérance neurologique, avec des fourmis dans les jambes. Actuellement, je ne prends rien mais je vais sans doute passer à 3TC plus Rétrovir, comme Catherine.
J'avais cessé de travailler pour m'occuper de ma fille. Les traitements étaient très lourds : il fallait ouvrir les capsules d'AZT, en prélever la moitié, le lui donner, toutes les six heures, jour et nuit. À cela s'ajoutaient le Bactrim et un autre antibiotique et la Spéciafoldine et les médicaments contre la diarrhée et les traitements des mycoses et l'interféronä
Je passais mes journées entre quatre murs. J'avais peur de sortir, je craignais d'attraper un rhume et que ce soit le début de la maladie. J'étais persuadée que j'allais mourir du jour au lendemain.
Thérapies
J'ai essayé de suivre une psychothérapie, à l'hôpital. J'avais besoin d'un mode d'emploi au quotidien et de toutes les informations sur la recherche. La psychologue ne me les donnait pas. J'ai arrêté. Le médecin qui me suivait m'a donné les coordonnées de France, qui anime le groupe femmes à AIDES. Cela m'a aidée, de pouvoir parler avec d'autres femmes atteintes. C'est aussi dans ce groupe que j'ai eu le plus d'informations. Par ailleurs, un volontaire de AIDES vient régulièrement me voir : cela compte énormément, pour mes enfants et pour moi.
Quand Catherine a eu un an et demi, une nouvelle fois, on a cru qu'elle allait mourir. J'en ai parlé à une amie que je sentais proche. Elle a eu une très bonne réaction. Elle m'a inscrite à un pèlerinage à Lourdes. Depuis, chaque année, pendant une semaine, j'emmène ma fille là-bas. Cette amie m'a aussi assuré qu'elle veillerait sur mes enfants mineurs, s'il m'arrivait quelque chose. Par elle, j'ai connu une autre femme qui a proposé une thérapie par la détente à Catherine. Ça l'a beaucoup aidée. Elle a pu extérioriser ses peurs. Elle a eu moins peur, moins mal pour les prises de sang et les perfusions d'immunoglobulines.
Elle et moi faisons partie d'un autre groupe. Il a été créé par une infirmière, Maguy Lebrun. Des personnes atteintes de différentes maladies, de dépression, y participent. On se passe nos énergies en se tenant les mains, en ayant des pensées d'amour universel et d'amour les uns envers les autres. Même si ce n'est prouvé médicalement, cela fait du bien. Ça aide à vivre.
Vivre autrement
La femme qui anime ce groupe est très positive. Elle m'a dit qu'on pouvait vivre longtemps avec le virus. On peut lui parler, lui dire de ne pas s'activer, essayer de cohabiter en harmonie. Alors que moi, je le haïssais. S'il avait fallu boire de l'eau de Javel pour s'en débarrasser, je l'aurais fait.
J'ai probablement été contaminée entre 1983 et 1985. J'ai eu quelques rapports non protégés avec un homme qui est décédé depuis. J'ai longtemps détesté cet homme. J'aurais voulu le tuer moi-même. La copine qui anime ce groupe m'a incitée à lui pardonner. Je me suis faite à cette idée, petit à petit. Avec ce groupe, j'ai appris à vivre autrement.
Au mois d'août, voici trois ans, je suis partie à la recherche du travail. J'en avais assez de m'ennuyer chez moi. J'ai trouvé très vite, dans un foyer d'adultes poly-handicapés. Mon expérience de la maladie m'a aidée à tenir le choc. Ensuite, j'ai fait une formation et je suis devenue aide médico-psychologique. Quand j'ai commencé ce travail, pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de penser sans cesse à ma maladie, à celle de ma fille, à la mort, au futur de mes enfants quand je ne serai plus làä Je vais maintenant essayer de devenir éducatrice spécialisée.
Je me culpabilise
Mais il est très difficile de concilier ma vie professionnelle, ma vie de malade, ma vie de mère d'enfant malade, ma vie de mère d'enfants bien portantsä Je dois beaucoup courir, prendre le bus, le trainä Je me culpabilise, de ne pas être plus disponible pour mes enfants. J'ai perdu beaucoup de mes copines car je refusais les invitations. Avec mes traitements et ceux de ma fille, c'était trop difficile à gérer. Je ne leur ai pas dit ce que j'avais. Quand on entend des personnes lancer des plaisanteries comme « je peux boire dans ton verre, tu n'as pas le sida », ou parler d'untel en disant « tu sais, celui qui a le sida », ça ne donne pas envie d'en dire plus.
Je ne l'ai pas dit non plus à ma famille, qui vit en Afrique. Je ne veux pas les inquiéter. Cela ne servirait à rien. Mais je sais que certains d'entre eux sont atteints de la maladie.ä
Catherine a grandi. Elle va à l'école, tout à fait normalement. C'est une très jolie et très gentille petite fille. Je ne lui ai pas dit le nom de la maladie dont elle est atteinte. Mais, un jour, elle a fait un dessin. Il y avait des fleurs, le soleil, la mer et ce qu'elle appelait des oiseaux. En regardant bien, elle avait écrit VIH. Lorsqu'elle va bien, elle refuse les médicaments. Quand elle va mal, c'est elle qui les demande. Les pédiatres tiennent compte de son bien-être : avec leur accord, on a interrompu son traitement pendant deux jours, pour lui permettre d'aller dans un centre aéré, avec les autres enfants de son âge, comme elle en rêvait.
Je me culpabilise de lui avoir transmis le virus. Si j'avais pu donner ma vie pour elle, je l'aurais fait. Un jour, j'ai posé la question à France, qui anime le groupe de parole : « Tout le monde demande des indemnités. Nos enfants ne vont-ils pas en réclamer un jour à la mère qui les a contaminés ? ». On en a ri. France m'a serré très fort dans ses bras.
Estelle
Dans les services de pédiatrie, en général, le personnel est très bien formé. Mais ce n'est pas le cas partout. J'ai effectué des soins dentaires à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, en 89 et 94. J'avais dit que j'étais séropositive. Les deux fois, on m'a convoquée à dix heures et j'ai été reçue la dernière, à midi. Dans différents services où j'ai été hospitalisée, certains membres du personnel n'entraient dans ma chambre qu'avec des gants, un masque, une double blouseä J'ai demandé à voir la surveillante et j'ai expliqué qu'il n'y avait aucun risque dans la vie quotidienne. Souvent, les choses se sont arrangées. Il m'est aussi arrivé de prendre mes affaires et de partir.
Enfin, en janvier 1995, au service d'ophtalmologie de Necker, une médecin m'a crié dessus quand je lui ai dit que ma fille était séropositive : « Vous ne vous rendez pas compte ! Nous allons devoir désinfecter le matériel ! ». Ensuite, devant ma fille, elle m'a demandé « comment avez-vous été contaminée ? Comment avez-vous contaminé l'enfant ? ».
Il reste beaucoup à faire pour former les soignants !
Au début des années 80, alors que je m'approchais du cap de la trentaine, je vivais dans le « luxe » et « l'insouciance ». Un cursus professionnel quasi-parfait, une vie privée pleine d'amis et de « débauches » en tous genres. Le sida n'était plus un mot inconnu, mais cela me paraissait encore si loinä À l'époque, je me sentais invulnérable. Puis, je me suis aperçu qu'autour de moi des gens disparaissaient. Pas seulement des « gens », mais des copains, puis des amis très proches. Je me suis retrouvé à accompagner certains d'entre eux, parmi ceux qui ne se cachaient pas. Je n'étais pas préparé à cela, et par manque d'information, par peur de poser certaines questions, et surtout sans savoir à qui les poser, je commençais à vivre dans l'inquiétude de ma propre contamination.
Ce n'est qu'en 1987 que j'ai enfin trouvé le courage de me soumettre à un test. J'ai dû insister auprès de mon médecin de famille pour qu'il accepte de me le prescrire. Je n'avais plus qu'à prendre le plus rapidement possible la direction du laboratoire, avant de changer d'avis, avant de préférer à nouveau l'ignorance.
« C'est juste un test »
Me voici donc dans une petite cabine en compagnie d'une charmante infirmière lisant mon ordonnance. Elle me regardeä Elle ressortä Sans un mot. Dix minutes passent avant l'arrivée d'une seconde infirmière, me posant la question : « Pourquoi faites vous cela ? ». Je bafouillai d'une toute petite voix : « c'est juste un test ». La jeune femme ressortit avec ces quelques mots rassurants : « Il faut que je me renseigne »ä Nouvelle attente interminableä Enfin une troisième infirmière arrive, beaucoup plus âgée, qui dans un silence très lourd, exécute enfin l'acte prescrit. Cela marquait le début d'une nouvelle attente, le début de quinze jours d'angoisseä
Lors de mon retour au laboratoire, après bien des hésitations, je me présente au comptoir de la salle d'attente. À l'annonce de mon nom, la réceptionniste prend une enveloppe, me regarde et dit : « pour vous, il faut que j'appelle le médecin-chef ». On venait de m'annoncer ce que je pris alors comme une condamnation à mort. Je suis resté là, à attendre, sous le regard des autres patients, l'arrivée du médecin annoncé. Lorsqu'enfin il se présente, la réceptionniste me désigne du doigt. L'homme de science reste à distance et me tend l'enveloppe en me disant : « votre résultat est positif, il faut retourner voir rapidement votre médecin. Au revoir Monsieur ». Je me retrouvai dans la rue, ma condamnation à la main, incapable d'enchaîner deux pensées cohérentes.
Lorsque je recouvrai enfin mes esprits, mort de trouille, je fonçai chez mon médecin, en exigeant d'être reçu immédiatement. Voyant les résultats que je lui apportai, il m'expliqua qu'il ne pouvait pas prendre en charge certains problèmes, tout comme il ne s'occupait pas des « drogués », « tous ces gens en qui on ne peut pas avoir confiance, et pour lesquels il faut être spécialiste ». Il inscrivit sur un bout de papier l'adresse d'un hôpital et le nom d'un médecin qui s'avéra par la suite n'avoir aucun rapport avec le VIH.
Colères incontrôlées
L'annonce de ma séropositivité provoqua chez moi de grosses crises d'angoisses. À propos de ma propre disparition, à propos de la mort en général. Mes premiers examens faisaient ressortir un taux d'environ 400 T4. Je me donnais un an de survie, deux ans dans le meilleur des cas. Plus rien ne valait la peine d'être vécu, tous les projets devenaient inutiles, voire même dérisoires. Assez rapidement, mes angoisses se reportèrent sur la souffrance, la déchéance physique, la fin de vie. J'étais persuadé qu'à partir du moment où « les gens en blouse blanche » te mettent le grappin dessus, tu n'as plus rien à dire. Ce sont eux qui décident de tout. Je suis encore très sensible à cela aujourd'hui. J'ai fait préciser dans mon dossier médical qu'en aucun cas, on ne pouvait me faire subir un examen ou un traitement sans mon accord exprès, tant que je serai conscient. Dans le cas contraire, que je refusais absolument l'acharnement thérapeutique, et j'en ai informé mes proches.
Ma vie a basculé, j'avais l'impression de ne plus rien maîtriser. Je me suis noyé dans le boulot. En rentrant le soir à la maison, je craquais parfois. Je restais assis, à pleurer sur mon triste sort, sur l'injustice dont j'étais victime. Ma consommation de joints et de whisky augmenta considérablement. Il m'arrivait de vider la bouteille dans la soirée. Pendant cette période, je téléphonais souvent à untel ou untel pour parler, mais très souvent cela finissait en engueuladeä
Cela a duré quelques mois, mais heureusement, j'ai fini par avoir la même réaction qu'à l'époque où j'avais tâté de quelques drogues dures : je n'ai jamais supporté que l'on porte atteinte à ma liberté, et j'ai réalisé que je plongeais dans quelque chose qui ne pouvait en aucun cas me convenir. J'ai cependant continué pendant quelque temps à avoir des crises de déprimes, des colères incontrôlées, pendant lesquelles je fracassais chez moi, des objets si possible de valeur. Je m'en suis sorti grâce à la constante présence sans jugement de mon entourage, principalement mes parents et mes frères et s¶urs.
Ma famille connaissait depuis longtemps mon homosexualité et l'avait acceptée comme quelque chose de naturel. J'ai d'abord annoncé ma séropositivité à mes frères et s¶urs puis, en accord avec eux, à mes parents. Ils m'ont tous fait comprendre que, quels que soient mes problèmes, ils seraient toujours là pour m'aider et me soutenir. J'ai eu une chance extraordinaire avec ma famille, certains de mes amis décédés du sida n'en ont pas eu autant.
Je me rappelle le jour où je téléphonai à la maman de Pascal pour lui annoncer le décès de son fils : elle me répondit que cela ne la concernait pas et me raccrocha au nez. Elle n'était jamais allée le voir à l'hôpital. Il y a des parents, comme disait Coluche, qui ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chien.
Besoin de nouvelles forces
Vint le jour où je décidai d'annoncer ma séropositivité à mes deux plus proches collaborateurs. J'en avais ras-le-bol de tous ces gens, moi y compris, qui cachaient les choses et renforçaient ainsi le sentiment de honte que beaucoup essayaient d'imposer. Je les ai invités à boire des cocktails chez moi. Ils savaient que j'étais homosexuel, je ne m'en suis jamais caché. Après l'annonce de la grande nouvelle, ils ont exprimé leur(s) inquiétude(s) par rapport à eux, par rapport à la transmission possible. Ils ont écouté mes explications et m'ont fait confiance. Ils n'ont montré aucune répugnance à trinquer avec moi. À la fin de la soirée, ils m'ont dit: « au-revoir, à demain », avec une poignée de main très appuyée. Je ne sais pas s'ils avaient encore peur, en tout cas ils ne me l'ont jamais montré.
Pendant cette période, j'ai commencé à aller assez souvent à l'hôpital : consultations, examens, aérosolsä Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux m'organiser et exiger, mais à l'époque ce n'était pas le cas, et cela commençait à créer des difficultés vis-à-vis de mon employeur. J'ai envisagé de lui en parler. Après avoir demandé leur avis à mes deux collaborateurs, ils me proposèrent de préparer le terrain. Mon patron m'invita le jour même dans un excellent restaurant, et se montra ouvert et compréhensif. Pendant quelque temps tout se passa très bien, mais brusquement, au début d'un arrêt-maladie de quelques jours, je reçus une lettre m'indiquant qu'on envisageait de se séparer de moi sous le motif de « perte de confiance ». Il ne m'a jamais donné de véritable explicationä
J'étais persuadé que j'allais retrouver rapidement un poste équivalent, puisqu'auparavant j'étais très souvent contacté par des « chasseurs de têtes ». Je ne me suis donc pas investi dans une recherche d'emploi poussée. Mais voilà : les contacts que j'ai eus à ce moment là n'ont jamais abouti. Peut-être ont-ils appelé mon ancien employeur ? Il fut bientôt trop tard : dans ma fonction, à plus de 35 ans et après plus de 6 mois de chômage, tu as perdu toute valeur.
Les presque trois années qui ont suivi ont été très dures. Je me suis parfois laissé couler. Il m'est parfois arrivé de retoucher à certains « produits » illicites. Ma famille m'a de nouveau soutenu, et tout en continuant à accompagner des amis touchés, je décidai de rejoindre l'association AIDES. J'avais besoin de nouveaux amis, et je les ai trouvés. J'avais besoin de nouvelles forces, mes nouveaux amis m'aidèrent à me les procurer.
Aujourd'hui je me suis habitué à vivre avec le virus, mais je ne me suis certainement pas résigné : je ne me considère plus comme condamné par le sida, puisque j'ai décidé de tout mettre en ¶uvre pour le vaincre.
En mon nom, au nom de tous mes amis disparus, et en celui de ceux qui sont encore présents, et que je veux absolument garder.
Hervé
Quelque temps après l'annonce de ma séropositivité, mon ami de l'époque me quitta. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, ni même s'il est toujours en vie. C'est peut-être à travers lui que j'ai rencontré le virus. C'est peut-être lui qui l'a rencontré à travers moi. Le temps passant, j'ai commencé une nouvelle relation, nous étions tout deux positifs, tout était clair entre nous, mais cette saloperie de virus décida de nous séparer, définitivement. L'accompagnement fut très dur, très éprouvant. Il me semble que je sentirai à jamais sa main sous la mienne, dans les derniers instants de notre vie commune.
Aujourd'hui, je pense que je fuis toute nouvelle rencontre « sérieuse ». Il y a toujours la peur d'avouer, la peur d'être rejeté, la peur de revivre ce que j'ai déjà vécu, et enfin le refus de faire vivre à l'autre - si je devais disparaitre - ce qui moi-même me fait si peur.
Et puis, il y a la capoteä Ma génération a participé à, et vécu la libération sexuelle, nous avons pu prendre notre pied sans contraintes. Alors je le dis : Ouiä!!! Ce petit bout de latex m'emmerde profondément. Lorsque vous n'êtes pas touché par le virus, vous savez qu'avec le temps, les tests, la confiance, vous pourrez sans doute un jour vous en passer. Moi, je sais que la capote sera toujours là.
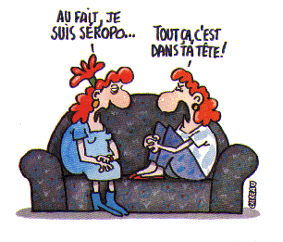
Seventies, je suis un cadre supérieur à qui tout réussit. À l'aube des années 80, je suis licenciée et vis très mal ma nouvelle situation. Mon alcoolisme notoire empire de pire en pire, et j'atteins vite un état de clochardisation avancéeä La personne avec qui je partageais ma vie prend le large et nous nous séparons. Seule avec mon alcool, je passe allègrement de cure de désintoxication en hôpital psychiatrique.
Les années du changement
1983. Grâce à Alcooliques Anonymes, je prends conscience de ma déchéance. Je vais m'en sortir. Désormais, je vivrai libre. Je vivrai pleinement le moment présent, pour moi et pour moi seule, sans jamais plus tenir compte du regard ou du jugement des autres sur ma petite personne. Libre, je vivrai enfin ma transsexualité. Rapidement, du fait de ma nouvelle identité, je fréquente des milieux que d'aucuns considèrent comme marginaux et m'adonne parfois à la prostitution, un bon moyen de m'affirmer par rapport à mes nouvelles « copines ».
Les années sida
1988. Le sida et son lot de suicides a touché nos rangs. Pourtant, en tant que professionnelles, nous ne manquons pas de nous protéger contre les MST. Hélas, il suffit d'une fois. Inquiète face au développement de cette nouvelle maladie, je me refuse à l'ignorance quant au devenir de ma vie. Cela entraverait ma liberté chérie. Je demande donc un dépistage à mon médecin traitant. C'est visiblement la première fois qu'une de ses patientes désire une telle prescription. Bon prince mais surpris, il m'envoie tout de même à l'hôpital. Prise de sang, on m'indique qu'on enverra les résultats à mon médecin. Après huit jours où j'avais conjuré l'insupportable attente par un fatalisme empreint de sérénité - du genre on verra bien ma fille -, mon bon docteur m'apprend ma séro-négativité. Ouf ! Je n'étais pas si tranquille que cela. Et je croque à nouveau la vie à pleine dents, à 200 km/h. Je travaille dans le milieu du cinéma le jour, avec mes « copines » la nuit. Insouciante, mais pas folle, face aux années sida, je multiplie les précautions.
L'annonce faite à Jeany
1993. Coquette, j'ai envie de me faire refaire le nez. Clinique privée et tout le tintouin, quand je ressortirai, Cléopâtre enviera mon nouveau profil. 8 jours avant l'opération, je rencontre l'anesthésiste. Naïve, je lui demande pourquoi le test HIV ne fait pas partie de la batterie d'examens sanguins. Aimable, le brave homme élude la question. Me voilà à la clinique. Toujours naïve mais néanmoins curieuse, je repose ma question à l'infirmière chargée d'effectuer la prise de sang le soir de mon admission. La jeune femme me répond sur le ton de la confidence que « même si ça n'est pas noté, le test est systématiquement fait quelle que soit l'opération ». Le lendemain matin, allongée sur mon chariot à l'entrée du bloc opératoire, j'entends dans un demi-sommeil - on m'a chargée de tranquillisants - l'anesthésiste m'annoncer : « au fait, vous êtes séropositive, ça ne nous empêche pas de vous opérer ! ». Rideau noir, il vient de m'endormir.
La colère de Jeany
Beaucoup plus tard, j'ouvre les yeux. Je suis seule dans la chambre. La première chose qui revient à mon esprit à peine éveillé est la phrase assassine de l'indélicat personnage. Quel lâche ! Après m'avoir annoncé la couleur, l'ordure m'a endormie. L'opération a l'air de s'être bien passée. Il ne me verra plus. C'est vraiment trop facile ! Un immense désarroi me saisit. Très abattue, tout au fond de mon lit, je tente de positiver. Dur ! Je zappe comme une folle sur toute les chaînes de la télévision, espérant accrocher une émission qui me change les idées. Sans succès. La perfide nouvelle est là, bien présente, qui m'envahit et me submerge. Je suis seule. Ce n'est pas normal d'autant que je partageais ma chambre avec un autre patient lors de mon admission. Prise de panique, je me lève et je sors dans le couloir pour vérifier si la porte de ma chambre n'est pas « marquée » d'une infamante pastille rouge. Le « marquage » que j'avais vu dans bon nombre de cliniques ou d'hôpitaux où mes « copines » touchées par le sida étaient soignées. Soulagement, je suis vierge de ce côté-là. J'en déduis immédiatement : « si on m'a mise seule dans cette chambre, c'est parce que je suis transsexuelle ». Piètre consolation, mais au moins, on a reconnu ma nouvelle identité. Plus tard, le chirurgien fait son entrée. Il est visiblement mal à l'aise. Il tente assez maladroitement d'annoncer mon statut sérologique en ignorant que je le connais déjà. Cela ravive ma grosse colère et bien malgré lui l'homme qui a refait mon nez me sert de défouloir. J'insulte copieusement son « moins que rien » d'anesthésiste. Il est sans le savoir la première personne à qui je parle depuis l'annonce de ma séropositivité.
La confirmation pour Jeany
De retour à la maison, j'appelle une « amie » très proche et lui annonce la mauvaise nouvelle. Je me sens alors libérée d'un grand poids. J'ai pu en parler. Il me faut désormais prendre le taureau par les cornes. À qui pourrai-je encore me confier ? Où m'adresser pour confirmer ma séropositivité (Western Blot) ? Pour en parler, on verra ça plus tard. L'urgent, c'est de savoir où j'en suis par rapport à cette pä de maladie. Je prends donc rendez-vous à la Salpétrière. Quinze jours pour avoir une prise de sang, plus trois semaines pour avoir un résultat. Les jours sont longs, trop longs. Je reste enfermée chez moi à classer mes papiers, à mettre de l'ordre dans ma vie en quelque sorte. J'ai soudainement pris conscience que je suis mortelle, mais sans jamais m'apitoyer sur mon sort. À court de papiers à ranger, je me mets à fouiller ma mémoire : « comment ai-je bien pu me laisser contaminer ? Moi qui faisais tellement attention, je me suis quand même laissée berner par un homme ». Heureusement, mon « amie » est très présente. Elle me sent fragilisée et me libère des contraintes quotidiennes. Côté publicité, je mets mon frère dans la confidence. Il tombe des nues et en est bouleversé. Depuis, nos liens se sont sûrement resserrés. Je décide de laisser ma mère dans l'ignorance. Le choc serait trop grand pour elle. J'avertis mon oncle ecclésiastique. J'en avais besoin par honnêteté vis-à-vis de lui et surtout, je ne voulais pas qu'il l'apprenne par une tierce personne. Sa réaction m'a confirmé tout le bien que je pense de cet homme : pas de pitié de circonstance ni de compassion de chapelle. Il appartient vraiment aux personnes sur lesquelles je peux compter en cas de coup dur. Sur le plan professionnel - dans le monde du spectacle -, je resterai très discrète. Je ne veux pas qu'on me prenne en pitié. Cinq semaines ont passé. Je les ai bien remplies mais j'angoisse à nouveau. La Salpétrière, service du Professeur Herson et le couperet de l'annonce de mes résultats qui va tomber. 634 T4, pour le reste, tout va bien, je tiens la pleine forme. Je me sens réconfortée, regonflée, avec un moral d'acier.
La gestion de Jeany
Je me dis qu'il me reste à gérer au quotidien, pour mieux gérer je dois connaître et pour mieux connaître m'informer. Toujours avec prudence, je ne veux pas me laisser manipuler par les annonces sensationnelles. Aujourd'hui, je suis volontaire à AIDES. Côté information, c'est mon «assurance sérieux» et côté humain, j'apporte une touche de sérénité face à la maladie. Après 10 ans d'Alcooliques Anonymes, je suis sûre que ma petite philosophie peut servir à lutter contre le sida : s'accorder le droit à l'erreur, ne pas culpabiliser, faire preuve de tolérance et vivre 24 heures à la fois. Avoir la sérénité d'accepter les choses que l'on ne peut changer, changer les choses que l'on peut et avoir la sagesse d'en connaître la différence. Ajoutons à cela : dans les mots hier, aujourd'hui, demain, en bannir deux. Hier parce que je ne peux rien changer au passé et demain parce que je ne sais pas de quoi il sera fait. Vive le moment présent ! Faisons en sorte qu'il soit le meilleur possible. Et toujours une petite note d'humour : « à ma naissance, j'ai commencé une longue chute du haut d'un gratte-ciel. À chaque étage de mon vol plané, je me dis tranquillement : jusqu'ici, ça va !!! ».
Jeany
Vous souhaitez nous écrire et faire part de
vos commentaires. N'hésitez pas.
Vous pouvez, si vous le souhaitez recevoir REMAIDES chez vous. Pour cela il suffit de nous écrire à :
AIDES
REMAIDES
247, rue de Belleville
75 019 PARIS
Directeur de la publication :
Pierre LASCOUMES
Comité rédactionnel :
Agnès CERTAIN
Hervé CREUSVAUX
René FROIDEVAUX
Stéphane KORSIA
Yvon LEMOUX
Bernard NICOUD
Thierry PRESTEL
Alain PUJOL
Emmanuel TRÉNADO
À la mémoire des membres du comité rédactionnel morts du sida :
Philippe BEISO, Richard DAVID, Christian MARTIN
Coordinateur :
Thierry PRESTEL
Maquette et mise en page :
Alain MACÉ
Emmanuel TRÉNADO
Remerciements à :
KROMOSCAN (pour la photogravure) et à PLANTU et CHÉREAU pour les illustrations.
REMAIDES est édité à 35 000 exemplaires et diffusé gratuitement par l'association AIDES, Ile-de-France 247 rue de Belleville 75019 Paris. Tél. : 44 52 00 00, Télécopie : 44 52 02 01,
REMAIDES, Tél. : 44 52 33 79. Minitel : 36 15 AIDES.
Les informations contenues dans REMAIDES peuvent être reproduites, sous réserve de mention de la source.
Impression : IMPRIMAINE 72650 La Chapelle St Aubin.
ISSN : 11620544