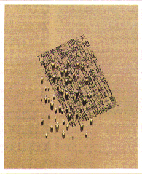
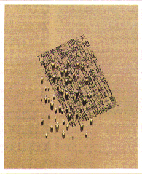
Réccurence : encre de Chine et huile sur toile, de Kim Tschang Yeul.
Remaides est un trimestriel d'informations médicales sur l'infection à VIH.
La conférence internationale sur le sida de Yokohama a confirmé une tendance qui se dessine à l'horizon depuis de nombreux mois : le cheminement thérapeutique des personnes séropositives va devenir de plus en plus personnalisé.
La multiplication des médicaments anti-VIH augmente les différentes possibilités d'usage en association (AZT + ddI, AZT + ddC, ddI + D4T etc.), à un point où il est désormais impossible de toutes les évaluer lors d'essais cliniques de grande taille. Les médecins vont donc devoir essayer ces associations pour chacun de leurs patients, et trouver des moyens de mesurer rapidement leur efficacité dans chaque cas particulier.
Cette évaluation individuelle passera probablement par un suivi rapproché de la quantité de VIH dans le sang (charge virale). Yokohama a apporté quelques éléments confirmant la relation entre l'évolution de la charge virale et la progression de la maladie : à une diminution de la première correspondrait un ralentissement de la seconde.
Bientôt, deux laboratoires vont mettre sur le marché des tests permettant la mesure de cette charge virale. Ainsi, on peut imaginer que les médecins pourront proposer des associations de deux ou trois médicaments, et savoir après quelques semaines si ce régime a permis une diminution de la charge virale de la personne traitée. En cas d'absence d'efficacité, une autre association pourrait alors être proposée, sans perdre davantage de temps.
Stéphane KORSIA
Brèves
Antiviraux, immunothérapie, vaccins. Biologie : intérêt des T4 et de la charge virale. Femmes séropositives et grossesse.
Système immunitaite et VIH
Infections opportunistes
Le sida au Japon . La loi japonaise : morceaux choisis.
L'AZT bientôt en pharmacies de ville. Fini, le parcours du combattant ?
Médicaments et repas
Les bases pour comprendre
Formes cliniques
Les traitements
Du sida
L'épidémie
La fêlure du monde. Médicaments et sida : le guide.
Les obsèques. Mémo des démarches. Exemples de prix. Pour en savoir plus.
Les compléments alimentaires sont remboursés
Le 3TC et moi
Hépatite médicamenteuse
HAD
Et la vie ? Réponse à Catherine.
Les États Généraux Drogue et Sida se sont tenus à Paris, les 4 et 5 juin. Ce fut l'occasion de réaffirmer la nécessité de développer des actions de prévention et de soutien, auprès des usagers de drogue : échange et distribution de seringues, programmes de substitution (méthadoneä), groupes d'auto-supportä
Le 21 juillet, le ministère de la Santé a annoncé plusieurs actions destinées à réduire les risques encourus par les usagers de drogue : une trousse (type Stéribox), contenant deux seringues, sera en vente au prix de 5 F, dans les pharmacies, à partir du 15 septembre ; les associations de prévention du sida auront le droit de distribuer des seringues (jusque là, c'était illégalä) ; enfin, les programmes méthadone devraient disposer de 1645 places à la fin 1994 (et davantage en 1995).
La ddC (Hivid®) est désormais disponible de la même manière que la ddI (Videx®), et dans les mêmes indications (intolérance ou résistance à l'AZT). Plus besoin de passer par l'essai clinique ouvert.
Les résultats complets de l'essai de Jonas Salk ont enfin été publiés. Il s'agit d'immunothérapie (&laqno; vaccination » de personnes séropositives avec de fragments de VIH). Il semble que les T4 des personnes &laqno; vaccinées » se maintiennent un peu mieux, et que la quantité de virus présente dans leur organisme augmente moins que chez les personnes non &laqno; vaccinées ». Des essais plus importants sont prévus aux États-Unis.
Immunothérapie : la préparation mise au point par le Dr Zagury (VIH inactivé + peptides + adjuvant) ne semble pas présenter d'efficacité : c'est ce qu'a récemment montré un essai organisé par l'ANRS (1).
Trois nouveaux documents Info plus viennent de paraître : Les examens sanguins ; le cytomégalovirus (CMV) ; douleur et sida. Ces brochures sont disponibles gratuitement auprès de l'association AIDES (coordonnées au dos de Remaides).
Wellcome a mis au point des comprimés de Zovirax® à 800 mg. Mais, faute d'accord avec l'administration française sur le prix du produit, il ne sera probablement pas disponible avant 1995.
À l'été, les projets d'études d'immunothérapie passive (transfusions de plasma riche en anticorps anti-VIH à des personnes atteintes de sida) en étaient toujours au point mort. Fin 1993, un essai (IP002, Drs Vittecoq et Lefrère) avait indiqué un intérêt potentiel de cette technique. Depuis, la situation stagne. Et l'ANRS 1 semble se désintéresser de cette voie, qui mériterait pourtant d'être explorée.
M. Beljanski, un chercheur &laqno; parallèle », affirmait que son produit (extrait de Pao Pereira, aussi appelé P100/P400, PB 100, composé Hä) luttait efficacement contre le VIH. Une expertise menée par l'ANRS (1) vient de montrer que ce produit n'a pas d'efficacité anti-VIH, sauf à des doses élevées, auxquelles il est également toxique pour les cellules.
Aux États-Unis, la D4T (nom commercial : Zerit®) a obtenu son autorisation de commercialisation, pour les personnes qui ne peuvent plus prendre d'AZT, de ddI ni de ddC (intolérance ou résistance). Rappelons que le D4T (et le 3TC) sont disponibles en France, à titre compassionnel.
L'essai Delta compare AZT + ddI, AZT + ddC et AZT seul. Une analyse intermédiaire récente a conclu que l'essai devait continuer. Ce qui signifie qu'actuellement, il n'y a pas de différence importante entre les trois traitements. Les toxicités semblent modérées. En revanche, de nombreuses personnes sont sorties de l'essai : un double aveugle trop prolongé ?
Le saquinavir (laboratoires Roche) bloque la protéase (une enzyme) du VIH. Un essai débutera d'ici l'automne, pour comparer AZT seul, AZT + ddC, AZT + saquinavir, AZT + ddC + saquinavir. Il recrutera 3000 personnes dans le monde (dont 450 en France), ayant entre 350 et 50 T4/mm3 et n'ayant jamais pris d'AZT (ou en ayant pris pour une durée limitée). Les patients resteront 18 à 26 mois dans l'étude. Ils ne sauront pas quel traitement ils ont pris avant l'analyse des résultats de l'essai. Par ailleurs, parmi les personnes qui sortiront de l'essai, seules celles qui le feront en raison d'un événement clinique entrant dans la définition du sida pourront ensuite recevoir du saquinavir en &laqno; ouvert ».
Saquinavir : Roche envisage d'ouvrir un programme compassionnel pendant le premier semestre 1995. Il sera probablement limité aux personnes qui ne peuvent plus prendre d'AZT, de ddI ni de ddC.
Lors de l'obtention du statut d'invalidité, la Sécurité Sociale attribue une nouvelle carte d'assuré social. Si cette carte ne comporte que la mention suivante &laqno; 100 % sauf pour les médicaments à 35 % », aucun médicament à 35% ne sera pris en charge à 100 %. Il est donc conseillé d'appeler son centre de Sécurité Sociale en demandant à conserver à la fois le statut d'invalidité et le 100 %. La carte portera alors les mentions : &laqno; 100 % limité aux soins relatifs à l'affection listée ; Autres soins : 100 % sauf médicaments à 35 % ». Cela permet d'être remboursé à 100 % pour tous les médicaments relatifs à l'infection à VIH.
Rétinite à CMV : le programme d'accès compassionnel au ganciclovir (Cymévan®) oral (en gélules) est ouvert depuis mi-juin. Il est destiné aux personnes qui ne peuvent pas avoir de perfusions (de manière temporaire ou définitive). Rappelons que le traitement d'attaque de la rétinite (2 ou 3 premières semaines) doit toujours se faire par perfusions ; ensuite, pour le traitement d'entretien, le Cymévan® en perfusions est plus efficace que par voie orale.
Aux États-Unis, des essais d'un nouveau type ont démarré cet été : ils visent à évaluer rapidement des associations de trois antiviraux (AZT + ddC + saquinavir ; AZT + ddI + névirapine ; AZT + ddI + 3TC etc), chez des personnes ayant entre 200 et 500 T4/mm3 et n'ayant jamais pris d'antiviral. Cet essai a été mis en place par l'ICC (Intercompany collaboration), qui regroupe les principaux laboratoires pharmaceutiques travaillant sur l'infection à VIH.
Videx® goût orange-mandarine est (enfin) disponible dans les pharmacies hospitalières. Le principe actif et le dosage sont les mêmes que précédemment. Mais le goût du comprimé change, sa taille diminue et il se dissout plus facilement.
Trente contaminations professionnelles par le VIH ont été officiellement recensées en France entre 1988 et 1993. Il s'agit surtout d'infirmier(e)s, piqué(e)s lors de prises de sang ou de perfusions. Deux personnes ont semble-t-il été contaminées par contact de sang sur une zone de peau abîmée. Le risque de contamination est estimé à 0,4 % après piqûre et à 0,05 % après contact de sang sur les muqueuses ou la peau abîmée. Le respect des précautions classiques devrait permettre d'éviter la majorité des accidents de ce type. Encore faudrait-il que tous les établissements de soins forment leur personnel, et lui fournissent un matériel adéquat.
Rétinite à CMV : un petit essai d'implants intravitréens devrait débuter très bientôt. Il s'agit d'un dispositif qu'on implante dans l'¶il, et qui diffuse du Cymévan® pendant plusieurs mois. Cet essai est coordonné par le Pr Le Hoang (hôpital Pitié-Salpétrière, à Paris).
Le valaciclovir (médicament expérimental des laboratoires Wellcome et qui, dans le corps, est transformé en aciclovir (Zovirax®)) va faire l'objet d'essais dans le traitement du zona, fin 94. Il est aussi étudié en prévention de l'infection à CMV et en traitement de l'herpès.
Jean-Claude Chermann (de Marseille) vient une nouvelle fois d'annoncer qu'il allait mettre au point très rapidement un vaccin contre le VIH. Il a déjà tenu de tels propos, au cours des années passées. On attend toujoursä
L'Académie de médecine est bien la seule à proposer, par la voix des Prs Henrion et Gentilini, la levée du secret médical (pour avertir le conjoint d'une personne séropositive). Le Conseil national du sida et le ministère de la Santé s'y opposent. Tout comme le Dr Louis René, ancien président de l'Ordre des médecins, qui vient de remettre un rapport au gouvernement à ce sujet.
Plusieurs études suggèrent que les personnes qui ont commencé l'AZT suite à leur entrée dans le sida (infection opportuniste, Kaposiä), ont en moyenne une espérance de vie nettement plus importante pendant l'année qui suit que les personnes qui, en des circonstances semblables, n'ont pas pris d'antiviral. Mais, sur deux, trois ou quatre ans, ce bénéfice en terme d'espérance de vie s'estompe et disparaît. Cependant, ces études ne se sont pas penchées sur l'intérêt d'un changement d'antiviral (passage à la ddI, à la ddCä).
L'antisens Gem 91 (laboratoires Hybridon) se fixe sur un gène du VIH, pour le bloquer. Les résultats du tout premier essai chez l'homme indiquent que ce produit est bien toléré. Mais il doit être injecté par voie intra-veineuse, en perfusions de 2 heures. D'autres études sont prévues.
Le Sommet de Paris se tiendra le 1er décembre 1994. Une quarantaine de gouvernements ont annoncé qu'ils y participeraient. L'objectif de ce sommet n'est pas de définir une politique internationale de lutte contre l'épidémie - c'est le rôle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé - mais d'obtenir des pays participants des engagements effectifs. Exemples : approbation d'un texte posant des principes éthiques (non discriminationä); lancement d'actions concrètes, en développant la collaboration entre pays &laqno; riches » et pays &laqno; pauvres » (notamment pour la sécurité transfusionelle).
D'ici la fin 94, les laboratoires Glaxo, qui ont conçu le 3TC, en céderont à Wellcome le développemement dans le domaine de l'infection à VIH. Mais Glaxo continuera les recherches sur l'intérêt potentiel du 3TC contre l'hépatite B.
(1) - ANRS : Agence nationale de recherches sur le sida
La Conférence internationale sur le sida s'est tenue du 7 au 12 août 1994, à Yokohama, au Japon. Voici les principaux résultats qui y furent présentés, concernant les antiviraux et l'immunothérapie.
Associations d'antiviraux
In vitro (au laboratoire) trois antiviraux sont plus efficaces que deux, qui sont plus actifs qu'un seul. Chez l'être humain, on a des indices en faveur d'une plus grande efficacité des associations, mais on n'a pour le moment pas la preuve de leur intérêt clinique :
1) Sur une durée de 6 à 8 mois, AZT + ddI et AZT + ddC ont un effet comparable sur les T4 et la charge virale (quantité de VIH dans le sang). Effet plus important et plus prolongé que celui de l'AZT seul. Par ailleurs, la triple association AZT + ddC + saquinavir a un effet plus prononcé sur les T4 et la charge virale qu'AZT + ddC ou AZT + saquinavir (voir paragraphe : anti-protéases).
2) Deux études indiquent que les personnes prenant des associations auraient une durée de vie plus longue que celles qui ne prennent que de l'AZT, ou qui alternent (AZT, puis ddIä). Mais ces études, réalisées a posteriori, comportent des risques d'erreurs.
3) À l'inverse, l'essai ACTG 155 n'a pas montré de bénéfice clinique de l'association AZT + ddC, par rapport à l'AZT seule ou à la ddC seule, chez des personnes ayant déjà été traitées par AZT pendant longtemps.
En conclusion : aujourd'hui, avec les médicaments dont on dispose, le fait d'avoir ou non recours à une association d'antiviraux reste une décision individuelle, fonction de la situation clinique et biologique de chacun.
Pour la troisième fois, une étude indique que la prise quotidienne d'aciclovir (Zovirax®) prolongerait la durée de vie, sans qu'on sache pourquoi. Le bénéfice le plus net est observé pour les personnes ayant moins de 50 T4/mm3. Dans les deux premiers essais, l'aciclovir était pris à la dose de 3,2 g/jour, en association avec l'AZT. Cette troisième étude ne concernait que l'aciclovir, à la dose de 600 à 800 mg/jour. Le Zovirax® est habituellement très peu toxique. Mais, chez certaines personnes, son association avec l'AZT pourrait avoir des effets secondaires neurologiques (fatigue, somnolenceä). Signalons que toutes ces études ont fait l'objet de critiques méthodologiques. Par ailleurs, AZT et Zovirax® sont fabriqués par le même laboratoire, Wellcomeä
L'essai Zidon comparait AZT seul à AZT + interféron alpha, chez 402 patients ayant entre 150 et 500 T4/mm3. L'étude a été interrompue avant son terme car elle n'avait pas détecté de différence importante entre les deux groupes, sur le plan de l'efficacité clinique ou biologique face à l'infection à VIH (cette étude ne concernait ni le Kaposi, ni l'hépatite). Les effets secondaires étaient plus fréquents chez les personnes sous interféron.
Nouveaux antiviraux
Les anti-protéases bloquent la protéase (une enzyme du VIH, différente de celle sur laquelle agissent l'AZT, la ddI etc.). Une douzaine de laboratoires pharmaceutiques ont mis au point des médicaments de ce type. L'essai ACTG 229 concernait le saquinavir de Roche (dont le nom commercial sera Invirase®) : sur 6 mois, avec l'association AZT + ddC + saquinavir, les T4 remontent un peu mieux et la quantité de virus dans le sang baisse un peu plus qu'avec AZT + ddC ou AZT + saquinavir, sans toxicité supplémentaire. Cet essai concernait 300 personnes, ayant auparavant pris de l'AZT pendant au moins 4 mois.
Au sujet des autres anti-protéases, on n'a vu que des études in vitro (au laboratoire), bien que certains aient déjà fait l'objet d'essais chez l'homme. On a repéré la possibilité d'apparition de résistances. Point positif : ces médicaments semblent très peu toxiques et pourront sans doute être utilisés en associations multiples (soit avec AZT, ddI etc., soit entre anti-protéases).
Les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (NNRTI) agissent sur la même enzyme du VIH que l'AZT, la ddI etc., mais ont une structure chimique différente. La névirapine avait déjà fait l'objet d'essais. Comme avec la plupart des médicaments de cette famille, les résistances apparaissent très vite. À dose élevée (400 mg/jour), en association avec l'AZT, ce produit semble présenter un petit intérêt (hausse des T4 et baisse de la p24 un peu plus importantes qu'avec l'AZT seul). Cependant, les effets secondaires sont assez fréquents (surtout des &laqno; rash » : boutons, rougeursä).
La delavirdine (laboratoires Upjohn) semble elle aussi présenter une petite efficacité en association avec l'AZT (avec le même type d'effets secondaires que la névirapine).
Le loviride (laboratoires Janssen), au cours d'un essai contre placebo, chez 114 patients ayant plus de 400 T4/mm3, a permis une augmentation des T4 (de 10 à 20 %), qui a duré pendant les 6 mois de l'essai. Il semble y avoir peu d'effets secondaires. Ce produit fera l'objet d'essais en association avec l'AZT et avec AZT + ddI.
D4T : les effets secondaires les plus fréquents sont les neuropathies périphériques, suivies des troubles psychologiques (insomnie, anxiété et, dans quelques rares cas, crise de panique).
L'hydroxyurée est utilisée dans certains cancers. In vitro (au laboratoire) elle inhibe la multiplication du VIH dans les cellules infectées. Cet effet est renforcé en présence d'AZT ou de ddI. Les premiers essais cliniques (à Lyon et St Etienne) indiquent qu'à dose très basse (non toxique), une molécule proche de l'hydroxyurée pourrait présenter un intérêt, en association avec la ddI. D'autres essais sont en cours.
Le GLQ 223 (alpha-trichosantin) n'a pour le moment pas démontré d'efficacité. Il doit être administré en injections et donne souvent des effets secondaires (allergie, fièvre, fatigueä).
OPC-8212 (vesnarinone) est commercialisé au Japon, pour le traitement de certains troubles cardiaques. In vitro (au laboratoire) il bloque la multiplication du VIH (et la production de TNF-alpha et d'IL-6 par les cellules infectées, ce qui pourrait avoir un effet positif). Au cours d'un essai chez 12 personnes séropositives, l'OPC-8212 a été bien toléré, mais n'a eu aucun effet sur les T4 ou la charge virale. D'autres essais vont avoir lieu avec des doses plus élevées.
La L-FddC (un médicament dérivé de la ddC) a démontré son intérêt in vitro (au laboratoire). Des essais cliniques sont envisagés.
In vitro (au laboratoire) l'aspirine bloquerait la multiplication du VIH dans les cellules infectées, selon un article du journal Science. Il est prudent d'attendre confirmation de ces résultats. En sachant que, pris régulièrement, l'aspirine peut, chez certaines personnes, entraîner des saignements ou des ulcères du tube digestif.
Thérapie génique : les premiers essais devraient avoir lieu dans les mois qui viennent, sur de petits groupes de patients. Principe : on prélève des cellules au patient. On sélectionne les lymphocytes T4. On leur greffe un gène qui leur fera produire un ribozyme, enzyme qui coupe l'ARN du VIH. On réinjecte ces cellules au patient. In vitro (au laboratoire) cela marcheä
Début du traitement
Quand commencer le traitement anti-VIH ? Les résultats de deux grands essais (ACTG 019 et Concorde) montrent qu'en moyenne, chez les personnes asymptomatiques ayant plus de 350 T4/mm3 : a) l'AZT fait gagner 30 à 50 T4/mm3. b) sur un an, l'AZT réduit un peu le nombre d'événements cliniques (mais ceci n'a pas été observé au-dessus de 500 T4/mm3). c) sur deux ans et plus, l'AZT ne réduit pas le risque d'entrée dans le sida, ni le risque de décès.
Face à ces résultats, on a vu des médecins prêcher l'audace, et des activistes faire preuve de prudence ! Le Pr Volberding reconnaît les résultats de l'ACTG 019 mais reste paradoxalement convaincu qu'il faut traiter tôt par AZT (selon lui, en dessous de 500 T4, c'est sûr ; au-dessus, c'est probable).
À l'opposé, Mark Harrington, du Treatment Action Group, estime qu'il vaut mieux se conformer aux recommandations actuelles (en résumé : débuter l'AZT soit lorsqu'apparaissent des symptômes, soit lorsque les T4 baissent au dessous d'un certain seuil, sur lequel les médecins ne sont pas d'accord, mais qui se situe en tous cas entre 500 et 200 T4/mm3).
Une piste intéressante consisterait à repérer, parmi les gens qui ont un nombre élevé de T4, ceux qui ont un risque accrû d'évolution vers le sida. La mesure de la charge virale pourrait être utile (voir encadré : biologie). Ces personnes tireraient peut-être bénéfice d'un traitement précoce.
Autre question : vaut-il mieux commencer directement le traitement par des associations d'antiviraux ? L'essai Delta devrait apporter une réponse en 1995.
Une minorité de personnes présentent des symptômes, dans les jours ou les semaines qui suivent la contamination par le VIH. 77 personnes dans cette situation ont été inclues dans un essai de 6 mois (39 ont été traitées par AZT, 38 ont reçu un placebo). Les patients ont été suivis pendant un an et demi après la fin des 6 mois de traitement. Dans le groupe qui avait pris de l'AZT, les T4 se sont maintenus à un niveau un peu plus élevé ; il y a eu 1 infection opportuniste (contre 7 dans le groupe qui avait pris un placebo). L'intérêt à plus long terme de ce traitement très précoce reste à évaluer.
Antiviraux : infos diverses
Passage de l'AZT à la ddI : un essai canadien portait sur 245 personnes ayant entre 200 et 500 T4/mm3, ayant toutes pris de l'AZT pendant au moins 6 mois et le tolérant bien. Conclusion : en moyenne, le fait de passer à la ddI donne un léger bénéfice clinique (et une petite remontée des T4), par rapport au fait de rester sous AZT. Ce résultat confirme celui des essais américains similaires ACTG 116A et 116B/117.
Interactions du ganciclovir (Cymévan®) oral (en gélules) :
- avec la ddI : la concentration de ddI dans le sang augmente de plus de 50 %, ce qui accroît probablement le risque d'effets secondaires. En revanche, la concentration de ganciclovir dans le sang (déjà basse, avec le ganciclovir oral) baisse de plus de 20 %. Il ne semble donc pas souhaitable d'associer ces deux médicaments.
- avec l'AZT : la concentration d'AZT dans le sang et celle de ganciclovir augmentent, mais ces variations restent modérées : il est possible qu'elles n'aient pas d'effet clinique.
La ddC (Hivid®) favorise l'apparition d'ulcérations buccales (plaies dans la bouche) : elles touchent 29 % des patients (contre 15 % de ceux qui sont sous AZT). Elles sont plus fréquentes après 3 à 6 mois sous ddC. Les fumeurs sont un peu moins touchés que les non-fumeurs ! Enfin, dans cette étude, l'application de corticoïdes locaux a permis de traiter ces ulcérations, et de poursuivre le traitement par ddC chez la majorité des patients.
Immunothérapies
Le Pr Andrieu (hôpital Laennec, à Paris) est convaincu qu'il faut &laqno; calmer », et non activer le système immunitaire, car il est déjà stimulé, de manière anormale, par la présence du VIH. Le Pr Andrieu avait donné de la ciclosporine (un puissant immunosuppresseur, médicament qui inhibe le système immunitaire) à ses patients. En 1988, cela avait été présenté comme LE traitement du sida. C'était tout à fait faux. En 1992-1993, le Pr Andrieu a réalisé un petit essai avec de la cortisone (qui est aussi immunosuppressive). Il affirme avoir obtenu d'importantes remontées de T4 chez ses patients. Mais ses résultats sont difficiles à interpréter (certaines données n'ont pas été présentées ; pas de groupe placebo etc.). De plus, ce protocole n'a pas été soumis à un comité d'éthique (ce qui est illégal). Rappelons que la cortisone peut avoir des effets secondaires sérieux.
Immunothérapie active (&laqno; vaccination » de personnes séropositives) : les préparations à base de gp 160 (un fragment de VIH) de Microgenesys (Vaxsyn®) et d'Immuno paraissent bien tolérées. On n'aura de résultats d'efficacité qu'en 1995.
Plusieurs petits essais indiquent que les perfusions d'interleukine II permettent une importante remontée des T4, chez la majorité des personnes traitées (surtout celles qui avaient au départ plus de 200 T4/mm3). On ne sait pas encore si cela procure un bénéfice clinique. Des essais plus importants sont prévus. (Voir Remaides N°13).
Thierry PRESTEL
Pour la mise en place des traitements préventifs (pneumocystose, toxoplasmose, mycobactériesä), le nombre de T4 reste essentiel. Pour l'instauration et la modification des traitements antiviraux (début de l'AZT, passage à un autre antiviral ou à une associationä), le suivi des T4 reste important mais il est clair qu'il ne suffit pas. Actuellement, d'autres marqueurs (bêta-2-microglobuline, antigénémie p24ä) jouent un rôle d'indicateurs complémentaires, sans être vraiment satisfaisants.
À Yokohama, on a beaucoup parlé de la &laqno; charge virale » (quantité de VIH dans le sang). Cette technique complexe et coûteuse a jusqu'ici été utilisée uniquement en recherche. Plusieurs études récentes montrent qu'il existe un lien entre charge virale et évolution de l'infection à VIH : parmi les personnes qui débutent l'AZT, celles dont la charge virale chute (après un mois de traitement) ont un risque d'évolution de la maladie plus faible que les personnes dont la charge virale ne baisse pas, ou peu. Le même phénomène est observé, lors du passage de l'AZT à la ddI.
Deux tests de mesure de la charge virale (RT-PCR de Roche et bDNA - ou ADN branché - de Chiron) devraient être commercialisés dans les prochains mois. Si son intérêt se confirme, la mesure de la charge virale devrait permettre de réduire la durée des essais d'antiviraux, mais aussi d'améliorer la qualité du suivi individuel des patients.
a) Plus l'infection à VIH de la mère est à un stade avancé, ou en phase évolutive (T4 bas, infection opportuniste, charge virale élevée), plus le risque que l'enfant soit contaminé est important. De plus, en cas d'infection avancée chez la mère, le risque que l'enfant souffre d'une forme grave et précoce de sida (avec atteinte du cerveau) est plus élevé.
b) Diverses études sur la césarienne ont donné des résultats divergents. Une synthèse de ces études indique que la césarienne ne réduit pas le risque que l'enfant soit infecté par le VIH.
c) Une étude franco-américaine (ACTG 076) montre l'intérêt de la prise d'AZT pendant la grossesse (à partir du second trimestre), pendant l'accouchement (en intra-veineux), et par le bébé, pendant les 6 premières semaines de vie : le risque que l'enfant soit contaminé par le VIH est alors de 8 % (au lieu de 25%, sans traitement). Cette étude ne concernait que des femmes ayant plus de 200 T4/mm3 et n'ayant jamais pris d'AZT auparavant. Cependant, aux États-Unis, les recommandations officielles préconisent désormais de proposer l'AZT à toutes les femmes séropositives enceintes (à partir du 2ème trimestre). En étudiant bien sûr chaque situation, et en en parlant avec la future mère. L'AZT ne présente pas de danger pour l'enfant à court terme, mais on ignore son effet à long terme. On ne connaît pas non plus l'effet des autres antiviraux (ddI, ddC), lors de la grossesse.
La conférence internationale sur le sida a permis d'appréhender le travail accompli ces dernières années, sur les mécanismes par lesquels le VIH entraîne une dégradation du système immunitaire. Les études portant sur les personnes séropositives depuis plusieurs années commencent à révéler comment leur système immunitaire parvient à contrôler le VIH. Les chercheurs s'inspirent de ces mécanismes pour imaginer de nouveaux types de traitement
Les ganglions : le lieu de la bataille
On le savait depuis la conférence de Berlin (l'an dernier), le VIH est présent et actif dans les ganglions lymphatiques dès les premiers jours de l'infection. Chez les personnes séropositives sans symptômes, un grand nombre de lymphocytes T4 présents dans les ganglions sont infectés, mais seulement un petit nombre d'entre eux produisent du VIH. Chez les personnes qui progressent dans la maladie, de plus en plus de lymphocytes produisent du VIH au sein des ganglions, qui parviennent de moins en moins à empêcher le virus de diffuser dans le reste du corps. En phase d'immunodépression sévère, les ganglions sont très endommagés et le VIH est produit en grande quantité.
Des chercheurs ont présenté la première étude cherchant à savoir si les médicaments antirétroviraux (AZT, ddI, ddC) pouvaient réduire la quantité de VIH produit par les lymphocytes des ganglions. Ils n'ont observé un effet de ce type qu'avec une association d'AZT et de ddI, et seulement chez des personnes ayant moins de 200 T4 par mm3. Chez les personnes ayant plus de 200 T4 par mm3, les antirétroviraux ne semblent pas diminuer la quantité de VIH produit par les ganglions. Ces résultats concordent (sans jeu de mots !) avec l'absence d'efficacité de l'AZT chez les personnes dont le système immunitaire est toujours en bon état.
Bien que ce type d'étude soit relativement lourd (il faut faire une biopsie des ganglions avant et après le traitement), on peut imaginer que les nouveaux traitements puissent d'abord être évalués de cette façon chez quelques personnes, avant d'être étudiés dans des essais de grande taille.
Les séropositifs de longue date : une population hétérogène
Entre la conférence de Berlin et celle de Yokohama, les &laqno;Long-Term Survivors» sont devenus des &laqno;Long-Term Non-Progressors», political correctness oblige ! Lors d'un atelier organisé sur ce thème en mémoire de l'activiste Aldyn McKean, Rob Anderson, un séropositif en parfaite santé après au moins 16 ans de séropositivité, a demandé aux chercheurs d'abandonner cette appellation barbare et d'y préférer celle de &laqno; Healthy Positive », séropositif en bonne santé.
Terminologie mise à part, de nombreuses informations nouvelles ont été annoncées à Yokohama sur les particularités des personnes dont le système immunitaire reste parfaitement sain après plusieurs années de séropositivité. Malheureusement, les définitions de cet état varient selon les chercheurs, ce qui rend difficile les comparaisons entre études ; certains sélectionnent les personnes qui sont séropositives depuis plus de 12 ans, sans symptômes et ayant plus de 500 T4 par mm3, alors que d'autres considèrent les personnes séropositives depuis plus de 5 ans, quel que soit leur taux de T4. Cependant, même si les définitions divergent, les chercheurs s'accordent sur plusieurs caractéristique.
Les séropositifs en bonne santé forment un groupe hétérogène : certains ont des souches de virus peu virulentes que les chercheurs sont en train de décortiquer, pour comprendre ce qui les rend moins agressives ; d'autres ont des lymphocytes T8 qui bloquent la production de virus de manière très intense, ou qui sont présents en très grande quantité ; d'autres enfin ont des anticorps capables de neutraliser un grand nombre de souches virales différentes.
Il est intéressant de constater que beaucoup de ces personnes ont un virus qui reste actif, avec parfois des poussées de multiplication. Ces poussées joueraient-elles un rôle dans le maintien d'une bonne immunité contre le VIH ?
Mieux connaître les relations qui se nouent entre le VIH et le système immunitaire permet d'imaginer des stratégies thérapeutiques qui s'inspirent de la capacité naturelle du système immunitaire à contrôler l'infection par le VIH.
Par exemple, un laboratoire américain a découvert une manière de sélectionner, à partir du sang d'un patient, les lymphocytes T8 qui bloquent la production du VIH et de les faire se multiplier. Un essai clinique est en cours sur une quinzaine de personnes. Les chercheurs espèrent reproduire chez ces patients ce qui sepasse chez les séropositifs en bonne santé.
Finalement, on peut regretter que, parmi les études sur le système immunitaire présentées à Yokohama, aucune n'ait concerné les personnes qui vivent depuis des années avec des T4 inférieurs à 50 par mm3. Pourtant, il y aurait beaucoup à apprendre des mécanismes par lesquels le système immunitaire de ces personnes parvient à effectuer son travail, malgré la diminution importante du nombre de T4.
Stéphane KORSIA
À la conférence internationale sur le sida de Yokohama, on a entendu très peu d'information concernant de nouveaux médicaments. Cependant, des progrès notables ont été accomplis, pour le diagnostic des infections opportunistes et l'utilisation des médicaments existants. Cet article fait le point à ce sujet. (Le prochain numéro de REMAIDES, qui devrait paraître fin 1994, comportera un article sur le Kaposi).
Les infections opportunistes sont souvent le parent pauvre des conférences internationales sur le sida. Le sujet est complexe et peu médiatique : très peu de stars de la recherche dans ce domaine mais une myriade de cliniciens sur le terrain.
C'est pourtant là que nous attendons le plus. Il y a urgence à traiter et prévenir les infections opportunistes car la qualité de vie est en jeu. On attend des traitements efficaces, peu contraignants et accessibles à tous.
Yokohama a été déroutant. Un regard sur les abstracts (somme des communications présentées à la conférence) laisse à lui seul perplexe. Là où les conférences précédentes avaient tout particulièrement bien organisé les communications orales et écrites sur les infections opportunistes, Yokohama a choisi un déroutant embrouillamini. Un exemple simple : pas d'index cette année dans les abstracts. Cherchons par exemple les communications qui traitent de cryptosporidiose, les abstracts nous invitent à reprendre jour par jour toutes les communications et à nous débrouiller.
Débrouillons l'embrouillamini : ainsi, nous verrons quatre familles d'agents pathogènes. La première, appelons-la virus (herpès, CMV, et les autres) ; la deuxième se nomme bactéries (petites ou grandes) et on y associe certaines pneumonies, ainsi que la tuberculose, les mycobactéries atypiques etc. Comment appeler la troisième : parasite ? Oui, allons pour parasite (pneumocystose, toxoplasmose, cryptosporidioseä) Quant à la dernière, il ne faut pas hésiter et parler de champignons (candidose, certaines méningites comme les cryptococcosesä).
Les virus
On saisit de mieux en mieux les mécanismes qui entraînent une baisse d'efficacité des molécules antivirales - l'apparition de souches de virus résistantes -, dans les maladies provoquées par le CMV, par exemple. Yokohama a beaucoup disserté sur le ganciclovir (Cymevan®) et le foscarnet (Foscavir®). L'apparition de CMV résistant à ces deux antiviraux est documentée depuis longtemps.
A Yokohama, les équipes de chercheurs ont présenté ces quelques résultats : on ne parle plus de la supériorité d'une molécule par rapport à l'autre. Le choix d'un antiviral (Cymévan® ou Foscavir®) se fera en fonction des effets secondaires importants. En cas d'apparition de résistance, on prend le relai avec l'autre antiviral (si c'est possible).
On peut aussi combiner les deux, et ça marche plutôt bien si l'on supporte les effets secondaires combinés (sur le rein et le nombre de globule blancs).
Pour les rétinites, les injections dans l'¶il de ganciclovir (Cymévan®) sont efficaces. Les implants de ganciclovir aussi.
On attendait des résultats sur l'efficacité du ganciclovir (Cymévan®) oral (en gélules) : rien de nouveau. Peu de choses aussi sur la prophylaxie primaire (prévention) du CMV. Pas de réponses claires pour les questions suivantes : si on combine les deux antiviraux (Cymévan® et Foscavir®) dès le départ, est-ce que l'apparition de virus résistant est aussi rapide et fréquente ? Est-ce que le ganciclovir oral peut prévenir l'apparition de la maladie à CMV ? Et le valaciclovir (nouvelle formulation du Zovirax®) dans les maladies à CMV ?
On a toujours du mal à diagnostiquer une maladie à CMV quand elle ne touche pas certains organes. Enfin, certains tests, aujourd'hui chers et délicats, peuvent aider dans la prévention et permettre d'évaluer les chances de réussite d'un traitement plutôt que d'un autre. Ils sont utilisés dans certaines études. On peut espérer que ces tests seront bientôt disponibles.
Herpès et zona ne sont pas à la mode. On ne sait toujours pas s'il faut prendre du Zovirax® pour prévenir l'herpès (même si on a des éléments en faveur de cette indication) ou une récidive de zona, et à quelle dose. Certaines études nous &laqno; bassinent » depuis des années sur les vertus du Zovirax® quant à la prolongation de l'espérance de vie chez les personnes malades du sida. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces études ? Demandez un peu à vos médecins et vous verrez les réactions, allergiques à l'idée de voir le budget de la Sécu exploser (le prix du Zovirax® est toujours faramineux), mi figue mi raisin, ou encore complètement enthousiastes à l'idée de décharger leur angoisse en écrivant une ligne de plus sur votre ordonnanceä
Les bactéries
La description des infections bactériennes a occupé beaucoup de place. Elles sont plus fréquentes qu'on ne le pensait. Yokohama souligne l'importance du diagnostic de ces infections. Il se fait par l'identification du germe. Ensuite, il suffit de traiter avec des antibiotiques. Hélas, les rechutes sont fréquentes.
On ne sait pas grand-chose de nouveau en ce qui concerne la prophylaxie primaire (prévention) des infections à mycobactéries. La rifabutine (Ansatipine®) est toujours indiquée : elle réduit de moitié le risque d'apparition de mycobactéries dans le sang.
Les résultats d'études pour la même indication sur la clarithromicyne (Zéclar®, Maclar®) étaient attendus. Ils ne sont pas encore prêts. Néanmoins des résultats préliminaires semblent indiquer que cette molécule présente un intérêt dans la prévention des mycobactérioses. Mais on peut craindre que son usage prolongé favorise l'apparition de résistances. Nous rappelons ici qu'Ansatipine® et Zéclar® sont disponibles depuis quelques mois dans les pharmacies.
Enfin, si une infection à mycobactéries se déclare chez une personne, on est maintenant certain de l'intérêt de la traiter (il y a deux ou trois ans, on avait encore des doutes à ce sujet).
Les parasites
L'intérêt du Bactrim® a été confirmé, dans la prévention des pneumocystoses et toxoplasmoses. La désensibilisation au Bactrim® est efficace chez la majorité des personnes qui l'ont suivie. Elle concerne les personnes intolérantes à ce médicament (rougeurs, démangeaisons, fièvreä). La désensibilisation consiste, dans le cadre d'un séjour à l'hôpital (entre 1 et 7 jours, selon les méthodes), à prendre des doses croissantes de Bactrim®, en commençant par des doses extrêmement faibles.
Des programmes de désensibilisation existent dans certains hôpitaux français. On espère vivement qu'ils vont s'étendre.
Face à la pneumocystose, pour les personnes qui ne supportent pas le Bactrim®, des traitements de remplacement existent depuis longtemps. Ainsi, la dapsone, l'atovaquone (Mepron® aux USA, Wellvone® en France) et les aérosols sont utilisés avec un certain succès, sans néanmoins supplanter le Bactrim®.
Signalons que l'atovaquone a récemment montré une efficacité face à la toxoplasmose. Mais elle n'est intéressante que chez les personnes qui ont des taux plasmatiques (taux de médicament dans le sang) d'atovaquone élevés. Chez les autres, le traitement a peu ou pas d'effet. Le même phénomène a été observé, dans l'utilisation de l'atovaquone en traitement de la pneumocystose. La suspension, nouvelle forme d'atovaquone à l'étude, semble avoir une bien meilleure biodisponibilité (le produit passe mieux dans le sang) que la forme utilisée jusqu'ici, ce qui résoudrait ce problème. Par ailleurs, signalons que l'atovaquone est généralement très bien tolérée.
Peu de chose sur les cryptosporidioses et microsporidioses. Les traitements à l'étude depuis quelques années (par exemple paromomycine = Humagel® ou Humatin®) montrent de l'efficacité chez quelques personnes. On ne sait pas s'il faut ou non traiter à vie ces personnes.
Les méthodes de diagnostic ont beaucoup évolué et aujourd'hui la détection de ces parasites est nettement plus facile. La fréquence de ces infections a été évoquée à Yokohama. Il s'est posé la question des modes de contaminations des cryptosporidioses. On ne peut pas pour l'heure répondre avec certitude ; on a parlé d'eau du robinet, de nourritureä
Les champignons
Les méthodes de diagnostic de ce type d'infection évoluent rapidement. Ainsi, on diagnostique mieux les méningites à cryptoccoques : elles sont donc traitées plus rapidement.
Il en va de même dans les tests de sensibilité des champignons au traitement. On ne s'acharne plus à donner des doses massives d'antifongique (médicament contre les champignons) : si un produit ne marche pas, il faut en changer plus rapidement.
Les cas de résistances sont maintenant connus et l'on manipule avec plus de précautions le nombre restreint de molécules antifongiques dont on dispose. Une petite étude indique que le Sporanox® (itraconazole) en solution buvable (qui n'est pour le moment disponible qu'au cas par cas, sur demande spécifique au laboratoire Janssen) vient à bout de la moitié des candidoses résistantes au Triflucan®. (Cette solution passe nettement mieux dans le sang que la forme de Sporanox® dont on dispose actuellement).
Des études tentant de mesurer la fréquence des candidoses vaginales ont montré que celles-ci sont plus fréquentes que prévues. Il semble important pour les femmes séropositives d'inclure un examen gynécologique régulier ; traiter le plus tôt possible ces candidoses est certainement bénéfique.
Des cas d'aspergillose et de crytoccocose ont été traités en associant des facteurs de croissance (G-CSF = Neupogen®) avec un médicament antifongique.
Conclusions
On détecte plus rapidement et plus facilement un grand nombre d'infections. On gère avec plus de précision et d'efficacité des traitements compliqués. On en mesure déjà les conséquences sur la qualité de vie des personnes infectées par le VIH ; le cumul des connaissances et l'expérience font que l'on s'approche du moment où l'on préviendra un grand nombre d'infections opportunistes. Yokohama nous a montré que cela sera possible.
Étienne TÔP
La Xème conférence internationale sur le sida s'est tenue à Yokohama, au Japon (7-12 août). Alain Minot, proche de l'association AIDES, connaît bien ce pays. Il a réalisé une étude des &laqno; comportements japonais face à la maladie ». Entretien.
Le sida existe-t-il au Japon ?
Alain Minot : Bien sûr, quoique de manière plus limitée que dans les pays occidentaux et dans les autres pays d'Asie. Au Japon, les estimations officielles (probablement sous-estimées) indiquaient, fin 1993, 3 000 séropositifs et 700 cas de sida. Les hémophiles et les transfusés représentent 2 000 de ces 3 000 cas. Il y a un énorme scandale du sang contaminé. L'autre principal mode de contamination est hétérosexuel. Il n'est pas rare que les hommes, célibataires ou mariés, aient des rapports avec des prostituées. Bon nombre d'entre elles sont originaires de Thaïlande ou des Philippines, pays fortement touchés par le VIH. C'est également en direction de ces pays que sont organisés les &laqno; sex tours ». L'usage du préservatif est très répandu. Mais il est avant tout considéré comme un moyen de contraception : il est donc peu utilisé lors de rapports avec un partenaire occasionnel. Par ailleurs, dans la société japonaise, il est très difficile aux femmes de proposer le préservatif (et plus encore de l'imposer).
La contamination par voie homosexuelle n'est pas rare (196 personnes séropositives fin 1993). En revanche, l'usage de drogues par voie intraveineuse est peu répandu au Japon (8 personnes contaminées de cette manière fin 1993).
S'il existe bien dans les faits, le sida est absent des mentalités. Les Japonais considèrent que c'est une menace venue de l'extérieur, loin de leurs préoccupations quotidiennes. Les premières campagnes de prévention avaient lieu dans les aéroports, à destination des hommes d'affaires qui partaient à l'étranger. On en est longtemps resté là.
Quelle a été l'attitude du gouvernement japonais, face au sida ?
A. M. : Elle est marquée par le désir d'étouffer l'affaire du sang contaminé. Celui-ci a été distribué jusqu'en 1987. Il s'agissait de protéger les intérêts des laboratoires pharmaceutiques nationaux.
En janvier 1987, la presse a rapporté le premier cas (officiellement reconnu) de femme japonaise contaminée par le VIH. Cela suscita un mouvement de panique dans la population : elle découvrait que le sida ne frappait pas seulement les étrangers ou les homosexuels. Les associations d'hémophiles pensent que cette campagne a été orchestrée par le ministère de la Santé : elle préparait le terrain à une &laqno; loi de prévention », dont le principal objectif était d'étouffer l'affaire du sang contaminé. Cette loi a été votée dans la précipitation. Elle est contraignante et discriminatoire (voir encadré). Elle a été vivement combattue par les associations d'hémophiles. Le gouvernement s'est finalement contenté d'exclure les personnes contaminées par transfusion du champ d'application de la loi !
Depuis 1989, plusieurs hémophiles ont intenté des procès au gouvernement. C'est extrêmement difficile : le fait d'être dévoilé comme personne séropositive peut détruire la vie professionnelle et privéeä
Comment la communauté homosexuelle japonaise réagit-elle face au sida ?
A.M. : En majorité, elle se comporte comme la population générale : on ignore le problème. On n'en parle pas. Cependant, des organisations militantes se sont créées. Elles en sont, pour la plupart, à leurs débuts : peu de militants, peu de moyens. De plus, la communauté homosexuelle japonaise est très fermée, très cloisonnée. Et certains organismes se critiquent l'un l'autre. Cela ne facilite pas le travail en communä
Le transfert de l'expérience acquise par les associations étrangères n'est pas évident : un questionnaire américain, destiné à évaluer les besoins des personnes malades, posait la question : &laqno; vivez-vous seul ? ». Au Japon, on ne peut pas aborder aussi directement un tel sujet. Sinon, la personne se sent blessée et se ferme. Pour réussir, les actions doivent tenir compte de la culture de ce pays.
Propos recueillis par Thierry PRESTEL
- Le médecin a l'obligation de communiquer à la mairie ou à la préfecture le nom et l'adresse de ses patients séropositifs (en indiquant le mode de contamination). Toutefois, les fonctionnaires qui obtiennent ces informations sont tenus au secret professionnel.
- Le médecin doit informer la mairie ou la préfecture lorsqu'un de ses patients &laqno; ne suit pas les prescriptions indiquées ».
- Mairies et préfectures peuvent &laqno; prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des personnes reconnues séropositives (ä) afin d'enrayer la contamination du sida ».
- L'immigration est interdite aux personnes séropositives.
On en parle depuis des années. C'est (presque) décidé : l'AZT pourrait être disponible dans les pharmacies de ville à l'automne ou, plus probablement, à l'hiver 1994.
Cette mesure concernera plusieurs autres médicaments (comme la ciclosporine, utilisée chez les personnes greffées ou le sumatriptan, un anti-migraineux). Il était prévu que ces médicaments portent une vignette orange (c'est discret !), mais, à la demande des associations, on s'oriente vers une vignette plus classique (blanche à liseré vert). La Sécurité sociale exercera un contrôle rigoureux de leur usage. En revanche, le remboursement (à 100 %) et les règles de prescription par le médecin ne changeraient pas. Quant à la ddI et la ddC, elles resteraient dans les pharmacies hospitalières.
Est-ce vraiment un progrès, pour les personnes en traitement ? Françoise Vincent-Ballereau (pharmacien hospitalier) a réalisé une étude auprès de 2 000 personnes séropositives (1 211 réponses). Les deux-tiers souhaitent continuer à aller chercher l'AZT à l'hôpital. Cette enquête a été transmise au ministère de la Santé (Mission Sida). Préoccupation majeure des personnes interrogées : la confidentialité. L'agencement de la plupart des pharmacies de ville ne permet pas de la garantir. Surtout lorsqu'il y a plusieurs clients. Et, l'aspect des boîtes de Retrovir® n'est pas particulièrement discretä
Autre problème : le manque de formation des pharmaciens de ville en matière d'infection à VIH. De plus, &laqno; sauf exception, ils n'ont pas l'habitude d'être en contact régulier avec le médecin de ville, et encore moins avec celui de l'hôpital, pour discuter d'une ordonnance. Or les problèmes de prescriptions, de dosages, d'interactions sont souvent complexes, chez des patients qui peuvent prendre plus de 10 médicaments ». ajoute Agnès Certain, pharmacien à l'hôpital Bichat et auteur d'une enquête sur ce sujet.
La solution est simple : l'AZT devrait être disponible à la fois dans les pharmacies de ville et dans celles des hôpitaux. Chacun pourrait aller le chercher où il le désire : à l'hôpital, pour la confidentialité et le suivi, ou en ville, parce que c'est plus pratique (rappelons que les médecins généralistes ont la possibilité de renouveler les ordonnances d'AZT). Mais il semblerait que des obstacles législatifs s'opposent à cette double dispensation. S'il n'était pas possible de les contourner, il serait préférable que l'AZT continue à être dispensé dans les pharmacies hospitalières, comme c'est le cas actuellement.
Thierry PRESTEL avec l'aide d'Agnès CERTAIN
À l'Assistance Publique de Paris (AP), on a le goût de la simplicité : une consultation, trois ordonnances. Une pour la pharmacie de l'hôpital (antiviraux) ; une pour la pharmacie de ville ; une pour la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH, rue du Fer à Moulin) (Lamprène®, Zentel®, Osfolate®, Lederfoline®, Sporanox® etc.)
Lorsqu'on travaille, ou qu'on est fatigué, obtenir ses médicaments devient un véritable parcours du combattant, compliqué par la rigidité administrative de la PCH. Les personnes atteintes d'autres affections (cancer, par exemple) sont confrontées au même problème.
L'association AIDES s'était déjà élevée contre cette situation, fin 1993. Le directeur général de l'AP, Alain Cordier, avait promis d'y remédier rapidement : les médicaments distribués par la PCH devaient désormais l'être par les pharmacies des hôpitaux
Six mois plus tard, la situation n'avait pas beaucoup évolué, sauf dans quelques établissements. Pour pouvoir dispenser les médicaments, les pharmacies des hôpitaux ont besoin de personnel et de locaux. Sinon, les délais d'attente des patients risquent de s'allonger, et les conditions d'accueil, de se dégrader. Qui dit moyens dit financement. C'est là que cela bloquait. Malgré les belles déclarations de divers responsables de l'AP.
Lassées d'attendre, les associations AIDES et Act-up ont manifesté devant la PCH, le 24 juin dernier. Cela émut les pouvoirs publics : on dépêcha un fort contingent de CRSä et Alain Cordier renouvela immédiatement sa promesse
À la fin août, il semble que les choses soient à peu près partout en place. Ou en passe de l'être : à Bichat, il faudra attendre la fin des travaux, en octobre-novembre.
Attention : bien que les médicaments soient dispensés à la pharmacie de l'hôpital, et non plus à la PCH, les formalités administratives n'ont pas changé. Pour se rendre à la consultation ou à la pharmacie de l'hôpital, il ne faut pas oublier de se munir de sa carte de Sécurité sociale, ni des étiquettes de 100 %.
Jérôme SOLETTI et Thierry PRESTEL
Certains médicaments sont mieux absorbés par le tube digestif, donc plus efficaces, lorsqu'ils sont pris à jeun (c'est-à-dire : avec un grand verre d'eau, au moins 1/2 h avant un repas ou 2 heures après). Il en est d'autres qu'au contraire il vaut mieux prendre avec un repas. Ce tableau fait le point à ce sujet. Il indique aussi le nombre habituel de prises par jour (qui peut bien sûr être modifié par le médecin).
Que faire, si, un jour, on oublie de prendre un médicament ? Ce n'est pas grave. Si on s'en aperçoit dans les heures qui suivent, on peut le prendre immédiatement, pour &laqno; rattraper ». Mieux vaut avaler pendant un repas un médicament qui devrait être pris à jeun, que de ne pas le prendre du toutä ou de sauter un repas : la nutrition, c'est aussi important que le traitement ! Si on oublie le médicament jusqu'à la prochaine prise, tant pis. On reprend le cours normal du traitement (sans doubler la dose suivante).
Peut-on boire de l'alcool lorsqu'on est en traitement ? En général, oui (sauf avis contraire du médecin), et à condition d'apprécier avec modération : mieux vaut ménager son foie et son pancréas. Cependant, il est conseillé d'éviter (ou de limiter au maximum) les boissons alcoolisées lorsqu'on prend certains médicaments anti-douleur (morphine, codéineä), des antidépresseurs, des tranquillisants ou des somnifères. L'alcool peut modifier l'action de ces médicaments et en augmenter certains effets secondaires.
Agnès CERTAIN
Thierry PRESTEL
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Rétrovir ( AZT) |
Dans l'idéal : à jeun En fait : peu importe |
3 |
L'AZT existe en sirop et sous forme injectable. Voir Zéclar, Maclar. |
Videx (ddI) |
A jeun (sinon, très mal absorbé) |
2 |
Goût : on peut écraser et diluer le comprimé (un peu d'eau, puis jus de pomme). Eviter de prendre d'autres médicaments en même temps. Au moins 2 heures entre la prise de Videx et celle de Rimifon, de Dapsone ou de Nizoral. Sinon, baisse d'efficacité de ces médicaments. |
Hivid (ddC)
|
Dans l'idéal : à jeun En fait : peu importe |
2 |
|
D4T
|
Peu importe |
2 |
|
3TC
|
Peu importe |
2 |
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Bactri m Eusaprim Baktekod
|
De préférence pendant les repas |
Préventif : 1 Curatif : 2 |
Boire beaucoup d'eau (de préférence, Vichy) pendant la journée pour éviter d'avoir un problème rénal. |
Adiazine (sulfadiazine) |
De préférence à jeun |
Idéal : 4 Souvent : 2 |
Boire beaucoup d'eau (de préférence, Vichy) pendant la journée pour éviter d'avoir un problème rénal.
|
Malocid (pyriméthamine)
|
Pendant les repas (pour tolérance digestive)
|
1 |
Au moins deux heures entre la prise de Maalox et celle de Malocid. Sinon, baisse d'efficacité. |
Disulone (dapsone)
|
A jeun |
1 |
Au moins deux heures entre la prise de Videx et celle de dapsone. Sinon, baisse d'efficacité. |
Dalacine (clindamycine)
|
Pendant les repas (pour tolérance digestive)
|
3 ou 4 |
Au moins deux heures entre la prise de Dalacine et celle de Videx ou de Maalox. Sinon, baisse d'efficacité. Eviter les produits "sucrés" au cyclamate - Sucaryl - un édulcorant. |
Wellvone (atovaquone)
|
Pendant repas gras. Sinon, mal absorbé. |
3 |
Exemples d'aliments gras : beurre, huile, charcuterie, viandes, fromages, pâtisseriesä |
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Triflucan (fluconazole)
|
Peu importe |
1 |
|
Nizoral (kétoconazole) Existe aussi en sirop
|
De préférence pendant les repas |
1 |
Mieux absorbé si pris avec boisson acide (jus d'orange, Coca-Cola). Eviter l'alcool : malaise chez certaines personnes. Au moins deux heures entre les prises de Nizoral et celles de Videx ou de Maalox. Sinon, baisse d'efficacité. |
Sporanox (itraconazole)
|
Pendant un repas gras. Sinon, très mal absorbé. |
2, puis 1
|
Voir Wellvone pour exemples d'aliments gras. |
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Zovirax (aciclovir)
|
Peu importe |
4 à 5 |
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Rimifon (isoniazide)
|
A jeun |
1 |
Limiter conso. d'alcool (pour ménager le foie). On peut prendre tous les antituberculeux ensemble, le matin à jeun. Au moins deux heures entre la prise de Rimifon et celle de Videx. |
Rifadine Rimactan (rifampycine)
|
De préférence à jeun |
1 |
Même remarque que pour le Rimifon. |
Pirilène (pyrazinamide)
|
Peu importe |
1 |
Même remarque que pour le Rimifon. |
Myambutol Dexambutol (éthambutol)
|
Peu importe |
1 |
|
Zéclar Maclar (clarithromycine)
|
De préférence pendant les repas |
2 |
Au moins une heure entre la prise d'AZT et celle de clarithromycine. Sinon, baisse du taux d'AZT dans le sang. |
Ansatipine (rifabutine)
|
Peu importe |
1 |
Limter la consommation d'alcool pour ménager le foie. |
Lamprène (clofazimine)
|
De préférence juste après un repas |
1 |
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Zentel (albendazole)
|
Peu importe |
1 |
Limter la consommation d'alcool pour ménager le foie. |
Humatin Humagel (paromycine)
|
De préférence à jeun |
3 à 4 |
Ce médicament n'est pas absorbé. Il agit localement sur les parasites présents dans l'intestin |
Imodiu m
|
Voir remarques |
8 maxi/jour |
1 gélule après chaque selle liquide. Si diarrhée importante, on peut aussi grouper les prises (3-4 gélules par prise, 1-2 prises par jour). |
Diarsed
|
Voir remarques |
8 maxi/jour |
Un comprimé après chaque selle liquide. |
Médicaments
|
A jeun ou pendant le repas |
Nombre de prises/jour |
Remarques |
Ganciclovir oral
|
Pendant les repas, sinon mal absorbé |
3 |
Ce médicament n'est disponible qu'en cas d'impossibilité d'utiliser la voie intraveineuse. |
Le dossier que nous vous présentons se compose d'un témoignage et de trois articles : les bases pour comprendre ; formes cliniques ; les traitements. Ce premier article donne quelques explications sur l'immunité (non parlementaire !). Elles permettront de mieux comprendre ce qu'est un lymphome, prolifération non contrôlée (cancer) de lymphocytes.
La moelle osseuse, usine à globules
Tous les globules du sang sont produits par la moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière (qui, elle, est située dans la colonne vertébrale et fait partie du système nerveux central) ! Cette moelle osseuse est surtout présente dans les os plats et les extrémités des os longs (moelle au gros sel pour les gourmets). Elle fabrique en permanence les cellules sanguines : globules rouges, qui sont en fait des sacs remplis d'hémoglobine, protéine transporteuse de l'oxygène des poumons vers les tissus ; plaquettes, indispensables à la prévention et à l'arrêt des saignements ; globules blancs (polynucléaires, lymphocytes, monocytesä). Le rendement de cette usine (des milliards de globules fabriqués tous les jours) est sous le contrôle de facteurs de croissance (qui sont utilisés dans certains traitements) : interleukines ; érythropoïétine (Eprex®), qui active la production de globules rouges ; G-CSF (Neupogen®) et GM-CSF (Leucomax®), qui stimulent la production de certains globules blancs.
Parmi les globules blancs, les polynucléaires, les plus simples, s'activent à nettoyer l'organisme des bactéries qui voudraient le pénétrer. Les monocytes sont les éboueurs de l'organisme, on les nomme macrophages lorsqu'ils quittent le sang pour les tissus où ils sont omniprésents ; ils coopèrent avec les lymphocytes. En effet, ceux-ci ont pour lourde tâche d'organiser et de coordonner le système immunitaire, c'est-à-dire de reconnaître et détruire les éléments étrangers à l'organisme (bactéries, virus, parasites, champignons, cellules étrangères) et même les cellules lui appartenant mais dont le développement trop rapide devient incontrôlable : les tumeurs, bénignes (sans gravité) ou malignes (cancers). Car à tout moment une cellule peut se mettre à se multiplier trop vite, sous l'effet d'une modification même minime de son patrimoine génétique (erreur lors de la division cellulaire, mutation spontanée ou provoquée par un virus par exemple). Le système immunitaire est vigilant et détruit ces petits groupuscules de cellules anarchiques. Vous avez dit Pasqua ?
Le système immunitaire
Mais revenons sur les lymphocytes, véritables policiers chargés de vérifier l'identité de tous ceux qu'ils rencontrent et, si besoin, de les exterminer, avec l'aide des autres globules blancs. Si un des constituants (antigènes) du nouveau venu ne figure pas sur le catalogue du &laqno; soi » (c'est à dire : n'est pas reconnu comme faisant partie de l'organisme de la personne), les lymphocytes sont activés et se multiplient afin de l'éliminer.
Les lymphocytes B (de &laqno; bone marrow », la moelle osseuse) tuent en fabriquant des anticorps spécifiquement dirigés contre le contrevenant : ces anticorps ou immunoglobulines (Ig) sont des protéines qui circulent dans tout l'organisme à la recherche de l'antigène correspondant, pour le neutraliser : on parle d'immunité humorale. Lorsqu'une production de lymphocytes identiques (clone) est dirigée spécifiquement contre un unique antigène, on parle d'anticorps monoclonal.
Les lymphocytes T (de thymus) circulent par contre à sa recherche et l'exterminent eux-mêmes ; ils sont aussi spécialisés contre UN antigène (un fragment d'une bactérie, d'un virusä) précis : c'est l'immunité cellulaire. Il y a une coopération très étroite entre les lymphocytes B, les lymphocytes T et les macrophages. Il existe de nombreux sous-types de lymphocytes T, de fonctions variées.
De petites protéines, les cytokines, leur permettent de s'envoyer des informations : un véritable &laqno; fax » biologique (interférons, interleukines, tumor necrosis factor - TNF - par exemple).
Le système lymphatique
Les lymphocytes et les macrophages parcourent les vaisseaux sanguins, mais aussi les vaisseaux lymphatiques. La lymphe que ces derniers contiennent est un liquide qui circule très lentement des tissus (peau et muqueuses notamment) vers le thorax et finit par se jeter dans une veine du cou. Lorsqu'un vaisseau lymphatique est coupé ou comprimé, la lymphe s'accumule en amont. Ainsi, le sarcome de Kaposi, lorsqu'il est très étendu, peut entraîner un lymph¶dème des extrémités (les mains ou les pieds sont alors gonflés de lymphe).
Le système lymphatique comporte des vaisseaux et des relais que sont les ganglions. Ayant rencontré un antigène nouveau, le lymphocyte est activé et se multiplie dans le premier ganglion rencontré : c'est la réaction lymphoïde, responsable des gros ganglions (appelés adénopathies) que l'on peut palper s'ils sont périphériques (aine, aisselle, couä) ou visualiser s'ils sont profonds (par radio, scanner, échographieä).
Les adénopathies
Les causes de gros ganglions peuvent être infectieuses ou tumorales, bénignes (sans gravité) ou malignes (cancéreuses). Parfois la cause est évidente : abcès dans le territoire correspondant, tuberculose, angine, cancer (sein, prostate, colon par exemple). Sinon la clé du diagnostic repose sur l'examen au microscope d'un fragment de ganglion prélevé par ponction ou biopsie.
Qu'est-ce qu'un lymphome (enfin !) ?
Il s'agit d'un cancer développé à partir des lymphocytes eux-mêmes. Toutes les situations où le système immunitaire est affaibli (immunodépression) favorisent l'émergence de cancers : les lymphomes étaient connus bien avant l'apparition de l'infection à VIH. Mais, au cours de celle-ci, ils sont nettement plus fréquents.
Il existe environ 15 types de lymphomes. Leur classification très complexe repose sur deux éléments essentiels. En premier lieu le type de la cellule qui se cancérise : lymphocyte B ou T, grade de malignité plus ou moins élevé (degré d'anormalité des cellules du lymphome), rapidité d'évolutionä Et l'extension du cancer : ganglions seulement, palpables ou profonds (thorax, abdomen, petit bassin), atteinte viscérale associée (foie, rate, poumons, c¶ur, moelle osseuse, système nerveux central, etc), signes généraux associés (fièvre, amaigrissementä).
De tous ces critères se dégagent deux grands types de lymphomes : la maladie de Hodgkin et les lymphomes malins non-hodgkiniens (malins, car ce sont des cancers ; non hodgkiniens, car il ne s'agit pas de maladie de Hodgkin). Les modalités thérapeutiques dépendent de tous ces facteurs et suivent, comme pour les leucémies, des protocoles d'associations complexes de chimiothérapie (médicaments anti-cancéreux) et de radiothérapie (traitement par les rayons) qui permettent bon nombre de guérisons à l'heure actuelle.
René FROIDEVAUX
Le lymphome est un type de cancer, dû à la prolifération anarchique de certains lymphocytes. Il survient chez 5 à 10 % des personnes malades du sida. Le traitement repose essentiellement sur la chimiothérapie (perfusions de médicaments anticancéreux) et la radiothérapie (traitement par les rayons). Lorsque le lymphome survient chez des personnes avec un système immunitaire en bon état (plus de 200 T4/mm3, pas d'infection opportuniste), les chances de rémission sont supérieures à 60 %. Cela signifie qu'avec un traitement intensif, dans plus de 60 % des cas, la personne sera &laqno; guérie » du lymphome. Cette rémission est souvent durable (pas de rechute). En revanche, lorsque le lymphome survient chez une personne avec moins de 100 T4/mm3, ayant déjà eu des infections opportunistes, la situation est beaucoup plus sombre : les rémissions sont plus rares (moins de 20 % des cas). Cependant, le traitement permet souvent d'améliorer la qualité de vie, en réduisant la taille des tumeurs.
Le lymphome inaugure le sida dans 4 % des cas ou survient au cours de son évolution chez 5 à 10 % des malades. Cette dernière situation apparaît de plus en plus fréquente avec l'allongement de la durée de vie qu'ont permis les progrès du traitement antiviral ainsi que de la prévention et du traitement des infections opportunistes. Trois types de lymphomes sont observés au cours du sida, mais on retiendra avant tout les deux formes de présentation de cette maladie : l'une, chez des personnes peu ou pas immunodéprimées, réagit relativement bien au traitement ; l'autre qui survient sur une immunodépression profonde, &laqno; en fin de course du sida », est gravissime.
Le VIH, parce qu'il a pour cible précisément les lymphocytes, notamment leur sous-population T4 (ou CD4+), responsable de la régulation du système immunitaire, provoque un déficit immunitaire cellulaire (T) progressif. Le système immunitaire est tellement complexe que des anomalies de tous ses constituants apparaissent.
Au début de l'infection par le VIH, alors que les T4 peuvent encore être normaux en nombre (mais pas forcément en qualité), les T8 sont activés, d'où la fameuse baisse du rapport T4/T8. Les lymphocytes B se multiplient aussi trop vite et de ce fait les immunoglobulines (anticorps) sont produites en trop grande quantité : on appelle cela une hypergammaglobulinémie.
Les gros ganglions qui peuvent se développer chez un séropositif asymptomatique sont dus à cette stimulation des lymphocytes B (on appelle cela : lymphadénopathie bénigne chronique). Les ganglions grossissent lentement et de façon assez symétrique. Il peut s'y associer des signes généraux : fièvre, sueurs, perte de poids, fatigue (auparavant appelés ARC, aids related complex). Ce n'est pas un critère de sida, mais ce peut être un argument pour instituer un traitement antiviral, quel que soit le nombre de T4. Par ailleurs, certains médecins pensent que la lymphadénopathie chronique pourrait augmenter le risque de lymphome.
Trois types de lymphomes
Bien que cette réaction humorale (c'est à dire : due aux lymphocytes B) puisse contenir l'infection par le VIH pendant plusieurs années, elle peut dépasser ses objectifs et une population de lymphocytes B peut se cancériser, échappant au contrôle de l'immunité cellulaire (due aux lymphocytes T), qui est affaiblie. Une multiplication anarchique d'un ou de plusieurs lymphocytes peut survenir : un lymphome.
Au cours du sida, on observe une fréquence accrue de maladies de Hodgkin (un type particulier de lymphome) et surtout de deux types de lymphomes non-hodgkiniens (appelés ainsi car ce ne sont pas des maladies de Hodgkin) : le lymphome disséminé et le lymphome primitif du système nerveux central, tous deux développés à partir de lymphocytes B et particulièrement agressifs. Le virus d'Epstein-Barr (EBV), membre de la célèbre famille des herpèsvirus (qui comprend le virus herpès, le redouté cytomégalovirus et le virus varicelle-zona), est responsable de probablement la moitié des lymphomes non-hodgkiniens. Surtout dans la forme tardive. En effet, il infecte et stimule spécifiquement les lymphocytes B.
Lymphome non-hodgkinien disséminé
Il survient dans 75 % des cas chez des patients ayant plus de 50 T4. Les symptômes sont extrêmement variables, selon l'endroit où il se développe, puisque le tissu lymphoïde est partout. Il peut s'agir de gros ganglions palpables (souvent asymétriques et apparus rapidement) ou profonds (thorax, abdomen) mais les localisations extra-ganglionaires (hors des ganglions) sont très fréquentes : moelle osseuse, méninges (qui sont les membranes entourant la moelle épinière, située dans la colonne vertébrale, et le cerveau), système nerveux, foie, système digestif (bouche, ¶sophage, estomac, intestin, colon, rectum et anus). Le diagnostic doit être évoqué devant tout saignement digestif (la fibroscopie, la coloscopie sont alors des examens utiles). Une jaunisse par obstruction des voies biliaires, des douleurs anales, une pleurésie (atteinte de la plèvre, qui entoure les poumons) ou des troubles cardiaques doivent faire évoquer le diagnostic. Des signes généraux isolés également : fièvre, amaigrissement, sueurs nocturnes.
À noter que la croissance tumorale peut être extrêmement rapide (doublement de volume en moins de 48 heures) et nécessiter un diagnostic urgent. Dans ce cas la &laqno; fonte » du lymphome sous traitement peut être aussi rapide. Il s'agit en règle générale d'un lymphome dit de Burkitt.
Les examens de sang sont de peu d'aide, en dehors d'une élévation franche d'une enzyme appelée LDH ou du taux sanguin d'acide urique. Des examens radiologiques (scanner, IRM, scintigraphie) peuvent découvrir une tumeur. Si celle-ci est accessible, une ponction ou une biopsie permettra l'analyse précise du type et de la gravité du lymphome. Certaines infections opportunistes peuvent simuler un lymphome, d'où la nécessité de recherches microbiologiques systématiques (recherches de bactéries, parasites etc.).
Une fois le diagnostic établi, un bilan d'extension s'impose pour définir le traitement optimal : il comprend au minimum un scanner cérébral + thoracique + abdominopelvien (de l'abdomen et du bassin), une biopsie ostéomédullaire (on prélève de l'os et de la moelle osseuse) du bassin, indolore si bien faite, et une ponction lombaire à la recherche de cellules cancéreuses (l'atteinte des méninges peut être asymptomatique).
Lymphome primitif du système nerveux central
Ce lymphome se localise d'abord dans le système nerveux central (composé de la moelle épinière, située dans la colonne vertébrale, et du cerveau). Il est plus rare que le lymphome disséminé et, contrairement à lui, survient dans 75 % des cas chez des patients sévèrement immunodéprimés, ayant de nombreuses infections opportunistes à leur actif. Les symptômes présentés peuvent être des maux de tête, des troubles du caractère, de la mémoire, du langage, des crises d'épilepsie ou des signes neurologiques : faiblesse voire paralysie ou perte de sensibilité d'un hémicorps (moitié droite ou gauche du corps), douleurs faciales, troubles visuels, etc.
Le scanner (ou mieux l'IRM, examen encore plus précis) montrent une ou plusieurs masses intracérébrales (dans le cerveau), souvent semblables à celles créées par une toxoplasmose cérébrale. Étant donné l'urgence, un traitement antitoxoplasmique est immédiatement entrepris. Ce n'est qu'en cas d'échec qu'une biopsie cérébrale par ponction sous scanner doit être envisagée (le médecin introduit une aiguille au travers d'un os du crâne, en contrôlant son trajet grâce au scanner, et prélève un fragment de la tumeur. Cela se fait sous anesthésie locale). D'autres infections opportunistes peuvent aussi simuler un lymphome cérébral.
Maladie de Hodgkin
Bien que cela soit discuté, la maladie de Hodgkin apparaît plus souvent au cours de l'infection par le VIH. Le diagnostic est confirmé par la présence de cellules très particulières (dites de Sternberg) à la biopsie d'un ganglion. Cette maladie est souvent plus grave chez les personnes séropositives que chez les personnes séronégatives.
Dans tous les cas, le diagnostic précis du type de lymphome et de son extension est indispensable pour en évaluer la gravité et mettre en place un traitement adapté.
René FROIDEVAUX
Je témoigne ici pour un des fondateurs de Remaides, Philippe Beiso, décédé il y a trois ans et demi d'un lymphome associé au sida. Après un ARC, il était entré dans la maladie déclarée en 1988 par une toxoplasmose cérébrale. Un an plus tard, un 14 juillet resté gravé dans ma mémoire comme celui où nous nous étions rencontrés en 1982, il a développé une rétinite à CMV suivie de multiples rechutes. Le cathéter qu'il avait permettait en outre une nutrition parentérale partielle, des prélèvements sanguins hebdomadaires ainsi qu'occasionnellement une transfusion sanguine ou une cure d'amphotéricine pour sa candidose ¶sophagienne. Et j'en passeä Bref, un traitement lourd mais supportable de par le fait que nous étions tous deux internes des hôpitaux et l'accomodions à notre gré, en voyage notamment, sans subir les contraintes de l'HAD (hospitalisation à domicile).
En novembre 1990, Philippe a commencé de à plaindre de douleurs dans le bas du dos. Radios normales. Une kinésithérapie et des massages biquotidiens ont apporté une certaine amélioration, mais après 15 jours en Guadeloupe les douleurs sont devenues intolérables, l'empêchant totalement de s'allonger, même la nuit. Je crois les avoir niées pendant plusieurs semaines, l'accusant même de faire du cinéma.
Début janvier 1991, après des fêtes familiales très unies, nous sommes allés revoir un rhumatologue, sans résultat. Etant donné l'intensité des douleurs qui nécessitaient de petites doses de morphine, il a refait des radios. Je ne peux décrire le regard que nous avons échangé lorsque nous les avons regardées : une vertèbre lombaire était tassée. Une métastase (1) à l'évidence, d'un lymphome bien sûr dans ce contexte. Il a alors eu ces mots terribles : &laqno; il va falloir te préparer, nous avons un mois devant nous »ä Hématologue, il savait de quoi il parlait.
Mais dès le lendemain nous avons repris le combat avec l'espoir d'une localisation unique du cancer voire d'une autre cause de tassement vertébral, comme une tuberculose osseuse. En trois jours, le diagnostic et le bilan d'extension étaient faits : scanner lombaire et cérébral, échographie abdominale, scintigraphie osseuse, prélèvement de la tumeur sous anesthésie locale, biopsie du bassin, ponction lombaire et le reste. Il y avait plusieurs métastases osseuses et hépatiques, ce qu'il ne sut pas.
Un traitement était débuté : cortisone, chimio dans la ponction lombaire et radiothérapie massive sur les vertèbres lombaires qui l'a complètement soulagé. Je savais que ce n'était qu'un traitement palliatif, lui aussi.
Il n'est pas mort directement du lymphome, mais d'un ¶dème au poumon car son coeur était touché par le VIH. Cependant il a eu un effondrement de ce qui lui restait de système immunitaire, avec une explosion virale hallucinante comme en témoignait une antigénémie p24 que je reçus plus tard : plus de 25 000 !!!
R.F.
(1) - Une métastase est une localisation d'un cancer, ailleurs que dans son lieu d'origine.
Le stade d'évolution de l'infection à VIH détermine le choix du traitement. En effet, chez les personnes peu immunodéprimées, on peut avoir recours à une chimiothérapie intensive. Depuis 4 ans, l'espérance de vie a été sensiblement améliorée, grâce notamment aux facteurs de croissance (G-CSF = Neupogen®, GM-CSF = Leucomax®). Pour les lymphomes chez des personnes très immunodéprimées, la chimiothérapie (si nécessaire à dose réduite) et la radiothérapie (traitement par rayons) permettent souvent d'améliorer la qualité de vie.
Seul un cancérologue ou un hématologue particulièrement compétent en matière de sida peut conseiller le traitement optimal au cas par cas, car les progrès sont rapides et les protocoles, lourds. Seuls des protocoles rigoureux ont permis et permettront des progrès rapides et réels dans le traitement de ces lymphomes associés au sida. Ils sont très nombreux, aux États-Unis en particulier. À Paris, l'hôpital St.Louis parait le mieux adapté pour prendre en charge ces malades ou au moins conseiller leurs médecins (Dr. Oksenhendler) (1).
Chimiothérapies
On appelle ainsi tout traitement chimique (chimiothérapie antituberculeuse par exemple). Utilisé seul, ce terme fait référence aux &laqno; chimio » anticancéreuses. Leur essor depuis 30 ans a permis des progrès majeurs dans le traitement des maladies hématologiques (maladies du sang). Un traitement par cortisone peut y être associé.
On dispose de nombreux médicaments qui empêchent la division des cellules, surtout celles à renouvellement rapide. Ils s'attaquent aux cellules cancéreuses mais aussi, hélas, aux cellules de la moelle osseuse.
Les effets secondaires des &laqno; chimio » peuvent atteindre toutes les cellules du sang : anémie (baisse du nombre de globules rouges ou de leur qualité), responsable de fatigue ou d'essoufflement (si moins de 8 g d'hémoglobine/dl) ; neutropénie (baisse du nombre de certains globules blancs, les polynucléaires neutrophiles), à l'origine d'infections bactériennes comme les septicémies (présence de bactéries dans le sang) (si moins de 500 polynucléaires/mm3) ; thrombopénie (baisse du nombre de plaquettes) pouvant provoquer des saignements (si moins de 30 000 plaquettes/mm3).
C'est cette toxicité médullaire (sur la moelle osseuse) qui, chez les malades en mauvais état général et prenant déjà des médicaments de même toxicité (AZT, ganciclovir), limite les doses de chimiothérapie. Les facteurs de croissance, GM-CSF (Leucomax®) et G-CSF (Neupogen®) en particulier, sont d'une grande utilité (ils agissent sur la moelle osseuse pour lui faire produire des globules blancs). Des transfusions de globules rouges (culots globulaires) ou de plaquettes peuvent être nécessaires.
Inutile de détailler les différents médicaments de chimiothérapie utilisés. Ils sont associés dans des protocoles aux noms barbares : CHOP, pBACOD, PRO-MACE, MOPP-ABVD, etc., chaque lettre indiquant un médicament. Les doses peuvent être réduites de moitié chez les patients très immunodéprimés afin d'améliorer la tolérance, avec des résultats encourageants.
Les autres effets secondaires varient selon les médicaments : chute des cheveux, hépatite, vomissements, diarrhée, atteinte cardiaque, neuropathieä Ils justifient une surveillance médicale étroite.
Traiter les méninges
Même en l'absence d'atteinte initiale des méninges (les membranes qui entourent la moelle épinière et le cerveau), une chimiothérapie injectée par ponction lombaire (aiguille insérée entre deux vertèbres, dans le bas du dos) est indiquée, en particulier s'il existe une atteinte de la moelle osseuse. Précisons qu'une ponction lombaire bien faite et avec une petite aiguille n'est pas plus douloureuse qu'une prise de sang.
Radiothérapie
La radiothérapie est le traitement par rayons. Elle est fréquemment utilisée contre les cancers. Lorsqu'il existe une atteinte du système nerveux central (moelle épinière ou cerveau), surtout s'il s'agit d'un lymphome primitif du système nerveux central, une irradiation cérébrale totale (radiothérapie de tout le cerveau) permet souvent une amélioration des symptômes neurologiques et donc de la qualité de la vie, même si sa durée n'est pas allongée. Certains patients se sont même réveillés de leur coma.
Une radiothérapie localisée peut également être utile lorsqu'une localisation du lymphome est douloureuse (lorsqu'il comprime un nerf ou atteint un os, par exemple) (voir le témoignage p15). Elle n'est évidemment que palliative (son but est avant tout de réduire la douleur).
Espérance de vie
Parmi les deux types de lymphomes non-hodgkiniens observés au cours du sida, le plus grave est le lymphome primitif du système nerveux central. Le lymphome disséminé est de meilleur pronostic (le pronostic est l'évolution probable d'une maladie, chez une personne). Mais l'espérance de rémission voire de guérison dépend avant tout de l'état immunitaire du patient. L'espérance de vie est nettement plus longue chez les patients peu immunodéprimés, n'ayant jamais fait d'infection opportuniste, en bon état général et n'ayant pas d'atteinte viscérale (en particulier de la moelle osseuse) : elle avoisine maintenant 40 % à deux ans lorsque le chiffre initial de T4 est supérieur à 200/mm3, alors qu'elle ne dépasse pas 2 à 3 mois lorsque le déficit immunitaire est profond, les malades décédant surtout d'infections opportunistes.
Quant à la maladie de Hodgkin, elle est traitée de façon conventionnelle (comme chez les personnes séronégatives), par radiothérapie et/ou chimiothérapie selon son extension (stades I à IV). La moitié des malades vivent plus de deux ans.
Traitements associés
Tous les cas de figure peuvent se présenter, entre ces deux formes schématiques (précoce et tardive) de lymphome. Le patient, pleinement informé de son pronostic et des possibilités thérapeutiques, peut participer à la décision.
Cependant, la prévention de la pneumocystose doit être systématique, quel que soit le nombre de T4. On a en effet observé un très fort taux de cette infection opportuniste au cours des chimiothérapies, qui sont immunosuppressives (elles abaissent les défenses immunitaires) (le chat se mord la queue !).
Un traitement antiviral associé, si possible autre que l'AZT (toxique pour la moelle osseuse), est bien évidemment souhaitable.
Une hospitalisation s'impose pour faire le bilan du lymphome et débuter le traitement. La pose d'un cathéter central (à émergence cutanée ou à chambre) simplifie considérablement la vie des patients etä des infirmier(e)s. Une asepsie obsessionnelle est de rigueur (respect très strict des règles de maniement du cathéter, afin d'éviter les infections).
Perspectives d'avenir
La compréhension récente des mécanismes d'apparition des lymphomes au cours du sida doit se poursuivre, ouvrant de nouvelles approches thérapeutiques : la recherche de médicaments moins toxiques pour la moelle osseuse et le système immunitaire - ou ce qu'il en reste - est une priorité : toxines dirigées contre les lymphocytes anarchiques, anticorps monoclonaux, antagonistes des interleukines 6 ou 10 que l'on sait jouer un rôle dans la genèse des lymphomes malins non-hodgkiniens.
Signalons enfin un protocole débuté récemment à Paris associant une expansion des lymphocytes T8 et une perfusion d'interleukine. À suivreä
René FROIDEVAUX
(1) - Hôpital Saint-Louis : Tél. : (1) 42 49 49 49.
Dr Eric Oksenhendler, service du Pr Clauvel : Tél. : (1) 42 49 96 90.
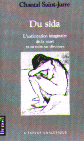
J'ai toujours du mal à apprécier un ouvrage sitôt qu'y affleurent régulièrement des expressions caractéristiques d'une spécialité, ici la psychanalyse, qui soit recouvrent un sens différent du sens commun, soit sont hermétiques pour le non-initié. Mais il est vrai que la collection dans laquelle paraît ce livre, &laqno; l'espace analytique », n'est pas ciblée vers le grand-public : ce livre est plutôt destiné à des professionnels qu'au vulgum pecus.
Néanmoins il touche, et dans tous les sens du terme.
Il touche droit à un point faible des états et sociétés dits modernes, par le constat du court-circuit institutionnel dont sont frappés la mort et le deuil. Ce sont les personnes concernées par le sida qui ont dû faire face - charge et chance - non seulement à l'urgence et l'exclusion sociale, mais aussi, au-delà de jugements moralistes à l'emporte-pièce, à l'exclusion qu'accomplit la mort même. Par delà une profession médicale qui ne se reconnait qu'une mission - guérir -, cette analyse frappe au niveau où la mort est un événement psychique et pas seulement l'ultime avatar biologique.
Il touche droit au c¶ur avec un fragment de la cure thérapeutique de Joseph, homosexuel séropositif, avec d'autres tranches de vies encore, soudainement oblitérées en plein développement, mais toujours en quête de sens. Séropositif, malade, thérapeute ou accompagnateur bénévole, qui se frotte à la mort plus qu'il n'est bienséant dans cette société, s'y pique en rencontrant ses derniers retranchements.
Sans oublier le &laqno; touché-coulé » de la loi d'indemnisation des hémophiles contaminés, calquée sur celle des victimes du terrorismeä
Le dernier chapitre, &laqno; le deuil impossible », nous apprend d'abord que les vies et ¶uvres de Van Gogh, Dali, Sabato, etc. se sont jouées sur le fond d'une lutte impossible contre un frère aîné décédé avant leur naissance et dont ils portent le prénom, sous le poids d'un double envahissant idéalisé par leurs parents. Certainement et très intéressant. Suit alors une analyse de l'avortement, comme &laqno; modalité du complexe de castration » : ma perplexité croît. J'ai l'impression que voilà la suite d'un autre livre. Réaliser le lien avec le deuil-sida est au-delà de mes capacités. S'agit-il de montrer, quelle que soit la situation sérologique mais à travers d'autres exemples extrêmes, la difficulté pour tout humain à vivre avec la mort, à mourir symboliquement pour vivre enfin ? Assez tordu.
DU SIDA, l'anticipation imaginaire de la mort et sa mise en discours ; Chantal Saint-Jarre ; éd. Denoël.
Sylvie DUGEAY.

&laqno; Patchwork », titre du premier chapitre de cet ouvrage, en annonce la structure : vingt chapitres et autant de pièces indépendantes, reliées par le fil unificateur du sida, chacun en présentant un aspect rencontré par Bernard Paillard lors de son enquête de 3 ans dans la ville de Marseille.
Dans ce cadre, défilent donc les morceaux choisis de l'auteur -fatras des médecines douces, toxicomanie, prostitution, Baumettes, VIH ou version laïque d'un châtiment divin renvoyant à la faute et au péché, chrétiens, homosexuels, etc. Le tout sur fond de rivalités, antagonismes, manque de communication et contradictions entre associations, administrations, médias et politiques.
Le dernier chapitre, &laqno; Reliques », boucle tout naturellement le livre, rapportant avec une grande émotion l'histoire d'un autre patchwork, aussi symbolique mais bien palpable : chacun de ses panneaux, créé et cousu pendant de longues heures en mémoire d'un mort cher, évoque un être et une vie. Assemblés par la couture d'une fin similaire, ces panneaux déployés lors de manifestations, proclament et inventent une nouvelle forme de deuil adaptée à ce siècle.
&laqno; Le sujet a déboussolé mes principes sociologiques », nous livre l'auteur : cette recherche qui côtoie la maladie et la mort - un monde où l'action est plus urgente que la réflexion - s'est transformée en expérience individuelle. Balloté dans une réalité sociale aussi éclatée que le tableau clinique d'un sida déclaré, il se prend à douter de sa science, la sociologie. La certitude et l'objectivité des statistiques cachent (et finalement montrent) les a-priori, connaissances, intérêts, émotions et blocages des sociologues en particulier.
Mais voilà que tant de doutes et modestie soudain m'irritent. À chaque instant, l'auteur nous prévient contre les généralisations que cette succession de tranches de vie racontées, expériences forcément partielles et partiales, pourraient engendrer, alors qu'il faudrait pour les comprendre être aussi chroniqueur local, juriste, médecin, etc. Voilà qui est honnête. Mais oublie-t-il que même mis en garde contre des généralisations hâtives, ses &laqno; anecdotes sans doute (!) exceptionnelles » sont néanmoins ce que son lecteur va retenir et fixer.
Que va-peut-doit donc en tirer ce lecteur ? Même pour la bonne cause, le procédé rejoint, en moins caricatural, les méthodes médiatiques dénoncées : images-chocs. Même si Bernard Paillard prévient dès l'abord que voilà le livre d'un homme faisant profession de sociologue, et non d'un sociologue à l'abri de la bannière de sa discipline, pourquoi aussi ce titre, &laqno; Carnets d'un sociologue » ?
L'ÉPIDÉMIE ; carnets d'un sociologue ; Bernard Paillard ; éd. Stock.
Sylvie DUGEAY
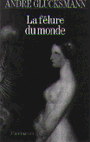
André Glucksmann aborde le thème de la responsabilité individuelle et collective face au sida, au cours de ces dix dernières années. Projet ambitieux qui n'effraie pas, loin s'en faut, notre cher philosophe.
Après un éloge très curieux du préservatif et de son obligatoire utilisation, André Glucksmann rappelle les circonstances du scandale dit du sang contaminé et pose la question de cette responsabilité que chacun fuit : responsabilité des décisions prises, des erreurs commises, du silence, du non-dit. Tout le monde est désigné : médecins, chercheurs, politiques. André Glucksmann oublie cependant de se citer dans cette longue liste. En effet, son coup de gueule semble un peu tardif.
Puis l'auteur nous entraîne dans une longue remontée du temps, cherchant, chez Pasteur mais surtout chez Hippocrate, les explications qui nous manquent. La santé coûte que coûte face à la mort. Tout le monde est cité à la barre des témoins : Aristote, Cyril Collard, Platon, Freud, Duras, Malraux : ils sont tous là.
Le livre de Glucksmann soulève nombre de questions mais apporte peu de réponses. Tout d'abord, ce livre est semble-t-il écrit sous le coup d'une émotion certaine. Le sida s'est approché de Glucksmann récemment, c'est incontestable. Le sida devient plus brûlant. Les mots pour le décrire qu'emploie l'auteur sont significatifs : &laqno; peste rampante, froide, fléau infini ».
D'emblée Glucksmann se présente : &laqno; Je ne suis ni biologiste, ni médecin, ni, pour l'instant, autant que je sache, emporté par le fléau ». &laqno; Pour l'instant » : expression curieuse, surprenante. André Glucksmann nous décrit minutieusement les multiples avantages du préservatif et pourtant ne semble pas y croire lui-même. Le doute est là, en permanence.
&laqno; Pour l'instant » : aveu troublant, désir morbide ? André Glucksmann se dévoile dans cette expression. Il attend, il redoute, il craint, il désire ?
Écrire sur le sida, c'est intégrer une famille, la famille du sida qui réunit tant de monde. Pour qui ? Pourquoi André Glucksmann a-t-il écrit ce livre ? Quand on décide de s'exprimer sur le sujet, on s'engage sans limite. André Glucksmann se protège derrière son statut de philosophe, propose le langage de ses pairs.
Le trouble demeure cependant. L'obsession, presque, à ne vouloir parler que de sida, oubliant la séropositivité, assimilant sida et mort, sida et peste, sida et cancer : &laqno; La peste n'accorde pas de délai, le cancer ne menace pas la vie d'autrui ». Voilà avec le sida un fléau majeur, inégalé. Suprême consécration : &laqno; le sida réitére l'éclair d'Hiroshima ».
Livre troublant, plus pour son auteur que pour le sujet traité. Prendre date en quelque sorte pour l'avenir.
La fêlure du monde ; André Glucksmann ; Éd. Flammarion ; 120 F.
Yvon LEMOUX
Ce guide des médicaments utilisés au cours de l'infection à VIH a été réalisé par deux pharmaciens hospitaliers, ayant l'expérience de ces traitements : Agnès Certain (Bichat-Claude-Bernard), collaboratrice régulière de Remaides, et Sabine Guessant-Flambard (Rothschild). S'efforçant d'être aussi clair et pratique que possible, cet ouvrage s'adresse à la fois aux soignants (infirmières, pharmaciens, médecinsä) et aux personnes touchées par le VIH, ainsi qu'à leurs proches. Précisons cependant qu'il faut posséder quelques notions médicales et thérapeutiques pour pouvoir utiliser ce guide. Notions qu'on peut aisément acquérir en lisant Remaides !
Le premier chapitre de l'ouvrage aborde un à un les médicaments (antiviraux et de traitement des infections opportunistes), sous forme de tableaux : noms commerciaux, obtention, dosages, précautionsä Le second chapitre traite des effets indésirables cliniques et biologiques, symptôme par symptôme (on peut par exemple y lire la liste des médicaments pouvant entraîner des neuropathies). Le troisième chapitre concerne la vie quotidienne : comment prendre les médicaments, en fonction des repas ; diététique ; assistance nutritionnelle ; médicaments et grossesseä Le quatrième chapitre aborde la prise en charge de quelques symptômes spécifiques : douleur ; diarrhéeä Enfin, le dernier chapitre synthétise les textes législatifs et réglementaires. L'ouvrage &laqno; Médicaments et sida » est disponible dans les librairies médicales et auprès de l'éditeur.
Médicaments et Sida ; A. Certain et S. Guessant-Flambard
Editions Arnette (Tél. : (1) 44 86 07 69). Prix : 175 F (plus port).
Lors du décès d'une personne, ses proches, éprouvés par le deuil, doivent cependant faire face à de nombreuses démarches pour l'organisation des obsèques. On peut faire appel à une société de pompes funèbres, qui se charge de tout. On peut aussi effectuer soi-même certaines démarches, ce qui est moins coûteux (cela prend un jour ou deux). Voici quelques points de repère.
Décider de ses obsèques
Si l'on a des souhaits concernant ses funérailles (religieuses ou non, incinération ou enterrement), il est vivement conseillé de les écrire (de sa main : ne pas les dactylographier) et de les signer. On choisira une ou deux personnes chargées de les mettre en ¶uvre. On indiquera leur nom sur ce document, et on le leur remettra. (On peut aussi faire rédiger cet acte par un notaire).
Ces volontés devront être respectées (loi sur la liberté des funérailles). Mais il faut qu'elles soient connues dans les 48 heures qui suivent le décès (alors que le testament, lui, n'est en général ouvert qu'après les obsèques).
Il est aussi possible de choisir ses obsèques, en les payant d'avance à une société de pompes funèbres.
En l'absence de document écrit, c'est généralement la famille de la personne décédée qui décide de l'organisation des funérailles (s'il y a conflit, la voix du concubin ou de l'ami risque de ne pas être écoutéeä).
Si l'on est hospitalisé, et qu'on refuse l'autopsie (étude du corps, après le décès), il faut le signaler à la surveillante du service, qui l'indiquera dans le registre prévu à cet effet. La même précaution est utile si l'on veut être incinéré.
Enfin, après comme avant le décès, les médecins restent tenus au secret professionnel.
Décès au domicile
Lorsqu'une personne décède à son domicile (ou chez des proches), il faut faire constater le décès par un médecin. Dans les petites communes, on peut généralement faire appel au médecin de son choix. Dans certaines grandes villes, notamment à Paris, il faut téléphoner à la mairie d'arrondissement, qui enverra (gratuitement) un médecin d'état civil. Ces mairies sont ouvertes de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, et le samedi matin. Le samedi après-midi et le dimanche, on appelera la mairie du 4ème (Tél. : 42 74 20 04 ou 42 78 18 15). À Paris, en cas de décès la nuit, on doit attendre le lendemain matin. Il est déconseillé d'appeler les pompiers ou la police !
Afin de favoriser la conservation du corps, maintenir la pièce dans la fraîcheur et l'obscurité et éviter les courants d'air. On peut faire appel à une société de pompes funèbres, qui viendra entourer le corps de carboglace. Lorsque le médecin aura établi le certificat de décès, on pourra effectuer la toilette de la personne décédée ou la faire faire par une société de pompes funèbres. Il s'agit d'une simple toilette, à l'eau et au savon. Il faut mettre du coton dans l'anus, pour éviter les &laqno; fuites ». Les sociétés de pompes funèbres disposent aussi une housse sous le corps. Ensuite, on habille le défunt.
Décès à l'hôpital
Si l'on veut que la personne revienne à son domicile, il faut en avertir la surveillante du service dans les minutes qui suivent le décès. Elle organisera un &laqno; transport in extremis » : la personne sera conduite chez elle (ou chez ses proches) en ambulance. Demander une prescription médicale, pour le remboursement. On procèdera ensuite comme si ce décès avait eu lieu au domicile.
Dans les autres cas, l'hôpital établit le certificat de décès et doit avertir les proches. Généralement, le corps est conservé dans une chambre réfrigérée (&laqno; morgue »). La famille peut être appelée pour le reconnaître.
Le directeur de l'hôpital peut décider du transport du corps dans un funerarium (une simple pièce, où les proches peuvent rendre visite au défunt). Dans ce cas, c'est l'hôpital qui doit payer les frais dus à ce transport.
Enfin, les proches gardent toujours le choix de la société de pompes funèbres. Mais certains hôpitaux s'arrogent le droit de placer le corps des personnes décédées du sida dans un cercueil ordinaire (non adapté à l'incinération) et de le fermer immédiatement. Ou, parfois, simplement dans une housse. Dans les deux cas, les proches ne peuvent pas voir le défunt. Pour éviter une telle situation, il faut en parler avant le décès, avec la surveillante du service.
Certificat et acte de décès
Le certificat de décès, établi par le médecin, atteste qu'il n'y a pas de problème médico-légal (meurtreä). Dans le cas du sida, il indiquera aussi qu'il s'agit d'une &laqno; maladie contagieuse » (alors que, médicalement, c'est inexact !). Cette mention interdit les soins de conservation. Pratiqués par des entreprises spécialisées, ils permettent de conserver le corps plus longtemps et lui évitent de devenir rigide (ce qui advient au bout de 5 heures environ). Si l'on veut que le corps parte à l'étranger, mieux vaut demander au médecin de ne pas cocher la case &laqno; maladie contagieuse ».
Que le décès ait lieu au domicile ou à l'hôpital, il faut ensuite qu'un proche du défunt se rende à la mairie, muni du certificat de décès et de différents documents (téléphoner à la mairie avant). Celle-ci établira un acte de décès (on en demandera 10 ou 15 copies, pour prévenir différents organismes) et une autorisation de crémation ou d'inhumation.
Enterrement (= inhumation)
Il faut l'autorisation de la mairie du lieu d'inhumation (à Paris, on s'adressera directement au cimetière). Cette autorisation doit systématiquement être accordée aux personnes décédées dans la commune, à celles qui y habitaient, ou à celles qui y ont une sépulture familiale. Dans les autres cas, il faut demander l'accord du maire du lieu où la personne souhaitait être enterrée.
La plupart des inhumations des personnes décédées à Paris ont en fait lieu dans les cimetières de Pantin ou de Thiais. Etre enterré dans Paris intra-muros est plus difficile (certains cimetières n'ont plus de place) et plus coûteux.
La &laqno; concession » désigne la location du terrain correspondant à la tombe. On peut en choisir la durée. Lorsque celle-ci est écoulée, la famille ou les proches peuvent décider de la renouveler ou non. En revanche, l'enterrement en &laqno; tranchée commune » est gratuit. Rien à voir avec une &laqno; fosse commune » : dans cette tranchée, chaque personne est enterrée dans son cercueil, à distance des autres. Dans certains cimetières, on peut déposer des fleurs, mettre une plaque, comme sur une tombe &laqno; ordinaire ». Les proches gardent la possibilité de faire ensuite exhumer (sortir de terre) le cercueil (après un délai d'un an et avant cinq ans), pour le faire enterrer ailleurs. Enfin, dans la plupart des cimetières, l'aménagement de la sépulture (pierre tombale ou non, symboles religieux ou nonä) est laissée à la liberté de la famille et des amis du défunt. À condition de ne pas perturber &laqno; l'ordre public ».
Crémation
Pour que le corps soit incinéré, il faut que la personne en ait clairement manifesté le souhait. Le corps sera placé dans un cercueil prévu pour cela. Lors de l'incinération, il sera glissé dans un four. Cela dure environ 1h30. Les cendres sont ensuite placées dans une urne, remise à la famille ou aux proches. L'urne peut être déposée dans un cimetière (colombarium) (avec paiement d'une concession) ou conservée chez un proche du défunt. Les cendres peuvent aussi être dispersées (en pleine nature ou dans le &laqno; jardin du souvenir » de certains cimetières). Il est seulement interdit de les répandre dans un lieu public. En France, le transport des urnes funéraires est libre. Si l'on souhaite qu'elle parte à l'étranger, on dira au crématorium de sceller l'urne. On demandera ensuite à la Préfecture de Police un document permettant le transport de l'urne à l'étranger.
La Fédération française de crémation (Tél : (1) 45 26 33 07) fournit les adresses de tous les crématoriums de France.
Cercueil et transport du corps
Le corps doit être placé dans un cercueil avant d'être transporté. Cela doit être effectué par une société de pompes funébres agréée par la commune. Les prix varient beaucoup d'une entreprise à l'autre.
Dans certaines communes, ce sont des entreprises privées qui prennent en charge la totalité des obsèques. À Paris (et dans d'autres grandes villes), les Pompes Funèbres Municipales fournissent le cercueil, le corbillard et le personnel qui effectue le transport. Les prix de ces prestations sont fixés par la mairie. Si l'on fait appel à une entreprise privée (Pompes Funèbres Générales, par exemple), elle sous-traitera les services indiqués ci-dessus aux Pompes Funèbres Municipales et proposera des prestations supplémentaires.
La société de pompes funèbres apporte le cercueil et y place le corps. Elle reviendra, pour la fermeture du cercueil. Il faudra à ce moment-là qu'un agent de police soit présent.
Lorsque les funérailles n'ont pas lieu dans la même commune que le décès, il faut demander l'autorisation des deux mairies. On peut choisir une société de pompes funèbres de l'une ou l'autre des communes. Les contraintes à respecter (cercueil hermétiqueä) et les prix dépendent de la distance à parcourir.
Lorsque le corps doit changer de pays, c'est souvent coûteux et compliqué. Et parfois impossible lorsque le certificat de décès mentionne &laqno; maladie contagieuse ». On se renseignera auprès de l'Ambassade du pays, de la Préfecture de Police, de la compagnie aérienne. On peut aussi faire appel aux Pompes Funèbres Générales, spécialisées dans l'organisation de ces transports.
Dans tous les cas, si une crémation est prévue, il est plus simple et moins coûteux de l'effectuer dans le pays de décès et de transporter l'urne ensuite.
Signalons que, si le décès a lieu lors d'un voyage, la personne est souvent couverte par une assurance-rapatriement sanitaire (parfois comprise dans le prix du billet d'avion).
Comment payer les obsèques
Le compte bancaire du défunt est souvent bloqué (même s'il y a procuration), dès que la banque est informée du décès. Mais la plupart des banques acceptent de payer les factures relatives aux obsèques (jusqu'à 15 ou 20 000 F, s'ils sont disponibles sur le compte). Les comptes-joints, eux, ne sont pas bloqués.
Plusieurs organismes peuvent verser un capital-décès. Les assurances-vies (et, souvent, les mutuelles) le payeront à la personne désignée sur le contrat. En revanche, la Sécurité sociale, l'Assedic, l'assurance complémentaire des cadres ne le versent qu'à certaines personnes (ayants-droitsä). On se renseignera auprès d'un(e) assistant(e) social(e).
Toute commune a l'obligation d'enterrer gratuitement les &laqno; personnes dépourvues de ressources suffisantes ». En un tel cas, il est conseillé aux proches de consulter un(e) assistant(e) social(e), avant même d'appeler une société de pompes funèbres (ou, en tous cas, avant de signer un contrat). À Paris, lorsque le défunt était connu du Bureau d'Aide Sociale (personnes percevant le RMI ou l'AAHä), il aura droit au &laqno; convoi social » (voir encadré). Enfin, les fonds d'action sociale des mairies, des caisses de Sécurité sociale et des mutuelles apportent une aide dans certains cas.
Thierry PRESTEL
Avec les conseillers sociaux et le groupe juridique de AIDES
- Décès à domicile : appeler la mairie (en ville) ou un médecin (à la campagne), pour le certificat de décès. À la mairie, demander la liste des entreprises de pompes funèbres
- Décès à l'hôpital : rappeler aux soignants les dernières volontés de la personne (refus d'autopsie ? Retour à domicile ? Incinération ?).
- Si on a des difficultés financières, contacter un(e) assistant(e) social(e).
- Si on veut qu'une société de pompes funèbres se charge des démarches, l'appeler.
- Sinon : aller à la mairie, pour l'acte de décès et l'autorisation de crémation ou d'inhumation.
- Pour une cérémonie religieuse, voir le représentant du culte-
- Si le corps doit être transporté dans une autre commune, demander les autorisations (mairies ou préfecture de Police).
- Contacter une société de pompes funèbres (privées ou municipales).
- Aller au commissariat, avec le certificat de décès (un policier doit être présent à la fermeture du cercueil).
- Organiser la cérémonie
- Prévenir les proches et la famille (tout imprimeur peut réaliser des faire-part).
- Dans les jours qui suivent : prévenir, avec copie de l'acte de décès : employeur ou Assedic, banques, Sécurité sociale (après remboursement des frais en cours), Allocations Familiales, Impôts, EDF, Compagnie des Eaux, propriétaire etc.
- Voir un notaire, si la succession est importante ou complexe.
Tarifs fixés par la Mairie de Paris
* Convoi (cercueil + corbillard + porteurs + taxes) : à partir de 3 000 F
* Convoi social (comme ci-dessus, pour personnes avec faibles ressources) : 796 F
* Concession de 10 ans aux cimetières de Pantin ou de Thiais : 1 700 à 2 000 F
* Enterrement en tranchée commune : gratuit.
Tarifs d'entreprises privées
* Crémation et urne (au Père Lachaise) : à partir de 3 000 F
* Organisation complète des funérailles : (démarches, cercueil, convoi, organisationä) : 4 000 à 5 500 F
* Démarches administratives seules : 1 200 à 2 000 F
* Toilette du défunt : 300 à 600 F
* Pose de carboglace : 300 à 600 F
* Impression de faire-part : 200 à 500 F
* Cérémonie religieuse : 500 à 3 000 F (en cas de difficultés financières, en parler au représentant du culte)
À Paris, un enterrement en sépulture individuelle coûte donc au moins 5 000 F (sauf cas du convoi social), et une crémation, au moins 6 000 F. Si l'on veut des services plus élaborés (cercueil en chêne ; décorations ; concession de plus longue duréeä), les prix montent assez vite. En moyenne, en France, le coût d'un enterrement serait de 15 à 20 000 F.
Pour toute la France :
* Revue : Le Particulier (N° spécial &laqno; Le décès ». Novembre 93). Tél. : (1) 40 20 70 00.
* Le Journal du sida (fiches sociales : Décès ; le capital-décès ; les démarches après les obsèques) : Tél. (1) 49 70 85 90.
* Sida-info-droits : Tél. 36 63 66 36 (mardi 17h-22h ; 0,73 F l'appel)
* Pompes funèbres générales : Tél. 05 11 10 10 (appel gratuit, 24h/24. Informations sur les prestations et les tarifs, sans engagement).
Roc'Eclerc (Michel Leclerc) : Tél. 05 40 08 00 (appel gratuit, 24h/24).
Pour Paris :
* Pompes funèbres municipales : Tél. (1) 40 34 33 15. (9h-11h30 et 14h-16h30, lundi au vendredi).
* Crematorium du Père Lachaise : Tél. (1) 46 36 36 35.
* Brochure gratuite : Les obsèques à Paris (dans les mairies d'arrondissement ou sur Minitel : 36 15 Paris).
Depuis début juillet, ces compléments sont remboursés aux personnes atteintes de SIDA, ayant subi une perte de poids supérieure à 5 % de leur poids normal. Ils doivent être prescrits par un médecin, sur l'ordonnance bi-zone réservée aux personnes prises en charge à 100 %. Le nombre de compléments à prendre par jour dépend de votre état.
Ce tableau devrait vous permettre un choix optimal : type de complément, goût, texture, prix. Toutes les données y sont indiquées par unité (par pot, brickä), bien que certains produits soient vendues par 2 ou 4. N'oubliez pas que c'est généralement de protéines dont votre organisme a le plus besoin. La pression des associations sur le Ministère de la Santé aura permis d'aboutir au remboursement de ces produits. Cependant, seul Renutryl est remboursé comme un médicament (à 100 %, pour les personnes qui ont le 100 % Sécurité sociale). Les autres compléments de ce tableau sont remboursés sur la base d'un forfait. Mais le prix de vente conseillé (par le laboratoire), figurant dans le tableau, est purement indicatif : les tarifs réels varient d'une pharmacie à l'autre. L'écart entre prix de vente et forfait remboursé reste aux frais du patient (mais certaines mutuelles le prennent en charge). Choisissez bien votre pharmacie ! Et n'hésitez pas à signaler au plus proche comité de l'association AIDES celles qui abuseraient de la situation, tant au niveau des prix pratiqués que de la quantité minimale de produits à acheter.
Alain PUJOL
Voici la suite du témoignage intitulé &laqno; à la poursuite du 3TC », que nous vous avions présenté dans le précédent numéro.
Mercredi 16 mars, j'avale mon premier comprimé dosé à 300 mg de 3TC. Première contrainte : j'ai dû élaborer un planning horaire pour fixer les douze heures séparant les deux prises. Ce sera 8h - 20h.
Jeudi 17 mars, j'assure 7 heures de cours. Est-ce mon anxiété à prendre ce nouveau traitement, le printemps précoce qui travaille les adolescents, je trouve mes classes agitées et je quitte le collège à 17h20, abruti par la journée et un comprimé de Lexomil.
Vendredi 18 mars : la veille, j'ai relu pour la nième fois les trois pages du protocole surtout la rubrique : Risques et inconforts où je m'attarde sur &laqno; fatigue, céphalées, nausées... et agitation ». Je me sens électrique et à huit heures, je prends ma première classe, la pire des 4èmes du collège. Ils mettent dix minutes à sortir leurs matériels et quand je les interroge, je découvre qu'à l'exception de trois élèves, les vingt-cinq autres n'ont pas fait leur travail or leur contrôle est pour le lundi suivant. Je suis très calme d'apparence quand une &laqno; monstresse » me lance : &laqno; Qu'est-ce que vous croyez ? On n'a pas que votre travail à faire ! ». Je la regarde perplexe. Je n'ai aucune réponse. Je vois l'hôpital, les bilans mensuels, la mort et je réalise que je me tue d'une certaine façon à faire comme si tout allait bien pour tant d'ingratitude. Je prends mon matériel, lequel réintègre mon cartable, je fais appel au surveillant à qui je confie la classe et je les quitte. Je m'explique avec l'administration sans révéler que depuis mercredi une substance nouvelle me fouette le sang, la classe est sermonnée (sic) et je dicte dans le silence le corrigé des exercices. Heureusement il ne me reste plus que trois heures à assumer. J'avale ma roue de secours (Lexomil) et je plane au-dessus de ma 6ème puis je rentre pour dormir toute l'après-midi, lessivé.
Le week-end fut une sorte de cure de sommeil. Retranché sous ma couette, j'ai visionné distraitement des vidéos entre deux sommes. Le lundi j'avais bon pied bon ¶il, mon angoisse était surmontée.
Deux semaines plus tard, premier bilan. De 0 T4 j'en crée 12 mais l'antigènémie est à 32. Le mois suivant j'en conserve 9 mais l'antigènémie est à 16 et j'ai pris 1 kgä Troisième mois, tout est stable et un autre kilo supplémentaire. Quatrième mois, résultats identiques et je suis en passe de devenir grassouillet si j'attrape un kilo par mois ! Évidemment ces résultats interfèrent sur mon comportement. Depuis un an, j'avais délaissé toute sexualité, absence de désir, l'épée de Damoclés de la séropositivité transformant mes amours en veuf potentiel. Retrouvant figure humaine, j'ai regardé à nouveau les autres et je me suis rendu compte qu'on me regardait. S'en est suivi une sarabande d'amants, tel un moine défroqué, il me fallait trouver toujours plus de sensations tout en connaissant les risques et en les préservant comme moi-même. À ce jour, 27 juillet, tout semble aller bien, mes amants sont en vacances, ce qui me permet de souffler et j'envisage de me stabiliser à la rentrée plutôt que de me disperser.
J-F
J'ai commencé à prendre de l'AZT en octobre 1989. Traitement auquel se sont rajoutés peu à peu, en fonction de l'aggravation biologique et clinique de l'infection et de l'état d'avancement de la recherche, d'autres antiviraux et une série de médicaments prophylactiques destinés à prévenir l'apparition de maladies opportunistes. Graduellement, j'ai pris de plus en plus de molécules et, depuis plus d'un an, j'avale environ entre 30 et 35 cachets par jour, sans oublier différentes injections et une série de médicaments homéopathiques.
À la même époque est apparu un début d'hépatite médicamenteuse, avec des transaminases deux ou trois fois supérieures aux normes. On peut dire que c'est une réaction normale du foie, dans la mesure où c'est lui qui, avec les reins, est chargé d'éliminer les toxines et, &laqno; God damned », ce que les médicaments peuvent être toxiques !
Le problème était apparemment sans issue, puisque tout nouveau médicament ne pouvait qu'aggraver cette hépatite et de toute façon, il n'existe pas de médicaments pour cette indication. J'ai très mal vécu cette nouvelle pathologie, qui impliquait de suivre un régime alimentaire léger, de ne pas boire d'alcool etc.
En février 1994, je décidais d'agir et d'essayer un type de médecine qui soigne sans médicaments. Je suis allé voir un acupuncteur, lui ai expliqué mes différents problèmes et nous avons essayé de les régler. En sus, j'ai pris un &laqno; drainer » du foie conseillé par mon homéopathe. Le résultat a été assez rapide puisqu'au mois de mai, avec une seule séance par semaine, mes transaminases étaient redevenues normales et le sont encore à ce jour. De plus, je me sens beaucoup moins fatigué. Dans la mesure où mon traitement s'est plutôt alourdi depuis le mois de février, je ne vois d'autre explication à ce retour à la normale que la séance hebdomadaire d'acupuncture et le &laqno; drainer » du foie.
Yann
NDLR : Précision : l'auteur de ce témoignage a continué à suivre son traitement allopathique et y a ajouté un traitement par homéopahie et acupuncture. Il n'a pas remplacé le premier par le second.
Si vous avez été atteint d'une hépatite médicamenteuse, nous sommes intéressés par votre témoignage, pour un prochain numéro de REMAIDES.
Le texte suivant est une lettre adressée à Alain Cordier, directeur général de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) par une personne malade du sida, qui nous en a envoyé copie.
Monsieur le directeur,
Je me permets de vous déranger pour vous faire part de mon mécontentement concernant l'AP que vous dirigez. L'HAD (hospitalisation à domicile NDLR) est une vieille dame maintenant qui aurait dû prendre sa vitesse de croisière, si elle avait su ou voulu écouter les bêtes en pâture que nous sommes nous malades, de toutes sortes. Or ce n'est pas le cas ! Hélas.
J'essaierai de ne vous formuler que des critiques concrètes, c'est à dire du vécu. J'étais hier en hôpital de jour à La Salpétrière, convoqué pour une visite avec un neurologue pour des problèmes consécutifs à une rétinite à CMV. Convoqué à 9h30, les ambulances ne sont venues me chercher qu'à 9h30 voire 45.
Sur les ambulances : Pourquoi tous ces ambulanciers ne sont pas capables d'assumer leur contrat avec une certaine régularité, ils acceptent le marché annuel ou pas mais ce ne sont pas les clients qui ont à subir leur retard ou leur nervosité de conduite. Pourquoi certaines ambulances nous transportent comme des b¶ufs en danger immédiat avec musique de leur choix très forte ? Pourquoi faut-il attendre jusqu'à 2h un retour à son domicile ? Mauvaise programmation.
J'ai donc vu le neurologue, charmant d'ailleurs, vers 12h45 - 13h. J'ai donc attendu tout ce temps sans rien faire ni pouvoir m'allonger car tous les lits étaient pris. J'ai signalé que j'avais tous les mardis mes prises de sang mais on n'a pas voulu me les faire car c'est du boulot de l'HAD, m'a-t-on répondu. En définitive, on m'a prélevé dans le bras, alors que je suis porteur d'un Port-a-cath, l'infirmière ne voulant pas piquer mon aiguille de Huber (car il fallait hépariner ensuite). Je m'héparine et me rince tous les jours, seul, il y en a pour 2 minutes ! De plus j'avais amené ma perfusion de Cymévan qu'on n'a pas voulu me faire sous prétexte que j'étais en HAD. Et alors je suis resté 4 heures sans rien faire.
Confort du malade : Y pense-t-on ? Je n'aurais pas été mieux chez moi vers 15 heures, plutôt que de retour à 18h pour être perfusé à 19h30 !
Les malades comme nous HIV+ doivent avoir une qualité de vie intense voire supérieure car nous savons que nos jours sont comptés ! Et que tout peut arriver du jour au lendemain. Pourquoi piquer dans les veines avec douleur si on peut éviter ? À quoi sert un Port-a-Cath dans ces conditions ?
Voila Monsieur le Directeur ce que je voulais que vous sachiez. Les malades de plus en plus nombreux en HAD souffrent du manque de personnel et de leur horaire fantaisiste. Aucune régularité dans les passages, là aussi, quel confort pour le malade lorsqu'on passe sa matinée à attendre pour 1/2h de perfusion ?
J'ai feuilleté quelques exemplaires de votre journal, je le trouve très médicalisé. À aucun moment n'apparaît le rôle important du facteur psychologique dans le développement de la maladie, ni d'une remise en question de l'hygiène de vie : alimentation saine, régulièreä
Ces deux facteurs sont primordiaux dans le processus d'évolution. Dans tous les discours entendus à la TV, radio, journaux, je n'entends qu'une campagne préservatif, qu'une quête pour la recherche, et le reste ? Et que de mort.
Et la vie ? Ne pouvez-vous pas changer de langage et adresser des messages d'espoir ? Car des séropositifs qui se portent bien, il en existe. Ils se sont pris en main et ils ont refusé d'avoir déjà un pied dans la tombe. Et tout ce qui est dit aujourd'hui accompagne les autres à mettre le deuxième pied.
Moi je dis NON. Et j'encourage ma s¶ur qui souffre de ce mal, mais souffre aussi qu'aucune médecine ne l'encourage à vivre, puisque cette maladie est fatale. La Société a le Sida. Oui. Elle entraîne l'humanité à sa perte. Il est temps de réagir.
Catherine
Je vous trouve un peu sévère avec REMAIDES qui a été créé par trois séropositifs : Philippe BEISO, Richard DAVID (tous deux décédés depuis) et moi-même.
Ne trouvez-vous pas qu'il s'agissait déjà d'un bel exemple de refus de l'adversité ? Nous avons voulu cette lettre d'informations médicales (car il s'agit bien de la mission première de REMAIDES) accessible au plus grand nombre de lecteurs.
Expliquer encore et toujours l'infection à VIH n'est pas chose facile. Les médecins ou spécialistes qui écrivent dans REMAIDES apportent leur compétence professionnelle. Les personnes qui témoignent apportent leur vécu. Témoigner sur sa maladie c'est important pour le malade, pour ses proches, pour nous tous.
Je vous invite à relire les numéros précédents qui traitaient des répercussions d'ordre psychologique de la séropositivité, de l'importance de la nutrition, des loisirs, de la vie tout simplement.
Je comprends votre critique car c'est notre souci permanent : rester un lien de force, de solidarité en faisant participer les personnes concernées par l'infection à VIH au débat sur le SIDA.
Mais n'oubliez jamais qu'il faut rester objectif, réaliste et déterminé pour se battre.
Yvon LEMOUX
Vous souhaitez nous écrire et faire part de vos commentaires. N'hésitez pas.
Vous pouvez, si vous le souhaitez recevoir REMAIDES chez vous. Pour cela il suffit de nous écrire à :
AIDES
REMAIDES
247, rue de Belleville
75 019 PARIS
Directeur de la publication :
Pierre LASCOUMES
Comité rédactionnel :
Agnès CERTAIN
Philippe DEMARE
René FROIDEVAUX
Daniel GOSSET
Stéphane KORSIA
Yvon LEMOUX
Gilles MONOD
Bernard NICOUD
Thierry PRESTEL
Alain PUJOL
Emmanuel TRÉNADO
À la mémoire des membres du comité rédactionnel morts du sida :
Philippe BEISO, Richard DAVID, Christian MARTIN
Coordinateur :
Thierry PRESTEL
Maquette et mise en page :
Alain MACÉ
Emmanuel TRÉNADO
Remerciements à :
KROMOSCAN (pour la photogravure de couverture), et Philippe FERNANDEZ pour les illustrations intérieures.
REMAIDES est édité à 12 000 exemplaires et diffusé gratuitement par l'association AIDES, Paris et Ile-de-France 247 rue de Belleville 75019 Paris. Tél. : 44 52 00 00, Télécopie : 44 52 02 01.
REMAIDES, Tél. : 44 52 33 79. Minitel : 36 15 AIDES.
Les informations contenues dans REMAIDES peuvent être reproduites, sous réserve de mention de la source. Impression : IMPRIMAINE 72650 La Chapelle St Aubin.
SIDA INFO SERVICE répond par téléphone à toutes les questions concernant l'infection à VIH et le sida. Numéro vert (appel gratuit) : 05 36 66 36 (24h/24).
SIDA INFO DROIT répond par téléphone à vos questions juridiques concernant la séropositivité et le sida (droit du travail, assurances, successionä). Numéro de téléphone azur (0,73 F. l'appel) : 36 63 66 36, uniquement le mardi, de 17h à 22h.
ISSN : 11620544