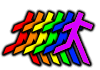
Rapport d'activités 2001
septembre 2000 -août 2001
L'association |
La marche |
Documents |
Événements |
Presse
Le Conseil | La Commission politique | La Commission inter-associative | Statuts | Agenda
1. Présentation de l'association
1.1 L'association
Créée en septembre 1999, la Lesbian & Gay Pride Ile-de-France (lgp-îdf) participe d'un mouvement associatif qui inscrit depuis 30 ans la question de l'orientation sexuelle sur la place publique, par le biais de manifestations revendicatives à caractère festif, qui portent depuis 1995 le nom de "Marche de la Lesbian & Gay Pride".
La lgp-îdf a été constituée, après la dissolution de la Lesbian & Gay Pride (1991-1999), par une trentaine d'associations qui souhaitaient garantir une organisation de la Marche qui soit collective et associative.
La Marche est un moyen et non une fin ; elle doit renforcer la visibilité des gais, des lesbiennes, des bis, des trans et de leurs proches dans la société, afin de lutter contre la discrimination fondée sur les mœurs ou l'orientation sexuelle.
Son but : lutter contre ces discriminations, dans le cadre de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales : en organisant une Marche et d'autres interventions publiques ; en participant au dialogue politique et social ; en soutenant des projets inter-associatifs ; en favorisant à la fois la visibilité des associations et l'émergence d'une stratégie collective.
Par le succès croissant de la Marche et l'importance qu'elle revêt dans la société, par la participation régulière des associations à ses travaux, la lgp-îdf est devenue une force de proposition et un pôle de concertation et de médiation essentiel du mouvement homosexuel français.
1.2. Organisation
L'instance prépondérante est le Conseil, formé seulement de personnes morales. Son rôle est de discuter et décider des grandes orientations de l'association. C'est aussi un lieu public de rencontre et d'échanges pour ses membres, et un lieu de mise en commun de moyens et d'élaboration de stratégies collectives. Le Conseil élit son porte-parole, lequel est de droit président de l'association.
Deux commissions sont constituées au sein du Conseil : la commission politique et la commission inter associative, chacune désignant ses secrétaires. La commission politique a pour objet d'élaborer une stratégie commune, de produire les documents et de participer au dialogue politique et social. La commission inter-associative a pour objet d'élaborer et de mettre en œuvre des projets communs visant à accentuer la solidarité entre les associations et leur visibilité.
Le fonctionnement du Conseil et la mise en œuvre de ses décisions sont assurés par des personnes physiques, qui sont les membres de la lgp-îdf. Celles-ci élisent parmi elles des administrateurs-trices, formant, avec le porte-parole et les secrétaires des commissions, le conseil d'administration, qui est chargé d'appliquer les orientations du Conseil. La gestion quotidienne de l'association est assurée par son bureau, formé au sein du conseil d'administration.
Le Conseil, chacune des commissions, le conseil d'administration et le bureau se réunissent tous au moins une fois par mois. En règle générale, le Conseil se réunissait à l'AGECA, les autres réunions étaient accueillies par Contact. L'ensemble de ces instances mobilise actuellement près d'une centaine de personnes physiques ; le Conseil a 48 membres, chacun pouvant être représenté par plusieurs personnes physiques ; le conseil d'administration a 11 membres. Les bénévoles, appelés à certaines occasions, forment une centaine de personnes.
En octobre 2000, la lgp-îdf a installé son siège social au Centre Gai et Lesbien.
2. Rapport moral du conseil d'administration
2.1 Principales actions
Les trois actions les plus importantes de l'exercice 2000-2001 ont été : une Conférence, un Salon des associations et la Marche. La Conférence, consacrée à la discrimination, a réuni au Palais du Luxembourg des élus, des militants et des experts, et a été l'occasion d'annonces importantes de la part du gouvernement et des élus. Le Salon, dont c'était la deuxième édition et qui a rassemblé environ 80 associations et accueilli 1500 visiteurs à l'Espace Voltaire, a permis à la fois d'augmenter la visibilité des associations et de favoriser les échanges entre elles. Ces deux premiers événements formaient le "Printemps des Assoces", les 6 et 7 avril. La Marche, le 23 juin, avait pour mot d'ordre "Hétéros, homos, tous ensemble contre les discriminations / parentalité, séjour, travail, couple". Ce mot d'ordre, mobilisateur et largement repris par la presse, a reçu de nombreux soutiens politiques, syndicaux et associatifs. Pour la première fois, le Maire de Paris marchait derrière la banderole de tête, avec des personnalités politiques et associatives de premier plan. Malgré une certaine défection des établissements commerciaux, la Marche a connu son record de participation.
Parmi les autres actions ou interventions publiques, citons : notre audition par la commission d'information parlementaire sur le pacs, l'interrogation des candidats aux élections municipales et cantonales, la journée nationale du souvenir de la déportation, des débats communs avec le Centre Gai et Lesbien, trois thés dansants, plusieurs réunions à la Mairie de Paris et dans les ministères et des entretiens avec la presse. Tout cela témoigne d'une activité sur l'ensemble de l'année.
2.2 Réalisation des objectifs
Pour sa deuxième année d'existence, la lgp-îdf a porté ses efforts sur sa propre administration, sur le contenu des réunions du Conseil, sur le sens et l'organisation de la Marche et sur la visibilité des associations.
L'association a souhaité renforcer ses capacités d'organisation, en désignant un conseil d'administration 3 fois plus important que celui ayant fonctionné lors de l'exercice précédent et en identifiant des responsabilités : directeur de la Marche, chargée de l'organisation, chargé de la communication, etc.. Le conseil d'administration s'est cependant révélé assez fragile, notamment pour le poste de secrétaire général, qui a été vacant dès le mois de janvier. Cependant, l'organisation de la Conférence et de la Marche a pu être assurée dans de bien meilleures conditions cette année. Une meilleure organisation interne reste un objectif pour le prochain exercice.
Un autre objectif a été d'étendre les réunions du Conseil à de véritables débats qui ont permis un échange d'information plus approfondi et une mise en commun des expériences de ses membres. Ces débats thématiques (sur la mémoire, la santé, la discrimination et la parentalité) ont réuni, outre ses membres, des invités compétents ou des associations non-membres.
Les modalités d'inscription à la Marche ont été revues cette année dans le but de renforcer la signification politique de la Marche et de mieux assurer son organisation, notamment sa sécurité. En avril 2000, le Conseil avait déjà adopté le principe de conditionner les partenariats commerciaux (conclus par la Sofiged pour financer la communication de la Marche) à la signature d'une charte éthique ou au soutien de nos revendications. Ce principe n'a pas été mis en œuvre, ni en 2000, ni en 2001. Cependant, et comme première étape, nous avons demandé aux groupes s'inscrivant à la Marche de soutenir explicitement son mot d'ordre, ce qu'ils ont fait dans leur quasi-totalité. Autre nouveauté de l'édition 2001, nous avons rendu obligatoire une participation de ces groupes aux frais communs (entre 0 et 1200 F), à la fois pour permettre une meilleure organisation et comme signe concret d'engagement. Nous avons également dû demander aux groupes inscrits le paiement des droits d'auteur dont nous sommes redevables à la SACEM en tant qu'organisateur. Enfin, le recrutement de bénévoles et le concours des syndicats et de la LCR aura permis d'assurer un service d'ordre bénévole, ce qui n'avait pas été le cas l'an dernier. L'organisation de la Marche ne bénéficie d'aucun sponsor, mais la Ville de Paris a contribué à son organisation matérielle, en installant un podium.
La visibilité des associations a été renforcée. Outre le site web et le dossier de presse qui présentent les membres du Conseil, la Conférence, le programme et le podium de la Marche, ainsi que les délégations reçues dans les rendez-vous politiques ont permis de mettre en avant les associations, notamment celles les plus proches du mot d'ordre adopté. Enfin, on a pu noter une visibilité accrue des associations sur la Marche, encore plus nombreuses que l'an dernier, avec seulement la moitié du nombre des établissements commerciaux de l’année passée.
Le bilan politique de cette année est assez impressionnant : l'examen de deux lois étendant le dispositif anti-discriminatoire (en droit pénal, droit du travail et droit du logement) à l'orientation sexuelle, d'une loi sur l'autorité parentale qui pourrait mettre terme à certaines discriminations, la prise en compte de la persécution des homosexuels par les nazis, l'établissement d'un dialogue avec la Ville de Paris, la poursuite d'un dialogue avec le gouvernement, et de larges soutiens des partis politiques et des syndicats. Si au niveau parisien, les perspectives sont encourageantes, au niveau national, cette année pré-électorale aura davantage été la conclusion du travail des années antérieures (depuis 1996, pour la discrimination) que la mise en chantier de nouvelles réformes. L'année qui s'ouvre sera donc déterminante.
3. Rapport financier du conseil d'administration
Voir annexe en fin de document.
4. Activités du Conseil
4.1. Composition du Conseil
Le Conseil comptait en fin d'exercice 48 membres, associations mixtes, lesbiennes ou du secteur humanitaire, certaines d'audience nationale, d'autres d'audience locale, et couvrant pratiquement l'ensemble des associations (convivialité, sport, jeunes, étudiants, parents, associations d’entreprises, politiques, sociales, etc. - manque les associations hards) :
3HVP / Amis de Bonneuil / Amnesty International / ANGEL 91 / APGL /ARDHIS / ASB / Beit Haverim / Bénines d'Apie / Bi'cause / CARITIG / CGay / Centre Gai et Lesbien / Cercle du Marais / Clash / CommissionNationale des Homosexualités de la LCR / Commission gais et lesbiennes des Verts / Contact, parents, familles et amis de gais et lesbiennes / Coordination Interpride France / Coordination Lesbienne Nationale /CQFD - Fierté Lesbienne / Degel Jussieu / David & Jonathan / ÉcouteGaie / Fant'Asia / Fédération sportive CGPIF / Le Gage / Gais etLesbiennes Branchés / Gare!, les gays et lesbiennes du rail / Homobus/ Homonormalité / Homosexualités et Socialisme / HomoSorbonne / HomoSweet Home / In&Out HEC / LEFH / Les Gais Musette / Long Yang Club /Lusogay /MAG Jeunes Gais et Lesbiennes / Les Mâles Fêteurs / Mémorial de la Déportation Homosexuelle / Mousse Sciences-Po / Pop'in Gays / Rando's Ile-de-France / Reims Liberté Gaie / Syndicat National des Entreprises Gaies.
4.2. Orientations et thème de la Marche
Le choix du thème de la Marche et du slogan s'est déroulé en plusieurs temps.
Plusieurs thèmes avaient été proposés par la commission politique en décembre lors de la réunion du Conseil du 15 décembre 2001. Celui sur la discrimination c’est imposé, avec différentes déclinaisons dont l'amélioration du pacs, l'accès à la parentalité, la solidarité internationale et la lutte contre les persécutions. Le Conseil avait en plus pris conscience de l'importance de prendre part à la demande de reconnaissance des persécutions nazies contre les homosexuels : sujet qui fera l'objet d'une attention particulière de la commission politique les semaines suivantes.
Le 20 janvier 2001, le Conseil s'est réuni pour voter le slogan de la marche. Un débat aboutit sur un vote clivé duquel émergea le slogan "Hétéros, Homos, tous égaux : parentalité, séjour, travail, couple". Ce slogan a été rediscuté lors du Conseil suivant, et devient, à la suite d'un vote quasi-unanime "Hétéros, Homos, tous ensemble contre les discriminations : parentalité, séjour, travail, couple". Il sera la base de tous les argumentaires.
Les médias auront peu regardé le slogan et auront préféré traiter de façon plus ponctuelle d'un sous-thèmes plutôt que de l'ensemble : l'homophobie au travail et l'accès à la parentalité auront été les vedettes de cette marche pour la presse écrite comme audio-visuelle.
Pour ce qui est des interlocuteurs politiques, les délégations successives qui les ont rencontrés ont plus orienté les discussions en fonction des compétences des interlocuteurs, en ne traitant la plupart du temps qu'un ou deux sujets à la fois. Le slogan en soit pouvait difficilement faire l'objet d'une discussion d'ensemble. Toutefois, l'intérêt de ce slogan aura été d'engager implicitement les personnalités présentes dans le carré de tête de la marche sur une diversité de sujets, en particulier les personnes ayant porté la banderole.
4.3. Discussions thématiques
Tout le long de l’année, sur des dossiers précis, la Commission politique à délégué à des groupes de travail l’élaboration de la réflexion, la préparation de rendez-vous et la construction d’argumentaires. Cela a été le cas sur la parentalité (autorité parentale), la déportation, le pacs, etc.
Le Conseil a eu plusieurs discussions thématiques importantes à partir de mars. Ces discussions avaient vocation à donner des éléments d’argumentaire aux membres du Conseil.
4.4. Le Printemps des Assoces : la conférence
Le Printemps des Assoces s'est voulu cette année à l'image de l'association organisatrice : un moment qui soit à la fois de convivialité, d'échanges inter-associatifs, de fête et de revendication politique. Sur ce dernier point, la conférence sur « Les discriminations liées à l’orientation sexuelle » de la Lesbian & Gay Pride qui s'est tenu le 7 avril au Palais du Luxembourg a largement rempli son rôle. Elle été composée en trois parties :
• Une discussion sur la reconnaissance des persécutions commises par les nazis envers les homosexuels,• l'accès à la parentalité, les actions contre les discriminations
- les personnalités politiques présentes étaient : Nicole Borvo (PCF), Marie-Pierre de la Gontrie (PS) et Alima Boumédiene (Verts).
Pour l’essentiel, se reporter au communiqué de presse.
4.5. Le Printemps des Assoces : le salon
Cet événement annuel consiste principalement en un salon des associations gaies et lesbiennes d'Île-de-France, il est accompagné d'un thé dansant animé par des disc-jockeys issus d'associations (MAG-Jeunes gais et lesbiennes, Les Gais Musette, Popingays, CGPIF). Cette partie du Printemps des Assoces est organisée par la Commission inter-associative (CIA) qui en assure seule le risque financier. La logistique a entièrement été prise en charge par 70 bénévoles environ, membres des associations de la CIA. Ils ont ainsi assuré l’accueil, la caisse, le bar, le vestiaire, l’animation musicale, l’installation et la désinstallation du salon.
Le Printemps des Assoces s’est tenu le 8 avril dernier à l'Espace Voltaire (Paris, XIe) et a rassemblé une soixantaine d'associations exposantes. Le principe consiste à chevaucher salon et thé dansant, le premier s’est tenu de 14 à 21 heures, le second de 17 à 22h. L'événement a remporté un vif succès auprès de la communauté gaie et lesbienne et accueilli plus d’un millier de personnes. Le bénéfice financier de cette opération a notamment permis de subventionner des chars associatifs durant la Marche du mois de juin et d'envisager la réalisation de nouveaux événements inter-associatifs tout au long de l'année. Étant donné le succès public du Printemps des Assoces, nous envisageons l’an prochain de trouver un lieu plus important. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec la Mairie de Paris pour l’obtention d’une grande salle municipale, ainsi qu’avec des bailleurs privés.
4.6. Autres activités inter-associatives
Pour rendre manifeste tout au long de l’année le travail collégial de la Commission inter-associative (CIA), celle-ci organise également des thés dansants grâce au soutien de la Boîte à Frissons qui met gracieusement à disposition le local du Tango (13, rue au Maire, Paris ive). Pour la saison 2000-2001, deux thés dansants ont ainsi été organisés. L’animation musicale est faite par des disc-jockeys issus d'associations comme le MAG-Jeunes gais et lesbiennes, Les Gais Musette, les Popingays. Pendant la soirée, des animations et des spectacles amateurs ont été proposés par Angel 91 et le MAG. Il est envisagé pour la prochaine saison d’organiser quatre thés dansants et de réaliser des partenariats avec d’autres associations. Le projet d’une importante soirée inter-associative est également à l’étude.
4.7. Rapport financier de la Commission Inter-Associative
Voir tableaux en annexe.
4.8. Interventions, actions et dialogue
4.8.1 Les élections municipales et cantonales
La démarche de la LGP-IdF a été :
Élaboration par la commission politique d’un questionnaire adressé aux candidats à la mairie de Paris et aux chefs de partis dans les départements de l’Île-de-France
Publication des réponses sur le site web.
Globalement, le nombre de retours est assez faible : certains secrétariats départementaux de partis politiques ont relayé correctement le questionnaire, d’autres pas. Leur relance s’est fait difficilement en raison de leur grand nombre. Sur Paris, malgré une relance soutenue, peu de candidats ont répondu. Le choix avait été fait de produire un questionnaire qui obligeait les candidats à développer ses propositions, ce qui ne leurs a sans doute pas semblé dans l’ensemble.
La LGP-IdF a choisi ensuite de ne pas rester neutre entre les deux tours de l’élection sur Paris, en expliquant qu’elle ne souhaitait pas le retour des homophobes aux commandes.
4.8.2 Le dialogue avec les responsables politiques
L’année 2000-2001 s’est distinguée des précédentes par un nombre important de rendez-vous auprès d’interlocuteurs politiques, avec certains résultats.
4.8.2.1 L’audition par les rapporteurs de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur le pacs du 25 janvier 2001
La délégation de la Lesbian & Gay Pride, composée de René Lalement, Alain Piriou et Alia Rondeaux, a fait part aux rapporteurs des revendications de la LGP, accompagnée par un argumentaire rédigé pour l’occasion. L’échange a été affable et les points de vue plutôt convergents.
4.8.2.2 Le dialogue avec les Ministères (cabinets et administration)
Les deux semaines qui ont précédé la marche de la Lesbian & Gay Pride ont été riches en rendez-vous dans les ministères.
Des courriers de demande de rendez-vous ont été envoyés :
au Ministère de l’Intérieur, au Ministère de la Justice, au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, au, Ministère de l’Économie et des Finances, au Premier Ministre, au Secrétariat d’État à la Famille et à la Petite enfance
- Des rendez-vous ont été obtenus dans tous ces ministères. Ci-dessous est résumé le contenu de ces rendez-vous, décris par ordre chronologique.
• Rendez-vous au cabinet du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité le vendredi 15 juin
Délégation composée de René Lalement, Alain Piriou, Norbert Wolgust (Gare !)
Reçue par Madame Lucile Schmid, chargée de mission auprès de la ministre
- Nos demandes :
Ouverture des CODAC aux associations de lutte contre l’homophobie
Mise en place d’un dispositif de lutte contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle sur le terrain afin de marquer les acquis et les faire connaître.
- Les réponses :
Accord de principe pour l’ouverture des CODAC : aux associations de faire les démarches.
Proposition transmise à Élisabeth Guigou d’une conférence sur la discrimination, dont nous serions associées à l’organisation
Accord de principe pour transmettre l’information sur le nouveau dispositif de lutte contre les discriminations au Direction départementale du travail et aux Inspections du travail
La formation des écoutants du 114 aux questions d’homophobie est à étudier.
• Rendez-vous technique avec l’administration du Ministère de l’intérieur le mardi 19 juin
Délégation composée de René Lalement, Alain Piriou, Guillermo Rodriguez (ARDHIS)
- Reçue par un sous-directeur de la direction des libertés publiques et d’autres responsables administratifs.
- Nos demandes :
Ouverture des CODAC aux associations de lutte contre l’homophobie
Réécriture de la circulaire d’application du pacs du 10 décembre 1999 sur le droit au séjour et traitement égal des situations quelles que soient les préfectures ; sensibilisation du personnel à la question de l’homophobie
- Les réponses :
Les demandes ont été transmises au cabinet du ministre…
Un désaccord clair sur la question du séjour, malgré une appréciation commune sur la rédaction insuffisamment précise de la loi sur le pacs
Une fin de non-recevoir sur l’ouverture des CODAC.
- En conclusion de ce rendez-vous, nous avons demandé une rencontre plus politique avec un membre du cabinet.
• Rendez-vous technique avec l’administration du Ministère de l’Économie et des Finances le mercredi 20 août
- Délégation composée de René Lalement, Alain Piriou
- Reçue par le sous-directeur chargé de l’imposition sur le revenu.
- Nos demandes :
La suppression des délais sur la fiscalité dans le cadre d’un pacs.
- Les réponses :
Les demandes ont été transmises au cabinet du ministre…
Des arguments très classiques nous ont été opposés (peur des pacs blancs).
- En conclusion de ce rendez-vous, nous avons demandé une rencontre plus politique avec un membre du cabinet.
• Rendez-vous au cabinet du Premier Ministre le jeudi 21 juin
Délégation composée de Martine Gross (APGL), René Lalement, Alain Piriou, Guillermo Rodriguez (ARDHIS), Norbert Wolgust (Gare !)
- Reçue par Daniel Ludet, conseiller pour la Justice et par Danielle Jourdain-Menninger, conseillère pour l'Intégration (affaires sociales, santé).
- Nos demandes :
Tous les dossiers de la LGP ont été passés en revue.
- Les réponses :
Confirmation que nous serons partie prenante du comité d’organisation de la conférence sur la discrimination présidée par Élisabeth Guigou pour la fin de l’année.
Appui de la candidature du thème de la discrimination pour la grande cause nationale 2002.
Accord de principe sur une application égale des instructions ministérielles par les préfectures.
Affirmation de leur soutien pour débloquer des situations difficiles avec certains ministères.
Interpellation sur nos intentions en termes de communication sur le nouveau dispositif législatif
Incitation à aller voir les partis politiques dans la perspective de 2002.
Accord de principe sur la consolidation des acquis, mais difficulté d’engager des réformes profondes en fin de législature.
Suite à cette rencontre, des rendez-vous impossibles à obtenir ont été pris dès le lendemain avec certains cabinets.
• Rendez-vous au cabinet du Secrétariat d’État à l’Enfance et à la Famille le vendredi 22 juin
Délégation composée de Martine Gross (APGL), René Lalement, Alain Piriou
- Nos demandes :
L’amélioration de la proposition de loi sur l’autorité parentale.
La non-discrimination des candidat-e-s à l’adoption.
- Les réponses :
Réaffirmation d’un certain nombre de principes de non-discrimination qui ont guidé l’écriture de la loi sur l’autorité parentale.
Notre demande d’une intervention de la ministre, pendant le débat pour réaffirmer publiquement ces principes, sera relayée auprès de l’intéressée.
• Rendez-vous au cabinet du Ministre de l’Intérieur le vendredi 22 juin
Délégation composée de René Lalement, Alain Piriou, Guillermo Rodriguez (ARDHIS),
- Reçue par Philippe Moreau
- Nos demandes :
Ouverture des CODAC aux associations de lutte contre l’homophobie
Mise en place d’un dispositif de lutte contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle sur le terrain afin de marquer les acquis et les faire connaître
- Les réponses :
Parfaite compréhension de nos revendications.
Incitation à poser nos candidatures dans certaines CODAC ciblées, et intervention du Ministre si le préfet fait difficulté.
Réécriture pour la rentrée de la circulaire du 10 décembre 1999 jugée mauvaise (avec la réévaluation de la condition des 3 ans de délai), à laquelle nous serons associés sur plusieurs étapes.
Intervention immédiate du cabinet en cas d’expulsion d’un pacsé si sollicitation de notre part.
Cette rencontre a été la plus constructive et la plus productive en résultats concrets, le rendez-vous de la veille ayant permis d’accélérer les choses.
• Rendez-vous au cabinet de la Ministre de la Justice le vendredi 22 juin
Délégation composée de Martine Gross (APGL), René Lalement, Yves Roussel (Pacs et caetera)
<- Reçue par Fabienne Le Roy (questions civiles)
- Nos demandes :
Rappel sur la pénalisation des propos homophobes, constitution de partie civile
Non-discrimination dans les procédures d'agrément
Amendement à la loi sur l'autorité parentale pour l'adoption simple
Révision de la loi sur le pacs
Informations disponibles en Mairie
Instructions à l'administration pénitentiaire pour la détention des transsexuels
- Les réponses :
Pas d'avancée prévisible sur l'adoption ni sur les autres questions par voie législative
Avancées possibles par voie administrative (mise à disposition d'information, instructions...)
Note transmise à la ministre.
• Rendez-vous au cabinet du Ministère de l’Économie et des Finances le mercredi 20 août
Délégation composée de René Lalement, Alain Piriou et Denis Quinqueton (Pacs et caetera)
- Reçue par Guillaume Bachelay.
- Nos demandes :
La suppression des délais sur la fiscalité dans le cadre d’un pacs.
- Les réponses :
L’administration fiscale a transmis fidèlement nos demandes. Elle reconnaît que nos arguments sont imparables. En particulier l’argument du coût et celui des pacs blancs ne leur semblent plus pertinents.
Le conseiller s’est montré encourageant sur de nouvelles
Conclusion sur ces rendez-vous
Vrai blocage sur les questions de parentalité, même si le principe de non-discrimination est acquis : le contexte de fin de législature n’est pas porteur.
Sur la discrimination et le travail : difficulté à obtenir le lancement d’une campagne visible de lutte contre l’homophobie, mais une multitude d’ouvertures, certaines symboliques, d’autres extrêmement importantes qui ne seront obtenues que si les associations se mobilisent.
Sur le séjour :
tout le monde est d’accord sur l’idée que les préfectures ne doivent plus traiter les dossiers de façon si disparates, mais la mise en œuvre de ce principe ne semble pas simple.
la rédaction d’une nouvelle circulaire est avancée très positive
Sur la réforme de la loi sur la presse : rien à espérer avant 2002. C’est au niveau des programmes des partis qu’il va falloir se battre.
Sur la fiscalité du pacs : rien de sûr.
4.8.2.3 Le dialogue avec l’Hôtel de Ville
Le premier contact entre l’Hôtel de Ville et la LGP-IdF a été noué moins d’une semaine après l’élection de la nouvelle équipe municipale, lors de la conférence sur la discrimination, avec Marie-Pierre de la Gontrie, adjointe chargée des relations avec les associations et de la démocratie locale. Le 18 juin, la même élue organisait une réunion avec l’ensemble des associations gaies et lesbiennes et plusieurs adjoints, à l’occasion de laquelle la LGP-IdF présentait les dossiers-clés pour les associations.
Le 13 juin, une rencontre a eu lieu avec Odette Christienne, adjointe chargée de la mémoire. La délégation était composée de Jean Le Bitoux, René Lalement et d’Alain Piriou, accompagnée de Christopher Miles. L’objet de la discussion était la mise sur pied d’un centre d’archive et de documentation sur les homosexualités. L’échange, bien que cordial, n’a pas été des plus fructueux .
Le 18 juin, une rencontre a eu lieu avec Christophe Girard, adjoint chargé de la culture : un soutien de principe a été accordé pour la mise sur pied d’un tel projet, bien que la décision revienne au maire.
La discussion suit actuellement son cours avec l’Hôtel de Ville.
4.8.3. Des actions ponctuelles ou suivies
4.8.3.1 La journée mondiale de lutte contre sida
La Lesbian & Gay Pride Île de France a souhaité se réinvestir de la question de prévention du sida, à l’occasion de la journée du premier décembre, par la publication d’un communiqué de presse, de l’édition d’un tract et de la mobilisation des membres du Conseil pour la manifestation. Le thème choisi par la Commission politique était la solidarité internationale.
4.8.3.2 La reconnaissance des persécutions nazies contre les homosexuels
Le Conseil a décidé en janvier de porter haut cette question. La Lesbian & Gay Pride s’est mis au travail avec les associations ayant déjà engagé des discussions avec les pouvoirs publics à ce sujet, en particulier le Mémorial de la Déportation Homosexuelle. Un contact étroit s’est établi avec la Fondation pour la mémoire. Le Secrétariat d’État aux Anciens Combattants a missionné cette même fondation pour mener un travail de recherche pour l’établissement des faits historiques. Enfin, la LGP et le MDH ont reçu un soutien appuyé de nombreux élus, dont le Maire de Paris, d’adjoints, d’élus d’arrondissement, au cours de la Journée du Souvenir du 29 avril dernier. Celle-ci a été l’occasion du dépôt d’une gerbe en marge de la cérémonie officielle, en présence de nombreuses personnalités. Le Premier Ministre s’est publiquement déclaré en faveur de la reconnaissance des persécutions nazies contre les homosexuels. Mais les associations d’anciens combattants montrent une forte hostilité à celle-ci.
4.8.3.3 L’interpellation du CSA sur l’émission des Grosses Têtes.
A plusieurs reprises, des allusions homophobes et de propos insultants sont tenus lors de l’émission des Grosses Têtes sur RTL. Média-G en a recensé la plupart. La LGP a écrit un courrier de protestation au CSA, se fondant sur les textes en vigueur depuis juin 2000, en coordination avec les animateurs de Média-G. Le président du CSA a répondu à ce courrier.
4.8.3.4 Le procès du Caire.
Le procès des 52 égyptiens présumés homosexuels, débuté en juillet 2001, a fait l’objet d’un courrier envoyé à l’ambassade d’Égypte, avec copie au Ministre des Affaires étrangères. D’autres actions ont eu lieu par la suite.
4.9. Bilan politique, soutiens
Les soutiens à la marche officiellement exprimés sont les suivants.
Gérard Aschieri, Secrétaire Général de la FSU ; Michèle Bernard-Urrutia, Présidente du CNAFAL, Bernard Birsinger, député-maire de Bobigny (PCF), Jacques Chatagner, Président de Droits et Libertés dans les Églises ; la Fédération CGT des cheminots ; Adeline Hazan, Secrétaire Nationale aux Questions de Société, Parti Socialiste ; Jean-Paul Huchon, président du Conseil Régional d'Île-de-France ; Robert Hue, secrétaire national du Parti communiste français ; la Ligue des Droits de l'Homme ; Dominique Voynet, Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement ; Philippe Meynard, ; Georges Sarre, Député de Paris, Maire du 11ème arrondissement ; Bernard Vivant, Coordination du Bureau Confédéral de la CGT.
Elles sont inférieures en nombre aux personnes présentes dans le carré de tête (cf. 5.6.).
Ce qui est à remarquer :
Un engagement nouveau et quasi unanime du mouvement syndical des enseignants
Une hésitation de la droite : pas de vrai soutien officiel et une participation de personnalités à titre personnel. Personne du RPR.
Un élargissement des soutiens à gauche : le Conseil Régional a manifesté son soutien, et le carré de tête s’est révélé riche en élus d’arrondissements et de l’Hôtel de Ville
Le travail de toute l’année 2000-2001 aura consisté à mettre en place un vrai dialogue avec des représentants d’institutions, des partenaires associatifs et syndicaux nouveaux.
4.10.Coopérations nationales et internationales
L'association est membre du Centre Gai et Lesbien de Paris, de l'AGECA, de la Coordination Interpride France et de l'ILGA. Elle participe régulièrement aux réunions de l'Interpride. Elle est le membre français du réseau mis en place par l'ILGA pour le suivi de la politique européenne dans chacun des pays de l'Union et a participé à ce titre à un séminaire à Bruxelles en juillet 2001. Elle agit en solidarité avec des ONG pour des campagnes internationales, par exemple pour protester contre le procès du Caire, ou contre l'absence de protection des participants à la Marche de Belgrade.
4.11.Communication'association a adopté un nouveau logo, et une charte graphique est en cours de finalisation
L'association a acquis le domaine Internet lgp-idf.org et a ouvert son site web (https://wwww.lgp-idf.org) le 1er janvier. Elle dispose pour son fonctionnement d'une adresse de courrier électronique et de quatre listes de diffusion, mises à sa disposition par Gais et Lesbiennes Branchés. Organisé en 5 rubriques (association, événements, marche, documents, presse), le site a été conçu à la fois comme un moyen de mise en commun d'information pour ses membres, et comme un moyen de visibilité des associations, des revendications et des actions communes vis à vis du public. C'est le site de référence pour la Marche.
Les prises de position publiques, par le biais de communiqués de presse rédigés par la commission politique ou de déclarations du porte-parole sont faites généralement "au nom du Conseil de la lgp-îdf".
Quand la commission politique ne peut pas être consultée, ou quand l'approbation d'une majorité du Conseil n'est pas présumée, les communiqués sont signés du seul conseil d'administration. 17 communiqués ont été publiés cette année.
Dans un souci de visibilité maximale de ses membres, tous les courriers politiques sont faits " au nom du Conseil ", sont signés du porte-parole et du secrétaire de la commission politique et ils portent généralement la liste des membres du Conseil. La mention de cette liste ne signifie pas que l'adhésion de chacun des membres est présumée ; elle exprime seulement que le courrier exprime l'orientation générale adoptée par une majorité des membres du Conseil.
La communication était assurée, au sein du conseil d'administration, par le chargé de la communication, et au sein de chaque commission, par son ou ses secrétaires.
À partir du mois d'avril, la Sofiged a en outre pris en charge la production de plusieurs moyens de communication liés à la promotion de la Marche : un dépliant, une affiche et un programme, deux dossiers de presse (confiés à Alice au Bureau), un site web et des services audiotel et minitel.
5. Bilan de la Marche
5.1. Choix du parcours
Le Conseil avait voté un parcours très symbolique empruntant la rue de Rivoli et finissant place de la Concorde. Nous avons fait connaître à la Préfecture de Police la demande de parcours par courrier. Durant une première réunion, le représentant de la Préfecture a clairement exprimé qu’il était souhaitable de choisir un autre parcours, car celui-ci est gênant dans le cas où, notamment, « il y aurait une visite officielle impromptue». Même si l’argument était fallacieux, il nous a semblé plus judicieux de proposer un autre parcours qui fut voté par le Conseil et qui a été : départ de la porte Dorée pour finir à la place de la République en passant par la place de la Bastille. Une seconde réunion un mois avant la marche a eu lieu à la Préfecture. Elle avait un caractère parement technique pour préciser le déroulement de la Marche.
5.2. Communication Marche
Une communication spécifique pour la Marche a été mise en place par la Sofiged à partir du mois d'avril, et financée par des partenariats conclus entre la Sofiged et divers commanditaires.
Comme l'an dernier, ces partenariats ont été conclus par la Sofiged en toute indépendance vis à vis de l'association, malgré le principe adopté par le Conseil en avril 2000, de lier ces partenariats à la signature d'une charte éthique ou au soutien des revendications du Conseil. La seule prise en compte de critères commerciaux est en effet une limitation de nos possibilités d'action : les entreprises devraient au moins être incitées à lutter contre les discriminations en leur sein, et les entreprises de presse, à la fois à s'engager en faveur d'une révision de la loi sur la presse et à utiliser leurs support pour agir contre l'homophobie. Après la Marche, la lgp-îdf a donc écrit aux partenaires ou annonceurs pour leur rappeler la signification politique de la Marche et les informer que leur soutien au mot d'ordre de la Marche sera sollicité par l'association en 2002 s'ils souhaitent renouveler leur partenariat. Elle a également écrit aux comités d'entreprise des partenaires pour les informer de l'évolution du droit du travail et les inciter à travailler avec les associations gaies et lesbiennes locales.
Par ailleurs, l'association, qui aurait dû être consultée, exprime ses réserves sur la conclusion de certains partenariats. Il en est ainsi de Têtu, au sujet duquel le Conseil avait adopté en décembre 2000 une résolution exprimant sa désapprobation des nombreuses mises en cause personnelles des éditoriaux de ce magazine, à l'époque celle de Christian Saout, président d'Aides.
Les moyens de communication liés à la promotion de la Marche sont un dépliant, une affiche et un programme, deux dossiers de presse (confiés à Alice au Bureau), un site web et des services audiotel et minitel.
Le programme, publié à 30 000 exemplaires, a été conçu afin de porter le mot d'ordre commun auprès du public et de donner la parole à plusieurs associations : l'Interpride, l'APGL, l'ARDHIS, l'AHTP et Gare!, le Centre Gai et Lesbien, Degel, HOSI Wien, la Fierté Lesbienne et le P.A.S.T.T.
Un premier dossier de presse, produit par Alice au Bureau, préfacé par Philippe Noisette, incluait l'éditorial du Conseil, la présentation du mot d'ordre, le programme des événements, les dates des marches en France et en Europe, un historique et une présentation d'une quarantaine d'associations et des partenaires ; sa diffusion a été satisfaisante. La conférence de presse, consacrée à la Marche, a été cependant assez peu suivie.
Un point presse le matin de la Marche a permis d'accueillir les radios et télévisions et de remettre aux médias un second dossier de presse comportant la liste des soutiens au mot d'ordre (associations, syndicats, partis politiques), l'ordre de marche, les messages et communiqués de soutien, les interventions sur le podium.
Pour la première fois, Paris le journal (publié par la Ville de Paris à 800.000 exemplaires) a annoncé la Marche, son parcours et son mot d'ordre.
5.3. Modalités d'inscription
Les années précédentes, l’inscription à la Marche se faisait par un simple formulaire. Pour celle-ci, le Conseil a approuvé l’idée que l’inscription soit complétée par la signature d’une convention et voté en faveur de celle qui lui a été présentée. Celle-ci stipulait le soutien clair au mot d'ordre adopté par le Conseil et impliquait de participer financièrement à l’effort collectif (à une hauteur diférente suivant la nature de l’inscrit, commercial ou non), de payer les frais de redevance SACEM pour ceux qui passaient de la musique et de s’engager à respecter des consignes, relatives notamment à la sécurité et à l’usage de la sonorisation en certain point du parcours.
Le paiement de la redevance SACEM ayant été négocié, le prix était au forfait le plus bas suivant une échelle correspondant à la nature de l’audience du disc-jockey ou des interprètes sur les chars.
5.4. Bilan des inscriptions et ordre de Marche
La grande majorité des groupes s’étant inscrits à la marche ont bien compris l’intérêt de la convention et l’ont respectée. Sur 96 inscrits à la Marche, 3 seulement n’ont pas joué le jeu, dont un qui a signé tout de même le soutien au mot d’ordre.
Il est à noter que les mouvements politiques, syndicaux et associatif inscrits à notre manifestation ainsi que les participants commerciaux ont ainsi clairement exprimé leur soutien aux revendications nous prémunissant ainsi du soupçon de récupération de l’événement à leur profit que ce soit dans un objectif commercial, politique ou de simple visibilité.
5.5. Le podium de départ
Pour la première fois cette année, le podium s’est mis en place au départ de la marche, et les interventions ont eu lieu avant la formation du carré de tête.
Sont intervenus :
Alain Piriou, LGP-îdF
Martine Gross, APGL
Guillermo Rodriguez (Ardhis)
Jean-François Fiévet (Gare, la Bande des quatre)
Denis Quinqueton (Collectif pacs etc.)
Jean Le Bitoux (MDH)
Christian Saout (AIDES)
Daniel Lochak (LDH)
René Lalement (LGP-IdF)
Les prises de parole ont pris du retard, en raison notamment de la difficulté à réunir les intervenants, et surtout à cause du blocage de l’accès des manifestants à la place, et donc au podium, par les forces de l’ordre. Toutefois, chaque intervenant a respecté son temps de parole.
Cette formule semble la bonne, car elle renforce le caractère revendicatif de la marche. Il faut cependant veiller à ce que l’accessibilité au podium soit évidente.
5.6. Le carré de tête
Sa mise en place s’est révélée difficile à contrôler, notamment à cause de la pression créée par les photographes. L’installation de la banderole par les associatifs s’est fait sans trop de peine, mais son accès pour les personnalités, notamment le maire, a été extrêmement ardue. L’éparpillement des personnalités, et le fait que le point presse ait eu lieu à l’opposé du départ de la marche a aggravé la situation. Le service d’ordre s’est mis en place avec un peu de retard, mais une fois installé, s’est avéré très efficace. Avec une réserve au sujet des prises de vues photographiques, bien qu’un temps avait été prévu pour celle-ci, le très grand nombres de photographes a mis à mal l’organisation.
Le plan de la banderole qui avait été prévu s’est avéré impossible à faire respecter, sinon pour les associatifs. Ceux-ci étaient mieux représentés que les années précédentes, mais il s’est révélé malaisé de décider quelle personnalité politique aura accès à la banderole : choisir entre des parlementaires et des chefs de parti et faire une sélection est irréaliste.
5.7. Le déroulement, la sécurité
La Marche comporte trois périodes : la mise en place, le déroulement et la dispersion. Pour que l’ensemble de l’événement se passe le mieux possible, il y a eu cette année une nouveauté de plus : un service d’ordre.
La mise en place s’est déroulée de manière désordonnée, particulièrement pour les chars commerciaux en fin de cortège, car il n’y avait que 5 volontaires pour superviser la mise en place. Cependant la plupart des problèmes survenus ont été réglés à force de bonne volonté et de détermination.
Le bon déroulement de la manifestation devait être assuré par quatre éléments.
- Des groupes de volontaires, munis de talkies-walkies repartis tout le long du parcours, devaient prévenir tout incident ; certains devaient rester à la fin place de la République pour assurer la dispersion .
- Un poste de sécurité placé à mi-parcours devait servir de relais radio pour les talkies-walkies et de base logistique.
- Des personnes relais sécurité au côté de chaque groupe manifestant devaient en cas de problème contacter le poste de sécurité par téléphone.
- Une équipe de sécurité autour du carré de tête en liaison radio avec le poste de sécurité.
L’ensemble du dispositif a plutôt bien fonctionné. Trois limites se sont révélées : le nombre de volontaires n’était pas assez important pour se répartir sur toute la Marche (il faut noter que le nombre prévu initialement qui aurait probablement été insuffisant, a été considérablement réduit du fait qu'assez peu des volontaires annoncés issus de l’associatif se sont présentés). En dehors de la place de la Bastille, aucun des « nœuds » de ralentissement n’était contrôlé par une équipe pour écarter la foule et libérer le passage au cortège, et pour finir la présence d’un poste de sécurité pousse naturellement les personnes en difficulté à s’y adresser et nous n’avions prévu aucun secours.
Le service d’ordre n’a été mis en difficulté qu’à deux occasions. Sur la place de la Bastille, car deux sociétés, partenaires de la Sofiged, distribuaient respectivement des t-shirts et des boissons ce qui a excité la foule. Le second problème s’est déroulé à la fin du parcours sur la place de la République, où le podium de la Sofiged, associé à une autre distribution de boissons avait attiré des perturbateurs.
Malgré ces réserves, le bon déroulement de la marche (qui nous a valu les félicitations de la préfecture) et surtout le bon fonctionnement du service d’ordre laisse penser que la démarche est la bonne et qu’il ne nous reste plus qu’à la compléter.
5.8. La diffusion des messages
Pour la seconde année consécutive nous avons proposé la diffusion de plusieurs slogans rappelant le mot d'ordre de la marche aux associations et commerçants participants. C'est un travail assez lourd : tout d'abord une première réunion style "brain storming" à laquelle participait environ 6 personnes où les slogans définitifs ont été élaborés et choisis, puis une séance d'enregistrement dans un studio qui a duré 5 heures où participaient 6 personnes, ensuite il a fallu dupliquer les CD, une centaine, et ce travail a été fait par deux personnes. Le jour de la marche la distribution des CD aux chars ceci a mobilisé deux personnes.
Il semble que les consignes de diffusion ont été respectées à 50% par les associations et par quelques commerçants.
5.9. L'octroi
L'octroi qui se tient chaque année durant la marche est organisé par la Commission inter-associative. Le travail en amont et l’investissement financier sont importants puisqu’il s’agit de faire appel à des agents de sécurité pour protéger l’octroi, de préparer les caisses qui permettront de recueillir les dons, de procurer des T-shirts qui rendront visibles les octroyeurs dans la foule, de louer du matériel de sonorisation ainsi qu’une camionnette pour transporter la recette. L’octroi prend place sur un point du parcours défini en accord avec le Conseil d'administration. Il se situait cette année rue de Lyon, à hauteur de l’Opéra Bastille et à proximité du PC Sécurité de la Marche. Pour la première fois cette année, des banderoles annonçant la présence de l’octroi et l’appel aux dons ont été installées. Elles étaient visibles en amont sur plusieurs centaines de mètres et pourront être réutilisées pour les prochaines marches.
L’organisation de l’octroi a pu se faire grâce à l'aide d'une soixantaine de bénévoles répartis sur 4 tranches d’une heure et membres des associations représentées à la Commission inter-associative. Il a également été fait appel à trois animateurs bénévoles qui, 4 heures durant, se sont relayés pour solliciter les manifestants à faire un don à leur passage à l'octroi. Un certain nombre de chars commerciaux nous ont soutenus par une annonce sur leur propre sonorisation. L'objectif de l'octroi est de collecter des dons auprès des manifestants et d'en reverser les bénéfices à parts égales à l'association LGP—Île-de-France et à Commission inter-associative. Ces recettes leur garantissent une partie de leur autonomie financière. Il est envisagé l’an prochain de faire de l’octroi une étape importante sur le parcours de la Marche. Il est en outre question de solliciter les services techniques de la Mairie de Paris pour l’installation d’un podium sur lequel les animateurs pourront dialoguer avec les manifestants et les chars à leur passage à l’octroi, afin de mieux communiquer sur l’importance de leurs dons.
5.10.Bilan financier de la Marche
Voire tableau en annexe.
5.11.Nombre de participants
Le chiffre officiel communiqué par la Préfecture de Police est de 250.000 manifestants et de 250 000 spectateurs. La presse a annoncé 500.000 personnes, ce qui est un record absolu pour Paris. La météo particulièrement propice a participé à cette affluence.
5.12. Revue de presse
Le jour de la Marche, tous les grands quotidiens ont fait leur une sur la Marche :
- Le Figaro : "Les gays défilent pour l'homoparentalité", "Les syndicats homosexuels en plein essor" l'éditorial de Yves Thréard, "Le droit d'être gay"
- L'Humanité : "LGP contre toutes les discriminations. HOMOS POUR LE DIRE", avec une photo de Cyril Girard
- Libération : "Homos : la fête nationale. La Gay pride festoie samedi à Paris avec un mot d'ordre large : la lutte contre les discriminations.", "Les gays et les lesbiennes veulent être vus. La manifestation entend opposer la visibilité face aux discriminations pour homosexualité", l'éditorial de Jean-Michel Helvig, "Mûrir", "Vingt ans de sida, ça suffit!", par Act Up-Paris et douze associations de jeunes et aussi une jolie pub pour du chocolat
- Le Monde : "La Gay Pride fait de la politique. Les organisateurs du défilé de la fierté homosexuelle donnent un ton revendicatif à leur fête annuelle. A un an de l'élection présidentielle, ils réclament un pacs amélioré et le droit à l'adoption. Pour la première fois, un maire de Paris participe à la manifestation. "
- Le Parisien : "Le phénomène homo. Gay pride. reconnaissance du droit au mariage, possibilité d'adopter des enfants, lutte contre l'homophobie au travail : ce sont quelques-unes des revendications que des dizaines de milliers d'homosexuels s'apprêtent à défendre cet après-midi dans les rues de Paris de la désormais fameuse Gay Pride. Une marche qui, tout en gardant son côté festif, prend de plus en plus des allures de manifestation politique."
Après la Marche, les quotidiens signalaient le succès de la Marche.
- Libération : "Tout le monde se lève pour la Gay Pride. 500 000 participants à Paris 'contre les discriminations'", et "Le modèle PME (papa, maman, enfants) et l’homoparentalité'. Les militants gays et lesbiens luttent pour que soit reconnu un autre type de famille."
- Le Monde : "La LGP a rassemblé à Paris quelque 500 000 personnes, badauds compris. Le monde de la politique et celui de l'entreprise étaient représentés pour dénoncer les discriminations"
- Le Parisien : "500 000 dans la rue"
- Journal du Dimanche : "Ils étaient 500 000 à la Gay Pride"
Last modified: Wed Oct 10 17:55:52 MET DST 2001