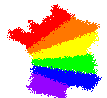
L'actualité en France
Les nouveaux habits de l'homophobie
La journée s'annonçait très longue, avec plus de 850 amendements au programme ; elle s'est achevée à 15h30 par la déroute de la majorité et le rejet inattendu du PaCS. Cet événement a cependant occulté les discussions qui sont d'une importance capitale dans la compréhension de l'évolution du discours politique sur l'homosexualité et la société.
 Cela fait plusieurs années que l'homosexualité n'avait pas été au
centre d'un débat parlementaire. D'emblée elle l'a été, Jean-Pierre
Michel commençant par déplorer « la croisade de ceux qui
refusent l'évolution des moeurs avec, hélas, la bénédiction des plus
hautes autorités religieuses, qui ont une vision rétrograde de
l'homosexualité conçue comme pathologie » puis rappelant que le
texte présenté est issu « d'une revendication exprimée par les
associations homosexuelles et les associations de lutte contre le sida
dans les années 1990 ». À son tour, Patrick Bloche commençait
ainsi : « De la tolérance à la reconnaissance (...) Longtemps
proscrits, ceux qui ne peuvent pas se marier vont enfin disposer d'un
statut ce que la jurisprudence elle-même ne leur avait pas
accordé! ». Catherine Tasca précisait qu'il s'agissait bien de
« mettre un terme à une discrimination », et de
« reconnaître un droit de cité aux homosexuels ». Plus
tard, Elisabeth Guigou affirmait que « la tolérance, ce n'est
pas assez, car elle est trop fragile et trop souvent octroyée comme une
aumone. La tolérance, c'est bien ... », Patrick Bloche
complétant, « ... mais la reconnaissance c'est
mieux ».
Cela fait plusieurs années que l'homosexualité n'avait pas été au
centre d'un débat parlementaire. D'emblée elle l'a été, Jean-Pierre
Michel commençant par déplorer « la croisade de ceux qui
refusent l'évolution des moeurs avec, hélas, la bénédiction des plus
hautes autorités religieuses, qui ont une vision rétrograde de
l'homosexualité conçue comme pathologie » puis rappelant que le
texte présenté est issu « d'une revendication exprimée par les
associations homosexuelles et les associations de lutte contre le sida
dans les années 1990 ». À son tour, Patrick Bloche commençait
ainsi : « De la tolérance à la reconnaissance (...) Longtemps
proscrits, ceux qui ne peuvent pas se marier vont enfin disposer d'un
statut ce que la jurisprudence elle-même ne leur avait pas
accordé! ». Catherine Tasca précisait qu'il s'agissait bien de
« mettre un terme à une discrimination », et de
« reconnaître un droit de cité aux homosexuels ». Plus
tard, Elisabeth Guigou affirmait que « la tolérance, ce n'est
pas assez, car elle est trop fragile et trop souvent octroyée comme une
aumone. La tolérance, c'est bien ... », Patrick Bloche
complétant, « ... mais la reconnaissance c'est
mieux ».
 Elle répondait ainsi à Jean-François Mattei, qui a défendu
l'exception d'irrecevabilité par un discours du plus grand intérêt, car
il s'y découvre l'état d'esprit de la droite, en 1998. La première
partie de ce long discours, « vers la conquête d'une plus grande
liberté », était surprenante d'humanisme. Comme les deux
rapporteurs, il commença par évoquer les homosexuels, mais contrairement
à eux, désigna leur « communauté, particulièrement exposée [au
sida], longtemps ignorée et même considérée comme délinquante. [...] Il
serait inacceptable de l'exclure ou de la condamner. La conquête de la
liberté impose le respect de l'autre dans ses choix et ses
différences. Mieux, elle exige de venir en aide à celui dont la liberté
est menacée. ». Jean-François Mattei alla jusqu'à concéder
qu'il y avait injustice : « Il est vrai en revanche que le
concubin homosexuel ou hétérosexuel
considéré comme un tiers dans la succession se voit
appliquer un régime fiscal défavorable, qui est une
certaine forme d'injustice. »
Elle répondait ainsi à Jean-François Mattei, qui a défendu
l'exception d'irrecevabilité par un discours du plus grand intérêt, car
il s'y découvre l'état d'esprit de la droite, en 1998. La première
partie de ce long discours, « vers la conquête d'une plus grande
liberté », était surprenante d'humanisme. Comme les deux
rapporteurs, il commença par évoquer les homosexuels, mais contrairement
à eux, désigna leur « communauté, particulièrement exposée [au
sida], longtemps ignorée et même considérée comme délinquante. [...] Il
serait inacceptable de l'exclure ou de la condamner. La conquête de la
liberté impose le respect de l'autre dans ses choix et ses
différences. Mieux, elle exige de venir en aide à celui dont la liberté
est menacée. ». Jean-François Mattei alla jusqu'à concéder
qu'il y avait injustice : « Il est vrai en revanche que le
concubin homosexuel ou hétérosexuel
considéré comme un tiers dans la succession se voit
appliquer un régime fiscal défavorable, qui est une
certaine forme d'injustice. »
Hélas, cette étonnante tolérance tourna court quand on entendit qu'elle était limitée à la sphère privée de l'individu homosexuel, et que celui-ci ne devait accéder à aucun titre à un lien social reconnu : « le traitement équitable et respectueux des homosexuels, digne d'une société moderne comme la France, relève du droit à la protection de la vie privée, non du principe d'égalité ». Pourquoi ? Parce que ces couples ne se reproduisent pas. Jean-François Mattei n'imagine pas d'autre forme d'utilité sociale que la (re-)production : « il n'est donc pas équitable que des couples n'ayant par définition aucune vocation à avoir des enfants soient traités par la société sur le même plan que les autres ». Et de se dédouaner aussitôt de toute accusation de discrimination : « on ne peut raisonnablement considérer la différence de traitement entre couples hétérosexuels et homosexuels comme une discrimination ».
 Au contraire, il semble que la gauche ait découvert la valeur
intrinsèque du couple dans la société. Ainsi Elisabeth Guigou justifiait
l'invention du PaCS « parce qu'il est de l'intérêt
de tous de reconnaître tout ce qui, dans une société
de plus en plus atomisée, de plus en plus livrée à
des égoïsmes individuels et où la solitude ne cesse
de gagner du terrain, peut retisser du lien social ». C'est sur
cette utilité sociale, à laquelle couples hétérosexuels et homosexuels
contribuent également, que repose la valorisation sociale et la
légitimation du couple, comme l'expliqua Elisabeth Guigou : « Il
valorise la vie commune reposant sur la
solidarité. ». Ainsi, comme le dénonce d'ailleurs
Jean-François Mattei, « se profile la légitimation
sociale de l'homosexualité ». Et pourquoi pas ? En tout
cas, c'est bien l'homophobie qui se profile sous le masque de la
tolérance. Le recours à l'« anthroplogie sociale
historique », ou à n'importe quel savoir, ne tiendra jamais
lieu d'éthique.
Au contraire, il semble que la gauche ait découvert la valeur
intrinsèque du couple dans la société. Ainsi Elisabeth Guigou justifiait
l'invention du PaCS « parce qu'il est de l'intérêt
de tous de reconnaître tout ce qui, dans une société
de plus en plus atomisée, de plus en plus livrée à
des égoïsmes individuels et où la solitude ne cesse
de gagner du terrain, peut retisser du lien social ». C'est sur
cette utilité sociale, à laquelle couples hétérosexuels et homosexuels
contribuent également, que repose la valorisation sociale et la
légitimation du couple, comme l'expliqua Elisabeth Guigou : « Il
valorise la vie commune reposant sur la
solidarité. ». Ainsi, comme le dénonce d'ailleurs
Jean-François Mattei, « se profile la légitimation
sociale de l'homosexualité ». Et pourquoi pas ? En tout
cas, c'est bien l'homophobie qui se profile sous le masque de la
tolérance. Le recours à l'« anthroplogie sociale
historique », ou à n'importe quel savoir, ne tiendra jamais
lieu d'éthique.
Il s'agit bien de la confrontation de deux philosophies, ce que Jean-François Mattei avoua naïvement, et aussi maladroitement. Il y aurait selon lui deux politiques familiales, la sienne orientée vers la « survie [biologique] de la société » , et celle de la gauche, qui « s'apparente à une politique de solidarité et de redistribution ». En ignorant complètement la nécessité d'une cohésion sociale, ou bien en faisant reposer cette cohésion sur la seule famille, Jean-François Mattei écarte délibérément du « tissu social » tous ceux qui ne contribuent pas à la reproduction de la société.
Mais alors comment comprendre qu'étant si épris de biologie, il reproche au PaCS de n'être « pas un pacte de solidarité, mais de sexualité » ? Fin observateur, il relève que la notion de couple, les restrictions empêchant la polygamie et l'inceste n'ont d'explication que si le PaCS est sexualisé. C'est ce qu'avait confirmé Elisabeth Guigou (il concerne des « personnes présumées avoir une communauté de toit et de lit »), tranchant ainsi un débat sur l'intégration des fratries dans le PaCS.
 En fait, ce qui le gène peut-être le plus, c'est qu'il y ait de la
sexualité en dehors du mariage, et que c'est finalement cette sexualité
présumée qui fonde la société à valoriser le couple. À cet égard, le
coup le plus fort fut porté par Patrick Bloche, même s'il ne fut pas
relevé par la droite : « Le déclin du mariage est une
réalité statistique. Cette formule ne doit pas rester
l'unique norme. Le mariage est un choix de vie parmi
d'autres. ». Que la gauche plurielle, sans vraiment le
claironner, propose une pluralité des normes, voilà sans doute qui
dépasse ce que les chrétiens-conservateurs peuvent supporter. Et
pourtant, c'est sur cette pluralité des normes, ou plutôt des modèles,
que repose le plein épanouissement de l'individu, qui y trouve alors la
force de lutter contre la pression sociale. Ceci concerne plus
particulièrement les jeunes découvrant leur orientation homosexuelle,
mais aussi tous dont les conditions de vie, les convictions morales ou
simplement la précarité ne permettent pas d'envisager le mariage comme
un idéal. Dans ce débat, si la gauche a pris conscience de la première
utilité sociale du couple en tant qu'instrument de cohésion de la
société, nul n'a dit mot de cette seconde utilité sociale du couple, du
couple légitimé par un contrat : donner d'autres repères, notamment aux
jeunes.
En fait, ce qui le gène peut-être le plus, c'est qu'il y ait de la
sexualité en dehors du mariage, et que c'est finalement cette sexualité
présumée qui fonde la société à valoriser le couple. À cet égard, le
coup le plus fort fut porté par Patrick Bloche, même s'il ne fut pas
relevé par la droite : « Le déclin du mariage est une
réalité statistique. Cette formule ne doit pas rester
l'unique norme. Le mariage est un choix de vie parmi
d'autres. ». Que la gauche plurielle, sans vraiment le
claironner, propose une pluralité des normes, voilà sans doute qui
dépasse ce que les chrétiens-conservateurs peuvent supporter. Et
pourtant, c'est sur cette pluralité des normes, ou plutôt des modèles,
que repose le plein épanouissement de l'individu, qui y trouve alors la
force de lutter contre la pression sociale. Ceci concerne plus
particulièrement les jeunes découvrant leur orientation homosexuelle,
mais aussi tous dont les conditions de vie, les convictions morales ou
simplement la précarité ne permettent pas d'envisager le mariage comme
un idéal. Dans ce débat, si la gauche a pris conscience de la première
utilité sociale du couple en tant qu'instrument de cohésion de la
société, nul n'a dit mot de cette seconde utilité sociale du couple, du
couple légitimé par un contrat : donner d'autres repères, notamment aux
jeunes.
Les opposants prendront donc l'exact contre-pied de ce qui justifie réellement le PaCS. Pas de « consécration », mais une « constatation ». Pas de cohésion, mais une division sociale : au lieu d'un statut universel, un « statut des concubins hétérosexuels » et « en délivrant une attestation de vie commune aux couples d'homosexuels ». Pas de reconnaissance, mais une charitable tolérance, avec l'octroi parcimonieux de mesures fiscales et sociales.
On peut mesurer le chemin parcouru depuis les années 60, ou même depuis les débats sur l'âge de consentement, il y a 16 ans. L'homophobie est désormais plus aimable, elle parle désormais de respect, de liberté, voire de droits, pourvu qu'ils ne soient que patrimoniaux, mais reste autant méprisante. Si certains députés de la gauche plurielle ont manifesté par leur présence leur engagement pour le PaCS, que dire de ceux qui ont volontairement déserté l'Assemblée, et qui ont préféré se taire et se terrer lâchement dans leur fiefs ?
Lire la lettre ouverte d'un internaute de Marseille.
12/10/98 © Gais et Lesbiennes Branchés